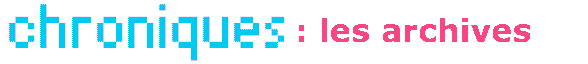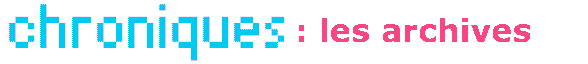La fatale Histoire amoureuse des Gaules
Le second volume des Libertins du XVIIe siècle sous la direction de Jacques Prévot dans la Bibliothèque de la Pléiade (NRF, Gallimard) nous réserve une très belle surprise : la réédition de l’Histoire amoureuses des Gaules. Depuis longtemps introuvable, ce petit livre fait partie de cette littérature qu’on a méprisé et qu’on a voulu oublier. Bien sûr, ce que raconte son auteur, Robert de Bussy-Rabutin, de la vie de Cour sous la Régence et sous Louis XIV n’a pas la valeur des Mémoires de Saint Simon. Mais ce n’en est pas moins une délicieuse et impertinente incursion dans les coulisses de Versailles et des grandes demeures seigneuriales. Ce militaire à la carrière pour le moins chaotique, proche du prince de Condé au début de la Fronde, puis rallié à la cause royale, Bussy-Rabutin n’a jamais su tirer profit de ses exploits militaires ni de ses relations dans le labyrinthe du pouvoir. Il faut savoir qu’il commet maladresse sur maladresse. Après bien des déconvenues et un « exil » en Bourgogne à cause de ses relations avec Louis de Rochechouart et sa bande de libertins, il se lance dans la littérature en 1660. Il a déjà une correspondance très nourrie avec sa cousine, Mme de Sévigné, ce que constitue ses « rabutinages », il écrit son premier ouvrage avec le prince de Conti, la Carte du pays de la Braquerie, sorte de parodie de la carte du tendre alors si prisée. Ayant la plume légère, acérée et facile, il écrit plusieurs livre dont un Abrégé de la vie de sainte Chantal. Et il compose son Histoire amoureuse des Gaules en un mois.Il se montrer imprudent en en confiant le texte à Mme de Baume, qui s’empresse d’en faire une copie et de le faire circuler. Il écrit aussi des Maximes d’amour, inspirées par des questions d’amour qui font fureur à la cour et a même le privilège de les lire au roi. Cela lui vaut d’être élu à l’Académie française. Mais les éditions de l’Histoire amoureuse circulent et font grand bruit. Sentant le danger, il fait parvenir le manuscrit à louis XIV. Mais rien n’y fait une cabale est montée contre lui et il est embastillé (pour la seconde fois) pendant treize mois. Quand il rentre sur ses terres bourguignonnes, désabusé, brisé, il s’amuse à décorer les salles de son chastel de devises et de scènes allégoriques, des portraits des rois de France, des grands hommes de son temps et surtout des « plus belles femmes de la cour », qui se voient toutes attribuer un commentaire ambigu. Il y a libertin et libertin.
Bussy-Rabutin a été un peu des deux, sans excès, mais avec malice et un esprit finalement ravageur.
H. B.
Le premier tome des Œuvres romanesques complètes de Stendhal sous la direction d’Yves Ansel et de Philippe Berthier dans la prestigieuse collection de la « Pléiade » (NRF, Gallimard) est une aventure éditoriale attendue depuis fort longtemps. On y peut découvrir l’évolution d’un écrivain et une évolution qui n’a pas été sans difficulté. Prenons par exemple Ernestine ou La Naissance de l’amour : d’un côté on est consterné, dès les premières lignes, par des descriptions sucrées et des situations qui, telles qu’il les présente, frôlent le ridicule et le cliché défraîchi, de l’autre un style déjà emporté et tranchant. Ecrit comme une sorte de mise en scène de son essai De l’amour, ce romanzetto a quelque chose de puéril. En somme, Stendhal n’a pas écrit Le Rouge et le noir du jour au lendemain et ici on assiste aux efforts et aux échecs du jeune homme de lettres. Mais on comprend qu’il a en tête un genre de roman tout à fait démonstratif : Julien Sorel est un automate conceptuel comme la pauvre Ernestine est une « statue de Condillac » comme le dit si bien Ph. Berthier. Sorel commence par être un pâle Rastignac et finit comme l’expression paradoxale de la liberté sans concession que l’homme se doit à lui-même pour s’affirmer dans sa plénitude et sa dignité. On remarquera aussi que dans cette œuvre, il s’amuse à se mesurer à ces prédécesseurs, en particulier l’Abbé Prévost, à l’occasion de la représentation de Manon Lescaut à l’Opéra : Mme de Fervaques le juge « immoral et dangereux » et, sournoisement, glisse au jeune homme que Napoléon, à Sainte-Hélène, l’a qualifié de « roman pour les laquais ». Un débat sur l’art romanesque s’insinue sans cesse dans ces pages car il est manifeste qu’en dépit de son caractère révolutionnaire, le livre puise largement dans les ouvrages du premier romantisme (il n’est que de lire la scène entre Mathilde et le héros dans la prison, sans parler de la fin avec la mort de Mathilde trois jours après celle de Julien !).
En Français dans le texte
L’immense somme de Paul Bénichou, Romantismes français, (deux tomes, « Quarto », Gallimard) doit absolument être le livre de chevet que dis-je ? le bréviaire de tout honnête homme. Ce terme de romantisme qui a été vidé de sens au fil du temps, ou réduit à un pâle stéréotype, reprend ici toute sa complexité et aussi toute sa valeur. Ce qui ressort du livre, c’est une évolution constante de ses contenu. Chaque écrivain qui, pour une raison ou une autre s’y est reconnu ou a été assimilé à ce que ce mot suppose à son époque, a fait évoluer un concept qui s’est prêté à toutes les métamorphoses. Quel lien en effet peut-on imaginer entre Lamartine et Baudelaire ? Et avec Gautier, on est à cent coudées de Lamennais entre autres, traducteur de Dante ? Bénichou tisse les liens secrets entre la pensée de tous ces écrivains et penseurs tout en marquant avec précision les différences fondamentales qui les opposent. Et il pose avec beaucoup de discernement et une érudition vertigineuse les fondements d’un grand mouvement des idées qui, en Europe, a pris des orientations souvent divergentes. Autre chose : le chapitre consacré aux Jeunes-France montre qu’une provocation de potaches a entraîné un bouleversement profond de la sensibilité esthétique et le début d’une rupture profonde dans notre littérature. Ce livre est une mine historique, cela n’est que trop évident, mais aussi un modèle d’analyse.
Les Pages d’atelier de Francis Ponge (sous la direction de Bernard Beugnot « Les Cahiers de la NRF », Gallimard) sont une manière d’entrer en catimini dans le Studiolo du poète. Il ne s’agit d’ailleurs pas seulement de premiers jets ou de textes inaboutis : certains d’entre eux ont été parfaitement ciselés. Mais on découvre aussi Ponge qui s’interroge non seulement sur son écriture, mais aussi sur lui-même. Par exemple, en 1942, Ponge conclut : « je ne suis pas un poète épique » : « je ne suis pas un poète épique (je le regrette), ni un dramaturge, ni un romancier, ni un élégiaque, ni un satiriste. » Et fort de ce constat, il définit ce pour quoi il écrit « pour l’homme au moment où il se repose et ne fait rien, pour lui découvrir les beautés dont il peut jouir…». C’est-à-dire que son fameux parti pris des choses est né d’une introspection ou de désenchantements autant que d’une volonté délibérée de jeter les bases d’une nouvelle poésie, qui part de la substance même des objets qu’il observe.C’est passionnant de bout en bout et l’on s’émerveille même quand Ponge parle des petits beurres ou du gui.
Les commémorations entraînent une surenchère éditoriale. C’est au tour de Jules Verne : suppléments de journaux, de magazines, numéros spéciaux et dossiers, biographies, réédition massive des œuvres… La biographie de Herbert R. Lottman (Flammarion) est tout à fait recevable. Mais qu’on n’aille pas chercher trop loin. Je désirais avoir des éclaircissement sur le bref voyage que l’auteur fit à Trieste lors de sa croisière dans la Méditerranée. L’archiduc Louis-Salvador d’Autriche l’aurait emmené sur son yacht. Rien de tel ici : ils vont à Milan pour voir les dessins des machines volantes de Leonardo. Dommage car le paysage de la rade de Trieste se retrouve vaguement dans ses derniers écrits et il est possible que l’aristocrate autrichien ait servi de modèle pour Mathias Sandorf.Ainsi le mystère reste entier. L’existence de Hetzel, que Jean-Paul Gourévitch dénomme Le Bon génie des livres (Le Serpent à plumes), mérite qu’on s’y arrête même si son biographe la raconte un peu sottement. Après des études de droit, le jeune Hetzel travaille à la Librairie Paulin. Il a rapidement de bonnes intuitions et publie Grandville qui connaît un grand succès, puis se lance dans l’édition des œuvres complètes de Balzac illustrées. Il collabore aussi avec George Sand et Hugo. Mais c’est avec Verne qu’il affirme pleinement sa vocation (et sa tyrannie) d’éditeur. Plusieurs titres peu connus de Verne sont réédités à cette occasion, dont La Jangada et l’étonnante Ile à hélices (Le Serpent à plumes).
Le dernière fiction de Linda Lê, Conte de l’amour bifrons (Christian Bourgois éditeur) confirme l’évolution qu’elle a pu accomplir ces derniers temps. Elle nous donne en pâture deux personnages, Ylane et Ivan. Chacun d’entre eux mène une existence plus ou moins fantasmatique, qu’elle n’a de laisse de rappeler la nature puisqu’elle les indexe comme ayant une « existence spectrale ». Ces deux êtres se rencontrent et connaisse une histoire d’amour qui transite par de multiples références livresques. Ce livre est une méditation sur la qualité du roman, sur l’invention des personnages romanesques, sur la vie de l’écrivain quand il écrit, c’est-à-dire la relation intime qu’il entretient avec ses créations. Linda Lê s’insinue dans chaque page du roman, le déroute, le dévoie. Mais il n’en reste pas moins que cette fiction se lit avec émotion. Une vraie gageure. En outre, elle a publié Le Complexe de Caliban (Christian Bourgois éditeur), un recueil d’articles où l’on croise aussi bien Amiel que Cioran, Robert Browning que Wilkie Collins. Et l’on se réjouira de son pastiche de Pérec, « je me souviens » ou de son petit « conte », « Les anamorphoses de l’enfance ».
Comme toujours un recueil d’Yves Mabin Chennevière constitue une expérience forte et déconcertante. Dans son Traité d’anatomie (La Différence) alternent des textes qui ont une perspective « aphorismique » et d’autres ayant un contenu plus grave. Cette légèreté et cette gravité conjuguées constituent une représentation du monde en perte d’équilibre. Et tout cela est prononcé avec une constante ironie et dans un esprit parfois parodique. Car rien n’est révélé sans un détour, même si les choses sont dites avec une implacable dureté : ce détour, c’est tout le travail de la langue, mais aussi et surtout des conditions de son émergence. L’auteur cultive les paradoxes et met en scène les contradictions les plus embarrassantes. Ainsi nous offre-t-il un portrait intériorisé aussi difficile à contempler qu’une figure convulsée de Bacon.
On ne saurait trop rappeler l’incroyable destin éditorial de Dominique de Roux, le créateur des Cahiers de l’Herne où il a réalisé des dossiers sur Borges, Ungaretti, Céline, Michaux qui ont fait date, ce qu’il a pu apporter à Christian Bourgois à ses débuts et sa capacité de faire découvrir des auteurs sulfureux. Ecrivain lui-même, il a affirmé un don pour le libelle. Dans ce recueil intitulé L’Ouverture de la chasse (Editions du Rocher) il est allé franchement à contre-courant, pourfendant avec une belle véhémence les manœuvriers de mai 1968 (le livre parut chez L’Age d’homme cette même année), brocarde Sollers, Marcuse, se montre bien indulgent pour Jean-Edern Hallier (personne n’est parfait) et parle de ses grands amours en littérature, surtout Pound, Gombrowicz. Voilà un livre tonique et vibrant qui a été écrit par un anti-conformiste d’un talent incontestable.
Poussière du Guangxi de Claude Margat (La Différence) relate le second voyage de l’auteur dans la région du Guangxi. La raison de son périple est de renouer avec la tradition des grands peintres chinois et d’approfondir ses connaissances de ce pays qui les a inspirés. De jour en jour, au fil des notes qu’il consigne dans son carnet, il nous communique ses émotions, traduit des paysages, parle de ces artistes de leur pensée, évoque les anciennes dynastie. C’est un livre érudit – le narrateur se sent des affinités électives avec les peintres-lettrés – mais c’est surtout un livre d’initiation pour ceux qui, comme moi, n’ont connu la Chine et son grand art que dans les salles des musées. Son plus grand accomplissement est d’avoir su dire toutes ces choses sans la moindre pédanterie et sans que ce voyage cesse d’être un enchantement.
|