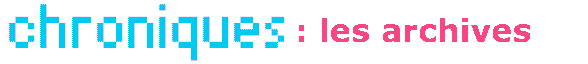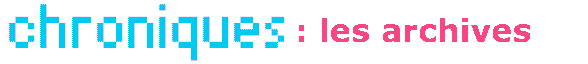version impression version impression |
 participez au Déb@t participez au Déb@t |
Dossier Franta
Du fond de la nuit, témoigner de la splendeur du jour |
| (suite) |
Il serait possible de reprendre la démonstration avec des tableaux représentant, non plus des «corps-lumières» mais des corps – toujours nus - dont l’apparence, en plein jour, les identifie aux couleurs de l’environnement. Au milieu des années 80, Franta a rencontré une tribu Masaï vivant sur une terre aride. Il a vécu plusieurs jours avec elle, découvrant que « les corps de ces hommes ont presque la même couleur que la terre, car la poussière se colle à leur peau. Cette présence du corps dans la terre et de la terre sur le corps, est accentuée par les motifs qu’ils peignent sur leurs jambes à l’aide d’un mélange terreux. Leur carnation adopte alors la rougeur propre au sol kenyan, comme si ces corps surgissaient de la terre… » Ainsi s’expliquent au premier degré des oeuvres comme Couleur sable, Groupe brun (gouaches sur papier, 1985) ou la splendide huile sur toile Masaï (1985)
Franta ayant donné lui-même la clef, inutile d’introduire du conceptuel dans le sensible et de vouloir formaliser tout de suite le sens de ces plages de couleur.
 De même que Van Gogh, par les seules couleurs, entendait représenter les « terribles passions humaines », c’est bien uniquement par la couleur que Franta rend compte de l’identité Masaï. Je me suis un instant séparé de l’oeuvre, ayant voulu en reconstituer la genèse en recueillant le témoignage de l’artiste, mais bien vite je suis ramené au contact de l’objet esthétique. Je passe du jugement déterminant au sens de Kant au jugement réfléchissant selon ce dernier : une réflexion qui adhère, qui se soumet à l’oeuvre et qui la laisse déposer son sens en moi. De même que Van Gogh, par les seules couleurs, entendait représenter les « terribles passions humaines », c’est bien uniquement par la couleur que Franta rend compte de l’identité Masaï. Je me suis un instant séparé de l’oeuvre, ayant voulu en reconstituer la genèse en recueillant le témoignage de l’artiste, mais bien vite je suis ramené au contact de l’objet esthétique. Je passe du jugement déterminant au sens de Kant au jugement réfléchissant selon ce dernier : une réflexion qui adhère, qui se soumet à l’oeuvre et qui la laisse déposer son sens en moi.
Je considère maintenant ces tableaux comme des objets directement signifiants, et si j’invoque volontiers l’auteur pour me rapprocher plus facilement du sens de l’oeuvre, c’est que j’identifie cet auteur à son oeuvre. Si je m’interroge sur la genèse de l’oeuvre, il s’agit d’auto-genèse : la comprendre n’est pas découvrir ce qui la produit, mais comment elle se produit et se déploie elle-même. C’est que, chez Franta, l’oeuvre est toujours expression de son être. Il y a bien une nécessité en elle, mais tissée de sa propre liberté, et non d’une nécessité extérieure qui la déterminerait à partir d’on ne sait où.
Dans l’atelier de Vence, Franta me montre un tableau sobrement intitulé Palmier, qui ne représente en effet qu’un palmier. Il fait partie d’une série traitant ce thème de 1988 aux années 90. Il ne s’agit pas d’un palmier comme il y en a autour de lui. Je m’avise à cet instant que l’atelier n’a pas de vue sur le splendide paysage niçois qui l’environne : la lumière vient du plafond ; quand Franta travaille, c’est exclusivement avec et dans sa peinture, sans possibilité de rien voir susceptible de l’en distraire. Non : ce palmier violemment travaillé en pleine pâte, rigoureusement dressé dans l’axe central de la toile, aussi hiératique et digne que les corps noirs tels que la somptueuse Femme-plante de 1986, ce palmier est à n’en pas douter africain. J’éprouve, avant d’entendre un éventuel commentaire du peintre, le sentiment d’une nécessité intérieure à l’oeuvre, que je ne puis nommer autrement qu’existentielle.
Il y a dans ce palmier calciné et verdoyant à la fois, une force, une évidence telle qu’elle s’impose comme une nécessité. Ce tableau de Franta, autant que beaucoup d’autres nés de son pinceau, interdit les hypothèses sur ce qu’il pourrait être de différent, si bien que comprendre l’oeuvre, ici, c’est constater qu’elle ne peut être autre que ce qu’elle est. Il ne s’agit pas, en l’occurrence, d’une tautologie, car cette assurance ne me pénètre que dans la mesure où je suis pénétré par l’oeuvre. Et c’est l’intimité ainsi trouvée avec elle qui me donne la volonté de chercher son sens en elle, puisque la nécessité existentielle ne saurait être connue du dehors. Je l’éprouve en moi à la condition de m’être ouvert à elle.
Il y a vraiment une nécessité de l’objet esthétique : mais il a fallu que je la reconnaisse en moi. La touche qui ordonne formes et couleurs de ce tableau est la même, aussi vive, rageuse même, pour traiter le palmier lui-même comme une personne debout que pour évoquer son environnement: ciel et terre. Cette dernière est bouleversée, carbonisée peut-être : les giclées de noirs, d’ocres et de blancs respirent le drame et envahissent même la base de l’arbre. Mais l’ensemble s’affirme comme complet, immuable, n’obéissant qu’à sa propre loi : j’ai devant moi une idée incarnée.
Quelle idée ? J’en ai sans doute assez dit déjà pour qu’on l’ait devinée. Citons tout de même Franta, qui confirme l’intuition saisissant – mais à un autre niveau – tout spectateur vraiment attentif : « J’ai eu l’inspiration de cette toile, et de la série dont elle fait partie, en observant des kilomètres de paysages calcinés et brûlés par la dureté du climat lors d’une traversée du nord de l’Afrique en autocar. Ces palmiers sont très différents de ceux que nous pouvons voir sur notre continent, et qui sont entretenus par toutes sortes d’engrais. Ils contiennent en eux une volonté de survie incessante, et dégagent une énergie et une force vitale. Ils luttent face à une condition de vie très dure, où la pauvreté de la terre les oblige à résister en permanence contre la mort. »
Cette idée incarnée, je l’avais découverte parce que l’objet esthétique est éloquent sans être jamais descriptif, et qu’il est profond dans la mesure où il m’oblige à me transformer pour le saisir. La profondeur du palmier de Franta est corrélative à la mienne, et cette corrélation est un aspect essentiel de l’expérience esthétique : par elle, le sens immanent m’est clairement apparu.
|
|
|
LA NÉCESSITÉ DE LA PARTICIPATION
Revenons au triptyque Pour le souvenir – Témoin de 1994 dont le peintre a fait réaliser une réplique photographique sur toile d’une grande fidélité, que l’on peut voir dans son atelier. Il s’agit d’une des oeuvres les plus importantes de Franta, sans doute son chef-d’oeuvre. Les conservateurs du musée de Nagoya ne s’y sont pas trompés, qui l’ont mis en valeur dans un vaste espace, non loin d’un tableau d’Anselm Kiefer, autre grand peintre expressionniste contemporain, lui aussi obsédé par les événements de la Deuxième Guerre mondiale.
Les japonais voient dans Pour le souvenir… une allégorie d’Hiroshima, ce qui est compréhensible, mais il s’agit en fait du « souvenir » du camp de Teresin construit par les nazis en Tchécoslovaquie; le «témoin», au centre de la composition est un visage caché par des mains superposées, qui ne voit donc pas les cadavres entassés dans les charniers qui l’environnent. La mère de Franta a été internée à Teresin, et c’est là que le poète français Robert Desnos est mort, en 1945, peu après avoir écrit ceci : « … du fond de la nuit, nous témoignons encore de la splendeur du jour et de tous ses présents. Si nous ne dormons pas c’est pour guetter l’aurore qui prouvera qu’enfin nous vivons au présent ». Il s’agit ici de mémoire individuelle autant que de mémoire collective, et il s’agit de la relation de la peinture au temps. Franta peint au présent un passé qui ne s’efface pas.
Ce dont il est question est une horreur indicible : je le vois bien, et pourtant j’éprouve d’abord devant ce triptyque le sentiment de la beauté. Est-il possible d’expliquer comment le peintre a pu exprimer à la fois le fond de la nuit et la splendeur du jour ? Me revient en mémoire le fait que Franta s’était lié d’amitié, dans les années 60, avec son voisin d’Antibes l’écrivain Graham Green qui s’intéressait beaucoup à la façon dont le jeune peintre tchèque peignait des corps torturés, écrasés, parfois réduits à des masses indistinctes de chairs sanguinolentes (comme dans Ascension de 1969 par exemple, aujourd’hui au Musée d’Art Moderne de Prague). Green fit un jour le rapprochement avec les crucifixions de son compatriote Francis Bacon, peu connu alors en France, dont Franta n’avait encore vu aucun tableau. Green était conscient de ce que les manières de peindre des deux artistes étaient très différentes, mais la similitude de leurs thèmes lui paraissait frappante : il offrit un livre sur Bacon à Franta qui, j’imagine, se jeta dessus (il l’a précieusement conservé, et le consulte aujourd’hui encore).
Au-delà du thème de la chair souffrante, une parenté réelle semble en effet relier Franta à Bacon : tout se passe comme s’ils s’inspiraient tous deux de l’idée de la beauté selon Baudelaire, appliquée par Michel Leiris à l’oeuvre du peintre anglais. Pour Baudelaire, écrit Leiris, « l’idée courante d’une beauté reposant sur un mélange statique de contraires se trouve implicitement dépassée : puisqu’il est nécessaire qu’elle contienne un élément moteur de premier péché, ce qui constitue la beauté, ce n’est pas la seule mise en contact d’éléments opposés, mais leur antagonisme même, la manière tout active dont l’un tend à faire irruption dans l’autre, à s’y marquer comme une blessure, une déprédation.» C’est avec cette clef que Leiris lit les tableaux de jeunesse de Bacon, ceux en particulier qui s’inspirent en 1944 d’une phrase d’Eschyle où « sourit la puanteur du sang humain», avant même la libération des camps de la mort.
|
| mis en ligne le 30/07/2007 |
| Droits de reproduction et de diffusion réservés; © visuelimage.com - bee.come créations |
|
Dossier
Franta

|
|