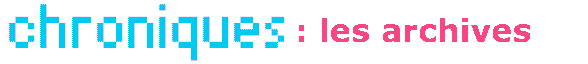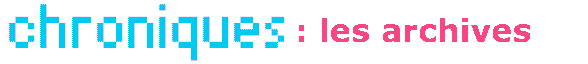La nuit des taupes
Solange Galazzo
« J’ai organisé mon terrier, et il m’a m’air bien réussi. »
Franz Kafka
Elles avancent en aveugles. Que cherchent-elles dans cette obscurité. Les taupes vivent dans le noir profond de l’Hadès. Et elles ont fini par devenir noires elles aussi. Presque anthracites. Je suis l’une d’elles. Je plonge dans l’obscurité. Je me souviens : toute petite, j’aimais dénicher tout ce qui se trouvait enfoui dans la terre – ce monde invisible m’intriguait beaucoup, trop même, d’autant plus qu’il contenait des êtres vivants.
J’ai retrouvé dans les souterrains de Kafka les émotions de mes nuits enfantines.
Maintenant que je me suis engagée à transposer dans mon univers pictural deux nouvelles de l’écrivain pragois, « La Taupe géante » et « Le Terrier », deux nouvelles « souterraines », je vois des taupes surgir à la surface au terme d’un périple hasardeux dans des galeries dédaliques et dans la masse compacte et obscure. Elles vivent à mes yeux en symbiose avec les ocres de la terre ou du sable du Roussillon. Elles sont couvertes de griffures, comme si elles avaient dû porter le poids monstrueux de cette terre. Il n’y aurait dans leur royaume enfoui que de minuscules lumières pour les guider. Elles s’adresseraient à moi et me questionneraient comme de petites sphinges malicieuses après avoir déchiré cet espace chtonien informe.
Par définition, le terrier est labyrinthique. Ce sont des galeries qui s’enchevêtrent au sein d’une place forte avec quelques ronds-points et de rares galeries larges et dégagées. C’est l’image d’un égarement procurant le frisson de l’inconnu et de la peur de se perdre à jamais. C’est un lieu de perdition comme la vieille ville d’Avignon au temps de la papauté, que François Pétrarque désignait comme la « troisième Babylone et le cinquième labyrinthe » : chaque rue portait l’espoir d’une rencontre imprévue et ne pas s’y retrouver, c’était rester étranger à jamais à sa vérité. Et c’est aussi la manifestation concrète de la spirale originelle.
Je me demande quand dans ma vie est apparu le Journal…
Anne Gorouben
Ce dimanche 19 juillet 1910, j’ai dormi, je me suis réveillé, dormi, réveillé, misérable vie. » Franz Kafka, Journal.
« J’y songe chaque fois et, chaque fois. » (1) Je me demande quand dans ma vie est apparu le Journal. Impossible de dater cette apparition, mais il me semble tout de même que ce fut très tôt, dès mes premières années d’étude, presque au même âge où Kafka a commencé à l’écrire. Il ne m’a plus quitté. Ce grand livre souffrant, tragique et drôle n’est pas de ceux qui détruisent, mais de ceux qui sauvent, qui donnent de la force. On y revient, sans cesse. Parcouru par la douleur de l’existence, il est traversé par la lumière. D’une beauté déchirante, il est transpersé par l’échec, par l’angoisse lancinante de l’échec, par le désir de solitude et par le désir de la rencontre, par la nécessité menacée d’écrire et la douleur du corps, du « désespoir que me cause mon corps et l’avenir de ce corps. » (1910).
« Je suis une fois de plus tiraillé à travers cette fente longue, étroite, terrible dont, à vrai dire, je ne puis triompher qu’en rêve. A l’état de veille et par la seule force de ma volonté je n’y parviendrai jamais. » (5 décembre 1919).
Aujourd’hui je suis préposée aux rêves, mon cher Gérard-Georges. Je parcours à nouveau le Journal par le biais de cette quête particulière de l’écriture de mes rêves, de mes visions d’avant le sommeil (« mais je n’ai pas dormi du tout. ») et d’immédiatement après le réveil. Franz Kafka écrit comme on dessine – c’est l’écriture la plus proche du dessin que je connaisse. Quelque chose que je n’ai jamais vu ailleurs. Et, dans le Journal, le travail incessant de cette écriture se frayant un chemin par approches successives, cet effort pour aller vers cette vérité dépouillée est incomparable – Kafka dessine : « l’insatisfaction dont un rêve offre l’image, chacun lève les pieds pour quitter la place où il se trouve. » (16 août 1912). « Tout oublier. Oublier la fenêtre. Vider la chambre. Elle est traversée par le vent. On ne voit que le vide, on cherche dans tous les coins et l’on ne trouve pas. » (19 juin 1916).
« Vague espoir, vague confiance. » (2 novembre 1920). «Cet après-midi, rêve d’une tumeur sur ma joue. Cette frontière oscillant perpétuellement entre la vie et une terreur en apparence plus réelle. » (22 mars 1922). « Mon travail se clôt, comme peut se fermer une plaie qui n’est pas guérie. » (8 mai 1922). La plaie n’est pas et ne peut se guérir, chaque page ouverte du journal l’est sur une douleur et sur une cécité mêlée de désespoir et de lumière. Pour moi, les « images», ce que j’appelle cette évocation si violente qu’elle s’apparente donc au dessin, se reçoivent de façon viscérale, intense ; elles se ressentent physiquement: ce sont des mots qui agissent sur le corps, qui pénètrent avec toute la force qui nécessite leur expulsion.
Description d’un combat
Claude Jeanmart
A propos du film, des peintures, et des images réalisés sur la proposition de Gérard-Georges Lemaire, à partir de la nouvelle de Franz Kafka, « Description d’un combat».
L’écriture de Kafka, celle de ses nouvelles, m’est apparue d’emblée, comme une écriture cinématographique. Cette écriture m’a semblé également très picturale, tant elle fait naître d’images riches en contrastes, en « tons sur tons », en parties indéfinissables, comme abstraites. J’ai pensé bien sûr à Alfred Kubin, son contemporain, dont j’avais admiré l’oeuvre, sombre et étrange, dans la très belle petite ville de Litoméricé.
La lecture de « Joséphine » m’avait déjà procuré un foisonnement d’images et de sons, mais j’y voyais surtout des mouvements de foule, difficiles à mettre en oeuvre avec des moyens restreints. Je me suis orienté ensuite vers « Regard », et en particulier vers « Enfant sur la grand route », qui me rappelait des vacances passées en Bourgogne ; mais je risquais trop d’être tenté par l’autobiographie, ou par la nostalgie. Celle de « Description d’un combat », écrit en 1906. J’y ai trouvé immédiatement des points de rencontre avec ma peinture, et avec mes travaux en scénographie. J’ai incorporé dans mon projet, la seconde écriture de cette nouvelle, datant de 1910, et à laquelle Kafka donna le titre de « Vers minuit ».
J ‘ai commencé à prendre des notes et petit à petit, une cascade de situations et d’images, une profusion de sentiments, se sont transformés en un scénario dont j’ai senti qu’il me fallait absolument respecter la chronologie. Cette nouvelle, encore plus que les précédentes, m’est apparue semblable à un story-board de film. Il y avait à tout instant des changements de rythme, d’échelle, d’espace.
On était dedans, puis dehors, puis à nouveau dedans. Les deux principaux personnages masculins, passaient devant des figurants, devant des couples accoudés à leurs fenêtres, ils couraient en de longs travellings, devant des façades de maisons, disparaissaient et réapparaissaient derrière des arbres, en des plongées et contre plongées successives. Les uns étaient vus en plan large, d’autres en plan américain ; il y avait même des gros plans.
Le respect de la chronologie des événements, dans la construction du scénario, s’est imposé, tant l ‘écriture de Kafka me semblait faite de la juxtaposition de petits textes, chacun autonome, mis bout à bout comme cela se produit dans la constitution des rêves. Ces derniers qui ne sauraient être des récits rationnels, sont cependant empreints d’une logique évidente, d’une structure dans laquelle le quotidien, libéré de la linéarité temporelle, est présent à tout instant. Les entretiens avec Gérard-Georges Lemaire, m’ont éclairé en ce sens, et ont confirmé cette façon particulière qu’avait Kafka, de composer ses nouvelles à l’aide d’une technique que l’on nommerait aujourd’hui, le « copier coller ».
J’ai, par exemple, noté : arbres et branches tordues / vautours qui volent et se posent au sol / chemin de montagne descendant jusqu’au vallon / il marche dans la nature en battant bruyamment des mains… Le personnage principal traverse toutes les situations, comme s’il observait un paysage défilant par la fenêtre du train. Il éprouve des sentiments, par moments, et les exprime avec retenue, comme s’il était un témoin de passage. Mais tout au long du récit, on peut soupçonner le narrateur d’être lui-même, un peu tous les personnages de l’histoire, ou d’être en tout cas très proche des êtres qu’il croise. Et la femme qui descend l ‘escalier, celle à sa fenêtre qui se laisse distraitement caresser par un homme, ou celle dans le jardin, sont les différentes facettes de celle qu’il désire, et que cependant, il tient à distance.
J’ai donc choisi de n’avoir que deux personnages masculins, le narrateur et l’ami qui se déclare comme tel, et un seul personnage féminin, apparaissant sous divers traits, unique et multiple, énigmatique. […]
Dans la barque du Chasseur Gracchus
Patricia Reznikov
C’est un homme qui m’a présentée au Chasseur Gracchus. L’homme qui m’est cher. C’était il y a longtemps déjà, et depuis, mon regard sur la littérature n’a plus jamais été le même. Depuis ce temps, le Chasseur m’accompagne. Il est celui qui ne sait pas et qui sait. J’ai compris qu’il en était de même pour moi. Et pour nous tous, sans doute. Nous errons dans notre barque sans gouvernail, nous ne savons rien, nous savons. Nous allons de port en port et notre voyage est le fruit d’un malentendu, un merveilleux malentendu. Et nous tâchons d’écrire et de peindre quelque chose de ce voyage, pour témoigner de ce qu’il faut bien appeler une petite et grandiose aventure. Quelle plaisanterie est notre moteur, Quelle mélancolie ? A force de fréquenter le Chasseur Gracchus, ce mort si vivant, dérivant sans fin dans un entremonde qui ressemble tant au nôtre, j’ai deviné la présence d’un autre voyageur à ses côtés: un jeune homme du nom de Franz, un léger sourire aux lèvres et le regard incandescent. Sa présence fraternelle est trop intense, son regard difficile à soutenir. Il est l’auteur. Il est celui qui s’efforce de nous dire quelque chose. Il nous touche l’épaule et nous murmure: entre le bruit, la fureur et le rire, nous vivons ici, à Riva. Des bateaux venus du monde entier accostent à nos quais dans l’indifférence, sous les yeux de deux enfants qui jouent aux dés. De beaux pigeons nous apportent parfois des nouvelles que nous n’entendons qu’à peine. Et tour à tour, l’un ou l’autre d’entre nous, paré comme pour une cérémonie, accueille un chasseur perdu qu’un accident a jeté sur nos rives. Il faut savoir le recevoir, puis, le laisser repartir. Car il a été content de vivre et content de mourir. Dans la forêt allemande, il a fait le bien, il a fait le mal. Qui sait quel mal il y avait à cela ? Quel mal il y a à exister…
Écrire, peindre, nous nous y efforçons à notre tour. Vivre aussi. Ce voyage du Chasseur sur le grand fleuve est cette odyssée-là. Montons dans la barque. Il nous est donné de toucher du bout des doigts l’extraordinaire et puissant mystère de l’homme Kafka. Car Kafka nous hante. Et le Chasseur Gracchus nous hante avec lui. Plein de ses exploits passés, couchés sous son châle à fleurs, habillé de son seul suaire fané, il nous visite et nous entraîne. Est-ce que nous avons le choix ? Nous vivons, nous peignons, nous écrivons. Il y a dans tout cela quelque chose qui nous est une grande consolation. Relisez bien le conte: le voyage du Chasseur Gracchus ne s’arrête jamais.
|