
Rubens, portraits princiers, sous la direction de Dominique Jacquot, musée du Luxembourg / Réunion des Musées Nationaux - Grand Palais, 24o p., 35 euro.
Rubens, Nadeije Laneyrie-Dagen, Hazan, 32o p., 49 euro.
De Pierre Paul Rubens (1577-164o), on doit d'abord dire qu'il a inventé plusieurs choses essentielles dans l'histoire de l'art occidentales. Sans toutes les énumérer, rappelons qu'il a transformé la bottega issue de la Renaissance, c'est—dire le maître entouré par ses élèves, par une sorte de production industrielle, avec une foules d'apprentis de disciples, mais aussi des peintres affirmés, spécialisés dans un genre précis, comme Jan Brueghel de Velours pour les fleurs, Franz Snyders pour les natures mortes, ou Antoon Van Dyck, son ancien élève. Il a institué un système de travail collectif, non seulement pour les tableaux mais même pour les dessins ! Environ cinquante personnes travaillaient pour son compte dans sa grande demeure d'Anvers. La grande et superbe monographie de Nadeje Laneyrie-Dagen est une excellente introduction à son oeuvre titanesque. Il a excellé dans tous les domaines, profane ou religieux, et a laissé des tableaux d'histoire (des mythologies ou des scènes historiques) qui laissent sans voix. Sa méthode de travail « collectiviste » ne saurait explique cette magnificence longtemps méprisé au cours du XXe siècle (il n' y eut guère que Giorgio De Chirico a apprécié ses tableaux, mais aussi les pasticher après la dernière guerre, avec ironie, mais aussi respect et admiration). Il a réussi dans tous les genres imaginables sauf, lors de la dernière commande qu'il a reçu, quand il a tenté de créer une toile « ténébristes », sans doute aidé par un assistant pas tout fait la hauteur. Pour cette même commande, il a laissé pour la première fois quelques uns des artistes de son atelier signer leurs ouvrages. Pour comprendre Rubens, il fallait visiter, il y a quelques années, l'exposition organisée à la National Gallery de Londres présentant ses oeuvres de jeunesse. On pouvait y découvrir ses qualités (en particulier, le rendu des chevaux), mais aussi quelques unes de ses faiblesses, surtout sur des points d'anatomie. Mais, par la suite, surtout quand on examine ses grandes « machines » religieuses, parfois d'une dimension impressionnante pour voir qu'il mettait toujours la main ce qu'il signait, et le style de Rubens y était toujours d'une beauté extraordinaire. De plus, il était un metteur en scène fantastique, d'une inventivité étourdissante, et donnait à ses scènes bibliques ou représentations de la vie du Christ une incroyable intensité dramatique, par le jeu de mouvements complexes et d'équilibres obtenues à partir de contrapositions en porte-à-faux. La dynamique y était toujours sans défaut et, en même temps, génératrice d'une vivacité et d'une intensité de ses sujets, parfois alambiqués. L'analyse profonde qu'en a pu faire Laneyrie-Dagen est juste et bien ajustée, même si, malgré l'importance de l'ouvrage, elle a dû laisser de côté bien des aspects de sa création. C'est le résultat d'une profonde investigation d'historienne de l'art.
Comme l'exposition du musée du Luxembourg est entièrement dédiée aux portraits (domaine qui tient une place très importante dans son oeuvre), Rubens a inventé le portrait plus grand que nature. C'est surtout à Gênes, où il a peint les membres des familles richissimes de la République maritime surnommée alors la Superba, puissante et banquière de la couronne d'Espagne. Ces portraits qui faisaient plus de deux mètres de hauteur avaient pour but de magnifier les armateurs et banquiers de cette cité devenue une oligarchie. Van Dyck, qui a travaillé sa suite Gênes, a repris ce modèle alors inconnu ailleurs. Cette exposition se limite aux portraits royaux, ce qui laisse imaginer ce qu'il a pu entreprendre par ailleurs ! Mais les dimensions du musée n'auraient permis que d'offrir au visiteur que des échantillons de son talent. Ici, on peut prendre la mesure de ce qu'il a pu faire dans toute l'Europe. A la cour de Bruxelles, il a immortalisé l'archiduc Albert d'Autriche et l'infante Isabelle Claire Eugénie (on la voit dans un autre tableau avec un nain, dans un autre, en habit de clarisse), puis de l'archiduc Ferdinand. Il a réalisé plusieurs portraits de ces personnages, ce qui prouve qu'il avait déjà acquis une réputation d'excellence à toute épreuve. Il a peint le duc de Lerma et le cardinal infant Ferdinand, de l'infante Marie-Anne d'Autriche et le portrait équestre de Philippe IV, qui mesure plus de trois mètres ! Il a exécuté d'autres portraits du roi, en pied, la chasse, ou en compagnie de son épouse, Isabelle de Bourbon. En France, il a fait plusieurs portraits de Marie de Médicis (dont un portrait allégorique), puis peint le buste du jeune Louis XIII, puis l'a montré en différentes circonstances un tout petit peu plus âgé, et plusieurs versions de son épouse, Anne d'Autriche. En somme, Rubens a donné le goût aux puissants de ce monde de se faire représenter dans des postures diverses. Rubens a bien compris l'usage de la représentation des souverains en son temps et en a fait un instrument de pouvoir en plus que d'une exaltation esthétique de leur personne. Cette exposition et ce catalogue montrent une des grandes transformations de cette première partie du XVIIe siècle, où l'art se met de plus en plus au service de la politique tout en parvenant un degré d'excellence inouï. A ne manquer sous aucun prétexte.
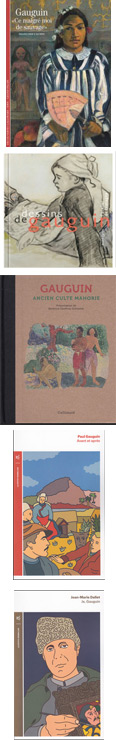
Gauguin, « ce malgré moi de sauvage », Françoise Cachin, « Découvertes », 196 p., 15,9o euro.
Paul Gauguin, dessins de Bretagne, André Cariou, Hazan, 140 p., 35 euro.
Gauguin ancien culte Mahorie, présenté par Bérénice Geoffroy-Schneiter, Gallimard, 96 p., 25 euro.
Avant et après, Paul Gauguin, préface de Jean-Marie Dallet, « La petite vermillon », La Table Ronde, 272 p., 8,7o euro.
Je, Gauguin, Jean-Marie Dallet, « La petite vermillon », La Table Ronde, 24 p., 8,7o euro.
Etrange destin que celui de Paul Gauguin (1848-19o3) ! Il a passé sa tendre enfance à Lima au Pérou puis, en France, il a été éduqué au petit séminaire dirigé par le père Dupanloup, puis au lycée d'Orléans. Il s'est embarqué sur un clipper en 1865, est devenu lieutenant et a navigué un an plus tard sur le trois-mâts Chili. Il a fait son service militaire dans la marine en 1868. Il appris part la guerre contre la Prusse en 187o. Il s'est marié avec une Danoise (dont il a eu cinq enfants) et a alors abandonné la carrière sur les mers pour devenir homme d'affaires. Il a été introduit dans le monde de l'art par son tuteur et il a connu Camille Pissarro en 1874 quand il s'était installé Rouen. Il est revenu Paris, ses affaires étant au plus mal. Il a commencé alors peindre et expose aux Indépendants entre 1879 et 1886. Déjà en 1882 il avait abandonné son état de courtier et a travaillé la céramique à partir de 1885. Un an a passé, et il est allé Pont-Aven où il a fait la connaissance d'Emile Bernard, qui l'initie au cloisonnisme. A son retour Paris, il a connu Van Gogh. Puis il a décidé d'aller Panama et a séjourné un temps la Martinique. Malade, il a dû rentrer en France. Cette existence, vous la découvrirez dans l'excellent livre de Françoise Cachin, qui nous offre la fois une biographie de l'artiste, mais au cours son parcours esthétique, qui a n'a pas été longtemps tributaire de l'impressionnisme. La découverte de la Bretagne a été pour lui une révélation : celle d'un monde « primitif » , qu'il a désiré traduire dans d'autres termes. Il est vite convaincu que « l'art est une abstraction ». La révélation de la xylographie japonaise l'a alors convaincu de la justesse de ses vues. Il en est sorti La Lutte de Jacob avec l'ange, qui est la première manifestation de ses vues synthétiques. Mais si l'on connaît bien les tableaux qu'il a exécutés à cette époque, on ignore souvent les magnifiques dessins qu'il a pu faire alors. Le livre d'André Cariou est important pour la connaissance de l'artiste car il montre deux choses essentielles : la maîtrise du trait qui est remarquable et ensuite son désir d'aller au-delà et de plier sa discipline aux sujets qu'il a traités - La Ronde des petites Bretonne est l'exemple parfait de sa façon de procéder -, d'un dessin parfait il est arrivé à une stylisation qui se rapprocherait de la culture de ce bout du monde. Ces dessins sont à la fois le témoignage de sa pensée de l'époque, mais aussi son laboratoire secret, qu'on a toujours mis de côté (comme d'ailleurs les dessins de Van Gogh, qui ont pourtant tant de choses à nous enseigner). En 1888, il est parti Arles avec Van Gogh. Mais le séjour s'est mal déroulé et l'un comme l'autre sont entrés dans une phase dépressive. Quand Gauguin a peint le portrait de Van Gogh, Van Gogh peignant des tournesols, ce dernier s'est écrié », « C'est bien moi, mais devenu fou ! » C'était peu avant le terrible épisode de l'oreille coupée. Rentré Paris, deux critiques très favorables écrites par Octave Mirbeau lui ont permis de faire une très bonne vente. Avec l'argent gagné, il a abandonné sa faille et est parti pour la Polynésie en 1891 et s'est d'abord installé Tahiti puis a connu d'autres îles. Sa quête l'a amené à s'éloigner toujours plus de la culture occidentale moderne. Les éditions Gallimard ont eu l'idée d'éditer en facsimilé un petit carnet de soixante pages, que Bérénice Geoffroy-Schnetter a commenté avec sobriété et justesse. Ses dessins et ses écrits prouvent quel point il a été fasciné par la culture de ce monde qu'il ne regardait pas comme primitif. Il l'a décrit autant qu'il l'a extrapolé dans sa peinture, mais aussi dans ses sculptures. Il a raconté ces années où il a parcouru le Pacifique dans un livre intitulé Noa Noa, (rédigé entre 1893 et 1894 et publié en 19o1 par Charles Morice) dont un extrait est inclus dans l'ouvrage de Françoise Cachin. Ce carnet est un petit bijou à nos yeux, mais c'est aussi l'expression de ce que Gauguin a perçu de cet autre monde qui l'a fasciné et de la façon dont il a pu le retranscrire dans son langage de peintre. En 19o1, quand il a choisi de vivre dans ce qu'il a appelé « la maison du jouir « dans l'île d'Hivaoa, il a écrit un livre de mémoires qui est splendide où il narre tout son passé d'artiste, ses jugements sur ses contemporains, sa pensée sur la peinture, ses sentiments sur la création, en somme tout ce qui a pu le frapper et le toucher dans son aventure de peintre. Pour conclure, Gauguin a écrit plusieurs livres qui nous disent beaucoup sur son histoire. Cela ne remplace, bien entendu, pas une biographie. Mais je dois dire que je comprends moins le intention de Jean-Marie Dallet quand il a écrit Je, Gauguin, où il imagine le peintre en train de se remémorer avec précision son existence (soit dit en passant, il ne le fait pas mal du tout). L'auteur a voulu faire parler ce mort excellent. Mais cela a-t-il un sens ? Pourquoi n'a-t-il pas plus simplement écrit une biographie au plus près de ce qu'a réellement été Gauguin ?
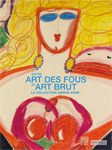
Entre art des fous et art brut, la collection de Sainte-Anne, MAHHSA / Somogy Editions d'Art, 16o p., 22 euro.
Cette sélection d'oeuvres ne fait que renforcer l'idée reçue que l'art et la folie ont quelque parenté. Il faut d'ailleurs souligné que ce beau catalogue est classé par auteurs, d'aucuns étant donc reconnus comme des artistes part entière, ce qui n'est pas posé un problème. Mais il convient aussitôt de dire que l'évolution récente des pratiques artistiques ont fait que les artistes les plus corrosifs des décennies passés n'ont pas hésité se rapprocher de plus en plus des arts dits primitifs et des formes torturées ou bizarres des aliénés. De là est né cette confusion des genres qui est gênante mon sens. Par exemple, prenons le cas de Louis-Emile Gros-Brun : ce qu'il a peint est drôle et original, loin d'être déplaisant, mais ce n'est pas le Douanier Rousseau !
Et Aloïse Corbaz a été élevée au rang de grande prêtresse de cet art brut que Jean Dubuffet a collectionné et fait reconnaître comme art au plein sens du terme, sans doute pour donner une légitimité son propre dessein. Je ne peux pas la ranger dans la même catégorie que les autres artistes, sinon dans celle de ces créateurs, comme Appel ou Basquiat ou Dubuffet (parmi tant d'autres) ont cherché leur inspiration dans ces expressions déviantes. C'est vrai que la confusion des genres est possible. Mais elle devient embarrassante. Cela peut finir par donner raisons aux personnes réactionnaires qui regardent les artistes comme des fous puisqu'on conçoit sans détours que les fous sont leur tour des artistes au plein sens du terme ! Moi, je veux les voir tels qu'en eux-mêmes, avec cette étrange beauté qui émane de leurs formes maladroites et de leurs dessins extravagants et surtout de leur insondable étrangeté. Certains d'entre eux auraient pu figurer dans le groupe surréaliste, comme Antonio Bragança ! Donc ce livre est merveilleux parce qu'il nous fait connaître ces créateurs de l'autre côté de la ligne rouge de la raison, et aussi parce qu'il nous contraint nous interroger sur l'art de notre temps, qui a été emporté sur aussi au-delà de cette ligne-l, mais pas toujours pour de bonnes raisons. Aujourd'hui l'infantile et l'insensé sont devenus les clefs pour entrer dans le vert paradis de la reconnaissance artistique, comme l'a été d'ailleurs l'imitation du « primitif ». Aujourd'hui c'est la bande dessinée qui est l'ordre du jour ! Au fond, l'art n'a de valeur qu'à partir du moment où il est dévalorisé. A force d'avoir condamné le trop bien fait des artistes pompiers, nous sommes arrivés donner naissance un autre art pompier, qui doit être celui d'un fol !

La Trilogie, Ralph Gibson, texte de Gilles Mora, Hazan / Pavillon populaire, Montpellier, 2oo p., 35 euro.
Ralph Gibson est né en 1939 Los Angeles. Il a appris la photographie l'école navale Pensacola (Floride). De l est venu son amour de la photographie et son désir d'en faire son métier. Il s'installe San Francisco en 196o et devient l'assistant de Dorothea Lange. Il fait sa première exposition personnelle à la galerie Photographer's Roundtable, le plus cotée de la ville. Un an plus tard, il passe un format plus petit (24 x 26 cm), qu'il n'abandonnera plus. Il travaille dès lors dans le reportage et mène une carrière en indépendant. Mais il obtient quelques contrats intéressants, dont celui avec la Cinerama Corporation qui collabore à la préparation l'Exposition universelle de New York en 1964. Il s'installe New York en 1966. Grand lecteur, il est inspiré par les surréalistes et son premier recueil, The Somnambulist, qui paraît en 1969, dans sa propre maison d'édition, Lustrum Press, est fortement influencé par l'onirique que ses créateurs avaient préconisé. Mais il le fait sans référence directe l'art surréaliste, ce qui fait de son recueil une oeuvre profondément originale. Il a choisi de le réaliser en noir et blanc. Le recueil connaît un certain succès et il est reconnu bien que son travail surprenne ses pairs et ses contemporains. Il voyage alors en Europe, participe de nombreuses expositions, obtient des prix. En 1973, il publie Déjà vu, le second volume de sa Black Trilogy. Il y accentue le style qui l'a caractérisé dans l'ouvrage précédent, en en allant contre-courant du formalisme et même du réalisme classique désormais dans le monde de la photographie. Ce qui ne l'empêche pas de faire de remarquables portraits et aussi de choisir des prises de vue très constructivistes. Il veut se sentir entièrement libre dans sa manière de faire. Deux ans plus tard, il fait paraître Days at Sea. Il ne cesse là encore de transgresser les codes, faisant des clichés décalés, presque flous, un peu comme les photographies ratées des amateurs. Il aime déconcerté et sortir de l'idéal de la grande photographie américaine. Il joue avec son appareil et retient des vues que tout grand professionnel aurait rejeté. Il produit ensuite d'autres recueils comme L'Anonyme, Aperture, en 1986. Tropism sort un an plus tard. Iconoclaste par excellence, Ralph Gibson s'est fait un nom et est parvenu à trouver sa place dans ce cercle très fermé. Sa célébrité a rapidement gagné l'Europe. Cette exposition et ce catalogue permettent de découvrir l'intégralité des volumes de sa grande trilogie, qui est celui d'un homme libre de toute contrainte formelle. C'est une figure incontournable de cet art qui s'est imposé comme tel depuis la fin du XIXe siècle.

Félicien Rops, 1o ans de recherche au musée Rops, Somogy Editions d'Art, 24o p., 32 euro.
Ce livre présente différents aspects de la personnalité et de l'oeuvre de Félicien Rops (1833-1898). Il s'adresse donc des personnes qui ont déjà une idée de ce qu'il a pu réalisé dans son existence. Les néophytes n'y trouveraient pas leur compte. En revanche, tous les amateurs de cet artiste si bizarre, dont l'érotisme est une marque de fabrique obsédante et d'une grande puissance, pourront y puiser des informations très précieuses. Il y a pas exemple un essai d'Eszter Földi qui évoque les deux voyages que l'artistes a effectué en Hongrie en 1879 et en 1885. Il convient avant toute chose de savoir que l'artiste s'est imaginé de lointaines origines hongroises. Plus le temps passait, plus cette fantasmagorie s'est enracinée en lui. Il a ramené de ses périples des dessins, une correspondance, mais aussi des tableaux de paysages. Lors de son premier voyage, Rops accompagna une commission française menée par un député. Tout ce petit monde est arrivé par bateau Budapest. Il en rapporta des vues surprenantes, avec des territoires paraissant illimités et parfois des figures aussi mystérieuses que graves. Adrienne Fontanas nous fait connaître un éditeur important pour Rops, Edmond Demain, qui a fait travailler un certain nombre de peintres pour ses livres. Mais le plus curieux de l'affaire est que Demain a acheté un grand nombre d'oeuvres de l'artiste (beaucoup de gravures et aussi des autographes), mais l'a assez peu fait travaillé, bien qu'il lui ait fait de nombreuses propositions. Il publia néanmoins La Lyre, une héliogravure et pointe sèche destinées aux Poésies de Stéphane Mallarmé, mais l'idée d'illustrer deux livres de Camille Lemonnier ne s'est pas réalisée. Pas plus d'ailleurs que celui des Fleurs du mal de Baudelaire (ce travail est confié Odilon Redon) et encore moins celui des écrits d'Erasme (là, c'est Rops qui est réticent). Quant Alexia Bedoret, il nous parle des escapades de l'artiste sur les bords de la Meuse, où il fait partie d'un club nautique. Il s'est beaucoup intéressé aux sports sur l'eau et a pris part des régates. Un autre auteur, Denis Laoureux examine ses relations avec les institutions artistiques. Il s'est opposé vigoureusement aux institutions les plus rétrogrades et a par contre contribué la naissance de groupes plus ouverts et plus novateurs comme la Société libre des beaux-arts en Belgique, qui a organisé des expositions. En outre, il n'hésitait pas un instant prendre la plume pour fustiger les esprits réactionnaires dans L'Art libre et L'Art universel, D'autres chapitres traitent de ses rapports avec Auguste Rodin ou avec Gustave Doré, sur sa conception de l'illustration. Ce volume est une mine d'or pour les amateurs de ce merveilleux et inconfortable artiste ! Ils découvrons de quoi assouvir leur curiosité.

Flora japonica, Masumi Yamanaka & Martyn Rix, 24o p., 35 euro.
Pour les Japonais l'art floral est un art majeur. On sait de surcroît que les Japonais vouent un culte de la nature et en particulier aux fleurs. La floraison du cerisier est un jour de fête nationale dans leur pays. Ce livre superbe est composé de deux parties. La première est de caractère historique puisqu'elle présente la découverte de la flore locale par les savants occidentaux. Il existait une grande peinture florale japonais, qui s'est surtout affirmée au début de l'ère d'Edo et s'est vraiment épanouie au cours du XVIIIe siècle, avec Konoe Iehiro ou Kanô Tanyû. Leurs estampes sont non seulement d'une précision graphique impeccable, mais aussi d'une réelle beauté. Il faut aussi savoir que la perspective médicale a été largement diffusée par le livre et que le monumental ouvrage en 48 volumes de Ranzan, le Honzô Kômochu Keimô (traduit par Compendium dicté de Materia Medica). Ce même maître a réalisé hui volume de Kaï, c'est—dire du langage des fleurs (en noir et blanc). Cette oeuvre colossale a été ensuite illustrée en couleurs dans une version en 96 volumes en 1828 et a été intitulée Honzô Zufu. Il y avait 2.ooo illustrations. Elles ont été en partie inspirées par les livres de botanique européennes, en particulier l'Illustrierte Flora von Mittel-Europa de Gustav Hegl. Les artistes étaient pour la plupart des membres du Shabenkai, des élèves de Ranzan ou de Tani Bunchô Iwasaki. Ils avaient eu aussi connaissance de la Phytantoza Iconographia de J. W. Weinmann( 1813). Par la suite, ce travail sur la botanique s'est développé à Nagazaki où pouvaient aborder les navigateurs étrangers et était donc le seul lieu d'échange avec le monde extérieur. Le grand savant néerlandandais Seibold a séjourné alors Deshma (entre 1823 et 1829) et il a voulu travailler avec Keiga pour réaliser des planches. Il l'a formé et en a fait le premier peintre botaniste du Japon qui oeuvra dans une optique occidentale. Cette période a été très fructueuse et plusieurs artistes ont développé leurs connaissances à Edo (Tokyo) au milieu du XIXe siècle. Les auteurs nous décrivent ensuite les développement de cet art spécifique la fin de l'ère Meiji et les décennies qui suivirent. Le reste de l'ouvrage nous propose des planches modernes d'une grande beauté, chacune faisant l'objet d'un commentaire détaillé sur la fleur considérée. Inutile de dire que ce livre est précieux pour le botaniste en premier lieu, mais aussi pour tous ceux qui aiment l'immense univers de la flore.

René Goscinny, au-delà du rire, sous la direction de Anne Hélène Hoog, MAHJ / Hazan, 3 p., 35 euro.
Dans mon enfance, c'était Tintin qui régnait en maître une fois passé l'âge des personnages de Walt Disney. Mais d'autres figures légendaires sont apparues dans le périodique Pilote. Astérix et son célèbre village d'irréductibles Gaulois se sont imposés dès le début, en 1959. Le succès a été très grand dès le début car il parlait avec un humour un peu balourd de ceux qu'on nous faisait passer l'école pour nos ancêtres (c'est en réalité une invention de Napoléon III qui vouait un culte Vercingétorix comme on peut le voir sur le site d'Alésia avec cette gigantesque statue célébrant celui qui avait pu fédérer tous les peuples des Gaules). Les quelques Celtes qui résistent à l'occupant romain et font la nique à Jules César ressemblent beaucoup au Français moyen de l'époque. Les gamins se sont identifié au petit héros et ont adoré ses aventures. Leurs parents se sont laissés conquérir. Et aujourd'hui encore les volumes qui sortent après la disparition de René Goscinny. Le musée d'Art et d'Histoire du judaïsme à Paris semble avoir fait une spécialité des hommages aux grands créateurs de bandes dessinées ! René Goscinny mérite amplement cet hommage car il a inventé une foule de héros qui ont charmé des générations d'enfants, comme Lucky Luke, qui a paru dans le magazine belge Spirou, a connu une fortune presque identique en un temps où l'on allait voir les westerns américains. Avant cela, il avait imaginé une série incroyable de personnages qui n'ont pas eu de suite (comme Dick Dicks, ou ceux de Jolly Jungle, le capitaine Bibodu, sans oublier Pistolin). Il a changé de style plusieurs fois, mais toujours tenu la grande simplicité du dessin comme on le voit dans les histoires de Modeste et Pompon ou d'Alphonse détective. Après tant de tentatives, toute n'ayant pas été vouées à l'échec, mais qui n'ont jamais duré longtemps, après avoir créé Oumpah-Pah le peau rouge, il finit par connaître la gloire avec son cowboy qui tirait plus vite que son ombre et Obelix qui était tombé dans la marmite de potion magique. Toute son histoire est racontée dans le détail dans ce beau catalogue, qui montre que Goscinny, bientôt secondé par Uderzo, avait la faculté de produire des figures et des scénarios nouveaux sans se décourager. Son humour n'est pas toujours d'une finesse absolue, mais est très efficace car il a su comprendre la mentalité de ces Européens qu'il a découvert après la dernière guerre, puisqu'il n'a connu que l'Argentine et puis les Etats-Unis. Et sa collaboration avec Sempé a donné naissances aux Aventures du petit Nicolas dont on n'ignore pas la fortune... Goscinny est un monument dans la bande dessinée. Personne ne saurait le nier.

Drames antiques, Franz Grillparzer, traduits de l'allemand et présentés par Gilles Darras, Les Belles Lettres, 416 p., 29 euro.
Franz Grillparzer (1791-1872) est bien méconnu en France et son oeuvre dramatique (en dehors de ses pièces, il n'a écrit que des nouvelles) et je dois reconnaître que je n'ai jamais eu la possibilité de voir une de ses pièces montées sur une scène française. C'est pourtant l'un des plus grands auteurs autrichiens. Son nom ne nous est pas inconnu car il apparaît sous la plume de Nietzsche, sous celle de Stefan Zweig, et pour les auteurs les plus récents, par W. J. Sebald et Claudio Magris. Il est aussi devenu un personnage de Sacher Masoch ! Il faut donc saluer la publication de trois de ses oeuvres aux Editions des Belles Lettres : Sappho, La Toison d'or, les Vagues de la mer et de l'amour. Elles ont toutes été écrites en 1818 et 1831, donc au cours de la première phase de sa création. Il est indispensable ce point de savoir qu'il ne s'est pas exclusivement intéressé l'Antiquité classique. Il a traité des sujets d'un tout autre ordre, comme Libussa (1848) ou la Juive de Tolède (1855). Sa première pièce s'intitulait Blanche de Castille (écrite entre 18o7 et 18o9). Il est aussi l'auteur de l'oraison de Ludwig van Beethoven. Grillparzer n'a pas écrit que des drames, mais le public viennois n'a guère goûté ses comédies, auxquelles il a dû renoncer. Il a été profondément influencé par le théâtre espagnol du Siècle d'or. Ce qui a donné ses créations une orientation très curieuse pour son époque. Il n'avait pas peur des excès, des rebondissements fracassants, des scènes violentes et sanglantes, d'une exubérance dans sa manière de développer une intrigue, le plus souvent mythique ou historique. Le dramaturge a aussi chez lui un rejet de la rhétorique théâtrale, comme le montre bien Sappho, qui est écrit sur un ton sinon badin, mais tout du moins simple et presque familier. Il a voulu abolir cette grande frontière culturelle avec le monde ancien et abolir du même coup cette distance avec ces histoires issues de la culture vénérée des Grecs et des Latins (il ne faut pas non plus oublier qu'il a produit toutes ces oeuvres une époque où l'héritage de Winckelmann et du néoclassicisme pesait encore de tout son poids). Dans cette pièce, il n'a pas oublié la leçon de Goethe (la référence Torquato Tasso est évidente), ni celle de Lord Byron. Il ne se révéla pas être un briseur d'idoles ni un novateur tout crin, mais il cherchait un langage nouveau pour traduire cet univers lointain dans des termes contemporains. La Toison d'or (qui est en fait une trilogie) a pu voir le jour en 1821 sur laquelle il avait travaillé deux ans avec une interruption due à une grave crise intérieure. Il y a introduit des sentiments puissants, démesurés, un peu comme on peut le voir dans le théâtre de Sénèque (il a d'ailleurs écrit comme lui une Médée). Mais il a continué écrire ses drames avec ce style dépouillé et simple, mais néanmoins noble et captivant, qui le rend si proche des spectateurs. Il ne singe pas les grands auteurs classiques comme Sophocle ou Eschyle. Quant aux Vagues de la mer et de l'amour, la dernière de ses tragédies antique, c'est un échec cuisant quand elle est créée au Hofburgertheater en 1831. Il se tourna alors vers des drames historiques, s'intéressant en premier lieu au destin du roi Ottokar II de Bohème. Ce qui est remarquable dans les pièces de Grillparzer, c'est qu'elles peuvent se lire et qu'il n'est pas besoin que des acteurs l'interprètent pour que nous puissions les comprendre. Ce livre est donc l'occasion unique de combler une lacune sérieuse dans notre connaissance de la littéraire de langue allemande.

Tempête, J. M. G. Le Clézio, Folio, 272 p., 7,2 euro.
Quand Le Clézio a obtenu le prix Renaudot en 1973, je me souviens du reportage que Paris-Match avait fait le montrant en maillot de bain sur la plage de galets à Nice. Le livre primé, le Procès-verbal, a fait jasé autant que son beau physique de jeune homme athlétique ! Je l'ai lu plus tard et n'ai pas été frappé par cette oeuvre. Par la suite, j'ai lu au fil du temps d'autres ouvrages de lui, dont, par exemple, la Guerre, Désert ou le Chercheur d'or. Tous ces livres sont on ne peut plus plaisants, mais il leur manque ce je ne sais quoi qui en aurait fait de grandes oeuvres qui restent gravées dans la mémoire. Le Clézio est un écrivain appliqué, modéré et aussi charmeur qu'a pu l'être, pour d'autres raisons, Saint-Exupéry. L'aventure joue un grand rôle dans sa littérature, mais une aventure un peu onirique et surtout sans rien de choquant ou de brutal. Ces deux novellas sont elles aussi charmante, légères, fluide, d'une lecture reposante. Elles ont leur beauté, mais ne possèdent cette force qui aurait pu les rendre prenantes, bouleversantes et surtout inoubliables. Il s'est placé dans la perspective d'une littérature dans la haute tradition française du siècle dernier chez Gallimard l'époque de Gide. Il a du style et sait bien monter et développer ses intrigues. Il est remarquable en tous points, mais il n'est pas remarquable dans l'absolu. Et puis ces petites fables exotiques manquent vraiment de force. C'est le modèle de l'écrivain qui a atteint un genre de perfection formelle, mais qui ne suscite aucun grand sentiment, de quelque sorte qu'ils soient. Je ne peux pas dire que je n'ai pas pris de plaisir lire « Tempête » et « Une femme sans identité », mais aucune des deux nouvelles ne m'ont transporté, malgré ses efforts louables de forger une personnalité curieuse et étrange de ses deux personnages. C'est la question que soulève toute son oeuvre. Jean-Marie Le Clézio incarne cette tradition littéraire française qui est admirable et fade à la fois.
|
