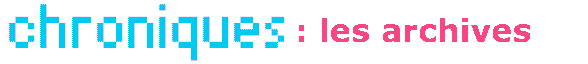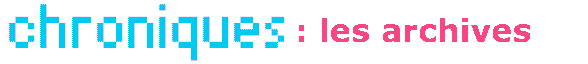| Du passé faisons table rase… |
Comment l’art devient l’Art dans l’Italie de la Renaissance,
Edouard Pommier, «Bibliothèque illustrée des histoires», Gallimard. |
Je dois le dire d’entrée de jeu : l’essai d’Edouard Pommier, Comment l’art devient l’Art, est indubitablement le meilleur ouvrage sur la Renaissance qui ait été publié depuis longtemps. Il ne nous apporte rien de nouveau et ne se lance pas dans une interprétation audacieuse et risquée, pour ne pas dire acrobatique. De facto, il s’est emparé des connaissances accumulées sur la question et parvient à les orchestrer et, par conséquent, à les disposer dans un ordre tel qu’il nous donne la possibilité de comprendre de quelle manière les artistes ont pu sortir de leur condition subalterne pour devenir les grands acteurs de la Renaissance italienne, en particulier à Florence. Dans le premier chapitre, il explique très bien (et très clairement) que ce sont les poètes (Dante, Boccace et Pétrarque) qui ont modifié le statut de l’artiste.
Parallèlement des « triomphes » sont organisés pour célébrer l’accomplissement d’une oeuvre d’art, comme ce fut le cas pour la translation du retable de Cimabue en 1240. Avec une patience de bénédictin et aussi beaucoup de talent, Pommier remonte le puzzle du Rinascimento pour en donner le mouvement d’ensemble, tout en éclairant d’une manière originale la surenchère culturelle qui a lieu pendant cette période de retour à l’Antique pour jeter les fondements d’une modernité politique, économique et intellectuelle. Et ce n’est pas la moindre de ses qualités, cet ouvrage ne concerne pas que les seuls spécialistes. |
Mondes lointains et imaginaires,
Francesca Pellegrino «Guide des arts», Hazan. |
Peut-être eût-il mieux valu séparer complètement ces deux domaines, même si, de l’Antiquité classique à la Renaissance, ils s’interpénétraient à loisir. Mais il est tout de même déroutant de voir des articles concernant Les Indiens précolombiens, Marco Polo, les volcans, les Juifs, les dangers de la mer, l’orientalisme, le japonisme, les chinoiseries, et que sais-je encore, avec les Argonautes, l’enlèvement d’Europe et la Jérusalem céleste. Bien sûr, on peut considérer cet ouvrage comme un grand puzzle. C’est le meilleur parti à prendre. Mais on a tout de même l’impression de nager le plus souvent en eau trouble. Il n’en reste pas moins une documentation tout à fait utile et parfois passionnante pour comprendre l’art du voyage dans ces temps révolus.
|
La Galerie des glaces,
Jacques Thuillier, «Découvertes», Gallimard. |
Cet ouvrage de Jacques Thuillier paraît alors que la galerie des Glaces du château de Versailles vient d’être rendue au public. Fruit de la collaboration de Mansart et de Charles Le Brun, ce vaste programme décoratif achevé en 1674 avait pour but de présenter au monde une création spectaculaire avec pas moins de 357 miroirs. Et c’était aussi un plafond comportant un programme iconographique. A l’origine, le peintre voulait exalter le Roi-Soleil. Mais son rival Mignard réalisa un projet de ce genre avant lui à Saint-Cloud et Le Brun dut penser à autre chose : il opta pour les grandes batailles ayant marqué le règne de Louis XIV. Ce superbe ensemble a repris vie au terme d’une restauration longue et complexe. Peut-être finira-t-on par réhabiliter Le Brun ? |
Odilon Redon et le Messie féminin,
Suzy Lévy, Editions du Cercle d’Art. |
Odilon Redon a eu une place particulière dans l’art de la fin du XIXe siècle. Suzy Lévy le considère comme un marginal. C’est peut-être là porter un jugement excessif et simplificateur, car il a pleinement participé à l’art de son temps. Elle souligne d’ailleurs qu’il a très tôt attrapé la maladie du japonisme et subi aussi l’influence d’Emile Bernard, si bien que le mysticisme devient un peu son pain quotidien. Mais Edgar Poe a aussi pris pied dans son univers intérieur et le modèle. À mesure que les années passent, il s’éloigne de plus en plus des préoccupations de ses contemporains. Il a aussi pris le virus de la gravure et du dessin en noir et blanc. C’est le noir qui guide ses pas et tout ce qu’il crée de puissant en sort. L’auteur de cette monographie a eu le mérite rare de montrer toutes ces influences ; il s’est forgé un objectif qui se situe à mi-chemin entre le visible et l’indicible. Suzy Lévy a mis l’accent sur sa fascination pour l’occultisme et les milieux qui se sont passionnés pour la question. Peut-être trop. Mais il n’en est pas moins vrai que son étude est un bon moyen pour mieux connaître cet artiste qui transformait en oeil un ballon dirigeable. |
| A la recherche de la modernité perdue |
Max Ernst, vie et oeuvre,
Werner Spies, Centre Pompidou. |
Werner Spies a choisi d’être le spécialiste universel de Max Ernst. Il a déjà organisé des expositions et écrit des livres à son sujet. Il vient de produire un bel ouvrage qui concerne la vie de Max Ernst, une sorte de biographie à travers de très nombreux documents, des lettres, des autographes et des textes de l’artiste, mais aussi des photographies et des reproductions d’oeuvres. Comme toujours, c’est la période dadaïste de Cologne qui se révèle la plus passionnante. Il suffit de lire le bref pamphlet qu’il a commis sur Cézanne. C’est le moment où il montre le plus d’originalité et de liberté, mais aussi de mordant. Ses dessins et ses collages sont construits avec une curieuse méticulosité qui renforce leur charge critique et blasphématoire (enfin, par rapport à la sainteté de l’art entretenue par les symbolistes). Le surréalisme va lui offrir de déployer un univers onirique que, parfois, il a décliné de manière abusive. Ses forêts enchantées finissent par devenir des gouffres de répétition. Quoi qu’il en soit, ce volume offre au chercheur comme à l’amateur une somptueuse source d’information. |
De la mélancolie,
Gallimard. |
La mélancolie est désormais un sujet à la mode. Le succès de l’exposition de Jean Clair n’y est sans doute pas pour rien. C’est d’ailleurs lui, avec Robert Kopp, qui a réuni les différents spécialistes qui ont participé à ce colloque qui a eu lieu à la Fondation des Treilles. L’intérêt des intervention est très divers. A commencer par celle de Kopp sur le spleen baudelairien, qui n’apporte pas des éclaircissements fondamentaux sur le sujet. En revanche, on peut lire avec profit l’étude d’Hélène Prigent qui compare la mélancolie païenne et l’acédie chrétienne au Moyen-âge. Quant à Jean Clair, il nous surprend une fois de plus en comparant les visages sculptés de Giacometti avec la représentation de la face humaine selon Emmanuel Lévinas.Toujours retors et subtil, il réussit à entortiller un raisonnement théorique d’une belle efficacité. |
Yves Tanguy, l’univers surréaliste,
sous la direction d’André Cariou, Somogy. |
De quoi se souvient-on le plus quand on évoque le peintre Yves Tanguy ? Du jeune homme coiffé à la diable qui place toute son originalité dans un rôle comique (c’est ce qu’on peut penser en voyant la photographie de Man Ray) ou de l’auteur de tableaux où, dans un espace désolé, se dressent de très étranges volumes biomorphiques ? L’importante exposition présentée au musée de Quimper aura sans doute permis de faire un bilan de cette oeuvre. Après la période fervente des dessins automatiques, il s’essaie à différents styles puis s’engage dans une voie qui ne conserve presque plus aucun lien avec la réalité : c’est L’Anneau d’invisibilité (1926). C’est sans doute le moment le plus heureux de son histoire picturale. Après quoi, il s’enferme, dès 1929, dans un type de représentation abstraite (c’est presque un paradoxe), avec une ligne d’horizon pour donner un volume précis à l’espace où ont lieu des relations bizarres entre des objets improbables. Bien sûr, il va évoluer au fil des années, mais sans jamais modifier le dispositif régissant son univers. Il faut attendre les années cinquante pour que ses paysages prennent une vague mais profonde connotation minérale (je pense par exemple à Multiplication des arcs, 1954). Breton, dans le texte qu’il lui consacre en 1942 souligne, en espérant dissiper un malentendu : « Et d’abord coupons court à toute équivoque en précisant que nous sommes avec elles non pas dans l’abstrait mais au coeur même du concret ». Le catalogue qui accompagne cette exposition est une véritable somme et donc un instrument de travail utile et aussi une belle réalisation éditoriale. |
|
En 2005, Gerard Verdijk s’est éteint à La Haye. Un hommage est alors organisé au musée de Dordrecht aux Pays-Bas. Et puis une belle monographie est publiée pour remémorer son parcours – un parcours qui n’est pas ordinaire puisqu’il ne semble entrer dans aucune catégorie établie ces dernières décennies. Verdijk a beaucoup dessiné. C’était peut-être même la basse continue de sa démarche. Ses dessins n’étaient pas des esquisses préparatoires, mais des oeuvres qui valaient en elles-mêmes. Il ne suivait pas un fil rouge, mais des intuitions et des émotions, des pensées fugaces qu’il saisissait au vol. Ils prenaient parfois l’aspect de pages d’écriture, quelque chose entre la peinture chinoise et l’écriture automatique, entre Michaux et Tobey. Dezeuze en a apprécié la « démarche vigoureuse » de dessinateur. Dans des compositions antérieures, il avait déjà utilisé les lettres comme éléments principaux de la composition, à l’égal de Giacomo Balla, mais dans une tout autre perspective. Sans doute y a-t-il réglé des comptes compliqués avec l’écriture. A la fin de sa vie, ses peintures avaient pris un caractère évanescent, avec figures vagues ou des couleurs qui s’évanouissent, aussi avec une relation tendue, douloureuse au noir. Quant à la sculpture, elle s’affirma surtout comme un jeu entre différents éléments empruntés. Mais ses oeuvres en trois dimensions ne sont pas des assemblages, mais bien plutôt des compositions qui ont beaucoup affaire avec les jardins zen et, plus généralement, avec l’art du paysage extrême-oriental. Toutefois, ces objets réunis, arrachés à la nature ou dérobés à l’activité des hommes, avaient à la fois une dimension dérisoire et une dimension critique, une once de poésie et un pouce de philosophie. Car aucune d’elles n’entretenait avec le monde une relation simple ou même contradictoire. Elles possédaient un ton ludique, un rien dérivé de dada, avec un humour tragique, réalisées avec des matériaux pauvres, surannés ou mis au rebut. Leur gravité n’avait d’égal que leur refus de l’esprit de sérieux. |
|