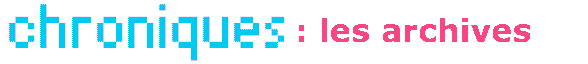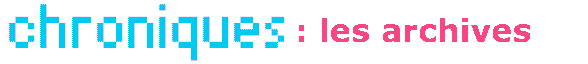UN ROMAN ÉLECTORAL
(ÉVIDEMMENT)
Et si on n’y allait pas ? Si, hésitants, à moitié mécontents des choix qui nous étaient laissés, nous usions de l’arme électorale atomique : le bulletin blanc ? C’est ce qu’imagine José Saramago dans La Lucidité (1). Le roman commence dans un bureau de vote de quartier où les électeurs tardent à venir – la pluie peut-être – puis on passe au dépouillement des bulletins, ici et dans les autres bureaux, où l’on découvre avec stupeur que les quatre cinquièmes des électeurs ont rendu un bulletin blanc. Le deuxième tour, organisé pour réparer, ne fait que confirmer ce premier choix – ou non choix plutôt. Le roman racontera les réunions du gouvernement qui, scandalisé, paranoïaque et pervers, pose des bombes dans le métro pour faire croire à l’existence d’un groupe terroriste, puis quitte la ville avec armée et policiers et la met en état de siège. Quelqu’un envoie une lettre de dénonciation: la femme qui n’avait pas perdu la vue lors de l’épidémie d’aveuglement quelques années plus tôt (sujet de l’un des précédents romans de Saramago 2), doit avoir un rapport avec cette nouvelle forme de cécité. Le ministre de l’intérieur envoie trois policiers faire une enquête secrète, avec pour mission implicite de trouver de quoi condamner la femme. Ici on touche un des points forts du roman : le gouvernement ne commente jamais les votes blancs autrement que par un discours attendu (restaurer la démocratie, redevenir des citoyens responsables), mais il agit avec la plus grande perversité, comme s’il se savait de quelque manière coupable d’avoir provoqué ce vote et nageait donc en pleine mauvaise foi.
Il y a toujours trois types de personnage dans les romans de Saramago : le plus habituel, le personnage qui, doté d’un nom et d’un caractère, agit sur le devant de la scène ; le narrateur, qui est une vraie voix, susceptible d’intervenir de temps en temps en son nom propre; et la collectivité, ici, les habitants de la capitale.
Trois entités très singulières: le narrateur, singulier au moins parce qu’il donne une consistance à la voix de l’auteur. Cela a l’air banal, dit comme ça, mais ça ne l’est pas vraiment. Je ne connais pas tant d’auteurs dont la voix se fait entendre dans chaque roman, parfaitement reconnaissable (son humour, sa légèreté grave, son air de conteur – difficile de parler d’une voix) et aimable comme une vieille connaissance sympathique. Les personnages, eux, ont ceci de particulier que leur mode d’intervention est presque tout entier contenu dans des dialogues. Et ceux-ci sont écrits d’une manière, toujours la même, à laquelle on reconnaît Saramago: pris dans le cours du récit, ils s’enchaînent par des virgules et des majuscules (qui ne servent dans le texte qu’à cela, à désigner une prise de parole, et qui ne sont donc pas employées aux endroit habituels), créant un effet… de mélopée peut-être. L’image (bizarre j’en conviens) pour le décrire serait peut-être aussi celle du cinéma : quand on s’assied très près du grand écran, l’image a un effet plus enveloppant, plus envoûtant.
Enfin la représentation de la collectivité prend dans ce roman une dimension singulière – mais c’est après tout un roman au sujet politique. Le collectif est en effet ici un personnage, agissant comme s’il était mu par une volonté générale. C’est d’ailleurs le propos du roman : soudain, tous les habitants de la ville (83%) adoptent la même attitude à l’égard du vote, à l’égard des bombes, des fuyards etc. Devant chaque événement, la ville réagit comme un seul homme. Et elle réagit bien: le peuple, dans ce roman, a un instinct sûr et une énergie toujours tournée vers le bon et le bien, ce qui lui permet de déjouer toutes les machinations du gouvernement. C’est d’ailleurs un des plaisirs de cette lecture, que la foule soit toujours, mystérieusement et unanimement, un personnage moralement impeccable. La fiction nous attrape aussi comme cela parfois: par le déploiement délicieux d’une histoire et de personnages résolument positifs.
On aurait tendance à croire le narrateur lorsqu’on se souvient, lecture achevée, qu’il a dit (p. 201): «Il est difficile de donner à telle ou telle question une réponse susceptible de satisfaire entièrement ce lecteur. Sauf si le narrateur avait la franchise insolite d’avouer qu’il n’avait jamais été très sûr de la façon de mener à bon terme cette histoire inouïe d’une ville qui a décidé de voter blanc… » La deuxième partie du roman, les policiers enquêteurs, l’issue (plutôt pessimiste quant à la politique, mais cela n’assombrit pas la vision des hommes proposée par le roman), agréable en elle-même, me donne un peu l’impression d’un bricolage narratif. Reste qu’on y trouve quand même deux sources de plaisir intense : l’une, capitale dans toute fiction, tient à la capacité de changement de l’inspecteur principal. Venu comme émissaire de l’infâme ministre de l’intérieur, il découvre peu à peu que la femme dénoncée est une personne très estimable, et il change progressivement de camp, en refusant d’inventer un motif d’arrestation. Nous venons de connaître ce contentement qui naît de la vision d’un méchant qui devient bon et qui sauve, dans le magnifique film, La vie des autres, dans lequel le commissaire de la Stasi (est-allemande), en écoutant et en suivant la vie d’un couple suspecté, change et finit par essayer de les sauver. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant et sans doute de très constitutif du plaisir de la fiction, dans l’idée du personnage se réinventant meilleur sous nos yeux.
Le deuxième chose (entre autres) éminemment sympathique tient à la vision des femmes. La femme suspectée se révèle être un personnage particulièrement digne, ferme mais bon. Saramago a une manière de la présenter et de la faire vivre qui, tout en en faisant une femme, ne la réduit pas à la féminité. L’auteur aurait pu décider que ce serait son mari qui aurait le beau rôle, sans avoir à changer beaucoup l’écriture du personnage. Femme mais universelle, pour le dire vite. Un horizon
D’un Portugais l’autre
Un Portugais qui joue avec les voix et qui mêle le narrateur au personnel du roman nous rappelle l’autre Portugais, le grand poète, Fernando Pessoa. (D’ailleurs, je rappelle que l’un des plus beaux romans de Saramago s’intitule L’Année de la mort de Ricardo Reis.) Et par chance, je trouve sur ma table un essai qui vient d’être publié, Pessoa, le passeur métaphysique (3).
Pessoa (1888-1935) est ce poète unique qui écrivit sous le nom de plusieurs hétéronymes, terme qu’il inventa (mais bien après qu’ils furent nés) pour désigner les poètes qui ont un jour surgi en lui et lui ont livré leur poésie. Dans la célèbre lettre du 13 janvier 1935, il décrivit leur naissance. Le premier fut Ricardo Reis: mais il n’apparut que dans une pénombre, lorsque Pessoa, pris de l’envie d’écrire des poèmes païens, se vit en train d’ébaucher quelques vers (qui ne prirent pas forme).
|