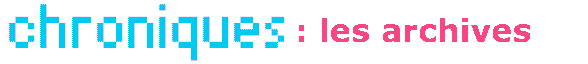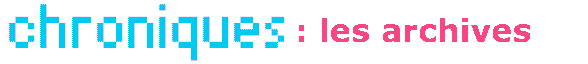Tout le malheur des plasticiens vient de ce qu’ils ne peuvent tourner paisiblement autour d’une souche. Alexandra Vassilikian, peintre de son état, photographe à ses heures (et donc peintre encore quand elle photographie), passant par une forêt bavaroise et reculée près de laquelle elle vit lorsqu’elle n’est pas à Paris, a croisé, dans une clairière minuscule, une énorme souche. Petite clairière et gigantesque souche, on ne pouvait pas ne pas la voir – pourtant certains ne l’auraient sans doute pas vue, n’y auraient pas vu les richesses infinies et délicates qu’elle offrait à l’oeil qui sait regarder. Alexandra V. les a devinées. Ainsi y est-elle revenue, jour après jour, saison après saison, et elle a photographié, dessiné et peint sa souche – c’était devenu la sienne, comme un paysage lointain dont on permet la contemplation à partir d’une ouverture de son propre jardin devient, pour les Japonais, paysage emprunté. Elle avait emprunté la souche.
Etrange entrelacs de racines de tailles diverses mêlées de terre et venant converger, au centre, vers un minuscule bout de tronc restant, la forme générale de cet objet remarquable évoque une roue irrégulière, haute de trois mètres et posée sur la tranche, dont le moyeu ressemble à un nez, un chicot ou un groin. A un certain endroit, semble-t-il, un petit espace évidé laisse passer le jour à travers la matière ailleurs compacte.

Cette souche est donc une sorte de nature morte, naturelle et trépassée, mais qui pousse à l’interprétation fantaisiste. Si j’avais le mauvais goût d’attribuer – on ne m’y prendra pas – des états d’âme aux choses, ou si j’osais user de la facilité qui consiste à prêter des humeurs aux objets pour tenter de rendre compte de mes propres émotions à leur vue, je dirais que cette souche est, selon les jours (selon les photos, les dessins), éplorée (toutes racines pendant lamentablement), affolée (le fouillis racinien hirsute et comme inquiet), délurée (indifférente au regardeur), une autre fois abandonnée (posée là sans façons, dédaignée, comme un parasol renversé). Mais enfin je sais bien que la souche n’a ni états d’âme ni sentiments et qu’elle est là dans sa soucheté, saisie par Alexandra V. comme la chaise de Van Gogh l’était dans sa chaiseté. Plus encore, je souscris avec enthousiasme à cette remarque du philosophe Clément Rosset : « Une des caractéristiques de l’art de Vermeer – comme peut-être de tout art parvenu à un certain degré de noblesse – est de peindre des choses et non des événements. Le monde que perçoit Vermeer n’est pas celui, muet à jamais, des événements insignifiants, mais celui de la matière, éternellement riche et vivante. » Grande vérité au parfum paradoxal que confirme la souche : s’il est facile de ne percevoir que les événements (surtout dans notre monde d’information généralisée), saisir le secret de la matière, comme s’y emploient ces oeuvres, demande plus de subtilité.
Ce morceau de nature rude – primitif, massif, autosuffisant, silencieux – n’est cependant pas inerte. D’abord, m’a dit l’artiste, parce que le temps et les saisons remplissant leur office, la souche évolue insensiblement : elle change en surface (les touffes d’herbe qui avaient provisoirement élu domicile sur son échine disparaissent, la neige qui l’avait couronnée tout l’hiver a fondu) et, réalisant son destin de matière organique, elle va vers la dilution (la terre qui lie les radicelles s’effrite peu à peu, l’eau, le vent et la neige attaquent le bois, les éclats de silex enchâssés comme bijoux dans un écrin velouté se déprennent lentement). La nature morte est encore mortelle.
Mais les oeuvres témoignent aussi du fait qu’Alexandra V. a évolué à l’égard de sa souche. Je sais qu’au début, durant l’hiver 2003, elle s’est contentée, l’ayant découverte, d’aller régulièrement l’observer – plus exactement : d’aller se placer devant elle, dans l’orbe de son secret, attendant un signe. Un jour, en 2004-2005, de retour à Paris, elle l’a dessinée plusieurs fois, de tête, selon ce que sa mémoire lui restituait. Puis elle l’a peinte. On comprend, je crois, le mouvement intime qui lui fit soudain une nécessité de retourner sur le motif : il fallait revoir la chose même. Les rites permettant d’apprivoiser l’émotion, elle décida d’aller chaque lundi photographier sa souche (toujours du même point de vue) puis, après en avoir réalisé un tirage en noir et blanc, elle travaillait à un dessin, d’après cette image, le reste de la semaine. Il en résulta une série de vingt dessins de grand format (150 x 100 cm).
Plus tard, 2006-2007, elle décida de tourner autour de la souche, une photo tous les trois pas, parfois en se baissant un peu (mais sans doute le sol était-il en pente). Variations horizontales et verticales donc. Que nous révèle ce tournoiement de la vision de l’artiste ? Quel effet produit la série de photos qui montrent la souche d’un point de vue qui se déplace parfois imperceptiblement ? Il me semble que d’être immobile comme une souche, la souche, constamment égale à elle-même, résolument fixe, fixée, seulement atteinte par le travail du temps (à peine sensible à l’échelle d’une semaine mais visible sur la durée), accentue l’idée de mobilité de l’être qui l’observe : curieusement, c’est la nature aléatoire du regardeur qui nous frappe. Je repense à Henri Michaux : « Moi n’est jamais que provisoire. (…) On n’est peutêtre pas fait pour un seul moi. On a tort de s’y tenir. (…) On veut trop être quelqu’un. Il n’est pas un moi. Il n’est pas dix moi. Il n’est pas de moi. MOI n’est qu’une position qu’équilibre. (Une entre mille autres continuellement possibles et toujours prêtes). »
Le moi fluctuant, provisoire, position d’équilibre, c’est à lui que nous renvoient les séries qui, autant que de souche, parlent de regard. Et ce n’est pas le moindre de leur charme que ces trois approches (photos, dessins, peintures) se renforcent mutuellement : quand les photos nous attrapent (disons « nous attrapent ») et qu’on croit avoir épuisé le plaisir de la souche, les papiers nous attrapent par un autre côté (et vice versa si l’on a vu les papiers d’abord) puis les peintures troisièmement. Ces diverses saisies renouvelant la vision, soudain on se rappelle deux choses capitales : d’abord que si l’on s’arrête, c’est-à-dire si l’on ralentit le rythme des perceptions, on commence à voir ; ensuite que la profusion peut naître d’un objet unique – c’est notre regard, parti à la rencontre du donné, qui en fait jaillir l’éclatante richesse. Le monde existe, mais inobservé il reste muet. Notre regard interprète, mais guidé par ce qui est. A la jonction de la vision et de l’existant : l’oeuvre – la souche d’Alexandra V. J’aime parfois la nudité, la simplicité, l’économie. J’aime toujours la profusion – des couleurs, des formes, des sensations, j’aime que l’oeuvre n’épuise jamais les possibilités de ma mémoire visuelle, qu’à chaque nouvelle vision je sois débordée par l’abondance du visible, que je n’aie pas la possibilité (psychique, mémorielle) de m’en rassasier, et pas assez de mots suffisamment précis et évocateurs pour décrire le plaisir qui me vient en contemplant ces images de la souche, plaisir rétinien, intellectuel et sensuel.
|