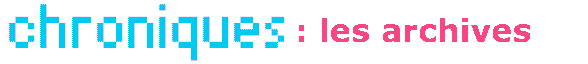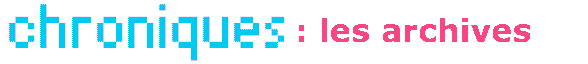| Les
maîtres
d’autrefois |
Pèlerinage au Louvre, François
Cheng,
Musée du Louvre
Editions/Flammarion |
La mode est aux livres d’art présentant
un choix de chefs-d’oeuvre commentés
par un spécialiste (Nuridsany l’avait
fait pour Flammarion, Jean Luc Chalumeau,
pour Le Chêne). Cette fois, ce n’est
pas un historien de l’art, mais un
grand connaisseur de l’Orient et de
ses formes artistiques, François Cheng,
qui visite les salles du musée du
Louvre. Cette suite de “lectures” est
volontairement détachée de
toute référence érudite.
L’auteur se contente de traduire ce
que lui inspire chaque tableau, du Saint
Jérôme pénitent de Lorenzo
Lotto à l’Autoportrait au chevalet
de Rembrandt, en passant par les toiles de
Fouquet, du Caravage, de Véronèse
ou de Corot. Les parallèles entre
la culture chinoise et la culture européenne
des temps passés ne semblent pas toujours
fructueux et éclairants. Et cette
façon d’interpréter la
peinture “en aveugle” n’est
pas satisfaisante et Cheng succombe à la
tentation de placer l’oeuvre dans son
contexte et de faire référence à de
grands connaisseurs, comme Berenson. Une
grande sensibilité s’exprime
dans ces pages et il faut lui reconnaître
le talent de transmettre sa passion et ses
intuitions. Mais cela me paraît un
exercice de style un peu artificiel et, en
agissant de la sorte, l’auteur s’est
condamné à demeurer souvent à la
surface des choses. |
| Le Zoo d’Orsay, Emmanuelle Héran,
Gallimard |
Peut-on visiter un musée en ne choisissant
que de voir les espèces animales qui
y sont représentées dans les
peintures et les sculptures. Cela pourrait
paraître absurde. Et pourtant c’est
bien à ce genre de pérégrination à laquelle
nous invite Emmanuelle Héran. La Piscine
de Roubaix a été récemment
transformée en une espèce de
ménagerie où l’on peut
rencontrer des oeuvres appartenant aux collections
du musée d’Orsay. On y découvre
au moins quelques perles rares, comme le
Goret de François Pompon, les Deux
girafes de Rembrandt Bugatti, les chevaux
d’Edgar Degas et ceux de Meissonier,
les chats de Bonnard et de Steinlein, celui
de Manet aussi, le chien de Gauguin, les
paons d’Eugène Grasset, les
boeufs de Dubufe, de Boudin, de Charles Jacque,
les lions de Rosa Bonheur… Cette plongée
dans le règne animal par le biais
de l’art du XIXe siècle peut
paraître un artifice et une pure vue
de l’esprir. Mais c’est aussi
un moyen de réfléchit sur l’idée
du réalisme et celle de l’abstraction,
de la valeur attribuée à la
vie paysanne et les mythes liés à la
vie sauvage.En somme, il y a là une
réflexion sur la beauté animale
perçue par les artistes après
que Buffon ait défini par écrits
la beauté propre à chaque animal
de la Création. |
Antonio Basoli,
Accademia Clementina/Accademia di Belle Arti di Bologna |
Antonio Basoli (1774-1848) fait partie
de ces artistes qui ne sont connus que pour
une chose. En ce qui me concerne, je ne connaissais
de lui que son alphabet architectonique qu’on voit reproduit
dans de nombreux ouvrages concernant la typographie. En réalité,
l’arc
de ses intérêts a été extrêmement vaste,
comme l’a montré la superbe exposition présentée à Bologne.
On découvre alors qu’il fut non seulement peintre, mais aussi
scénographe, décorateur de théâtre, auteur de
projets de plafonds et un homme qui a beaucoup travaillé en vue
d’un moyen de divulgation populaire que sont les panoramas, les dioramas,
les néoramas, etc. Bologne a rendu un bel hommage à ce créateur
polymorphe, protéiforme, curieux de tout ce que le monde de son
temps a pu découvrir. De cet événement, il reste un
catalogue particulièrement riche qui ne néglige aucune facette
de sa personnalité. |
Œuvres,
Claude Lévi-Strauss,
édition établie par Vincent Debaene, F. Keck, M. Mauzé,
Martin Rueff, préface de V. Debaene,
«Bibliothèque de la Pléiade », NRF, Gallimard
|
Comme beaucoup des jeunes gens de mon époque (ceux qui eurent vingt
ans en 1968), la lecture de Tristes Tropiques (un livre qui avait pourtant
paru en 1955) avait été un enchantement et la découverte
d’une autre manière d’envisager, le voyage, l’exploration,
la connaissance des civilisations indigènes, mais qui n’en était
pas moins un livre de nature littéraire. La pensée sauvage
eut une résonance presque aussi forte. Et sans jamais être
franchement convaincu par le structuralisme ; Lévi-Strauss resta à mes
yeux un écrivain de premier plan. Mais qu’il eût écrit
sur l’art, la musique et la littérature m’avait échappé.
Le volume qui lui rend hommage dans la prestigieuse collection « La
Bibliothèque de la Pléiade » contient un livre qui
m’avait totalement échappé, Lire écouter lire.
Il y fait des considérations passionnantes sur la couleur et sur
les sons. Mais j’ai été séduit par son étude
de Nicolas Poussin. Il part d’une observation concernant les personnages
de la Grande Jatte de Seurat : les personnages ne sont pas de même
taille alors qu’ils se trouvent sur le même plan./ Ce procédé était
déjà présent chez les grands créateurs japonais, à commencer
par Hokusai. Poussin a eu une méthode de travail très singulière
: il utilisait des figurines de cire qu’il plaçait dans une
boîte percée de trous pour laisser passer de la lumière
et déterminer la position des ombres. L’auteur montre comment
il transpose le tableau du Guerchin qui avait précédé sa
première version d’Et in Arcadia ego. Lévi-Strauss
est fasciné par ce dispositif qui fait que ses figures semblent
plantées les unes à côté des autres. Et il étudie
comment par de fines métamorphoses, Poussin a fini par changer la
peinture de son temps. |
Vlaminck, un esprit fauve, Skira
D’un lit dans l’autre,
Le Ventre ouvert, Histoires et poèmes de mon époque,
Tournant dangereux,
Portrait avant décès,
Maurice de Vlaminck,
SVO Art Editions |
De quoi Maurice de Vlaminck a-t-il été la
victime ? D’avoir été le
fondateur du fauvisme avec Derain ? De sa
dispute avec ce dernier qui fut son plus
proche ami ?
De son mauvais caractère ? De son obstination tenace à creuser
seul son sillon pictural ? Son franc parler ? Ou encore un voyage à Berlin
en 1942 avec Derain, Van Dongen, De La Fresnaye, Belmondo et quelques autres
? C’est certain, le voyage en Allemagne ne lui a pas fait du bien et il
n’a pas été réhabilité comme son ancien camarade.
Ce qui est sûr, même s’il a conservé des amateurs fidèles
et des collectionneurs que rien n’aurait démontés, il n’a
plus eu de reconnaissance officielle et il est tombé dans des limbes bien
grises après sa disparition. La belle exposition du musée du Luxembourg
(je dis belle parce que ce n’est pas toujours le cas) lui rend un bel hommage – dommage
qu’elle le fasse « mourir » en 1915 ! Vlaminck est bien embarrassant,
même rétrospectivement ! Fort heureusement, cinq de ses livres sont
réédités. L’un est un roman qu’il avait écrit
pendant ses jeunes années (il faisait son service militaire !) avec Fernand
Sernada et illustré par Derain. Ce premier roman paraît en 1902
et est salué par Rachilde. Mais Vlaminck préfère se lancer
dans la bataille artistique. Ce qui ne va pas l’empêcher d’avoir
une production littéraire importante des récits et des poésies
comme ses Histoires et poèmes de mon époque (1927). Mais ce sont
ses ouvrages de souvenirs qui vont être les plus appréciés.
Il évoque beaucoup les riches heures de Montmartre et de Montparnasse à l’époque
des fauves et des cubistes (il a des propos mordants sur le petit monde des avant-gardes
des cafés du carrefour Vavin !). Et il s’en prend à la société moderne
et à tout ce qui est moderne, prolétariat et socialisme compris.
Il ne s’est donc pas fait que des amis… |
Train de vie,
Eugène Dabit,
« Domaine public », Buchet/Chastel |
On réédite Eugène Dabit. Pourquoi pas ? C’est
une idée pas plus mauvaise qu’une autre. Son Hôtel du
Nord a laissé une trace dans l’histoire de la littérature
et plus encore du cinéma. Et c’était un romancier qui
avait du style et un esprit bien trempé. Dans l’ouvrage, qui
vient de paraître qui est un recueil de nouvelles, a été ajouté un
essai sur Vélasquez. On sait que Dabit avait eu d’abord l’envie
de se consacrer à la peinture. Ce texte fait partie d’un ensemble
plus vaste : Les Maîtres de la peinture espagnole. Dommage que l’ensemble
n’ait pas été republié. En tout cas, on n’y
voit pas un peintre face à l’Histoire ou un peintre qui élabore
des sujets complexes (Les Ménines ne le fascine pas comme elles
fascineront plus tard Michel Foucault) : il le voit comme un coloriste
qui change de période quand il change d’harmonies de base
ou qui sait donner une valeur locale à la moindre tache. C’est
donc là une lecture effectuée par un aspirant peintre encore
jeune et qui n’est pas allé au bout de ses rêves. Mais
ce n’en reste pas moins une clef de lecture qui ne manque pas de
valeur. |
La modernité est-elle toujours moderne ? |
L’Art à ciel
ouvert,
la création contemporaine
/Commande publique en France, 1983- 2007,
Flammarion
sous la direction de Caroline Cros et de Laurent Le Bon, préface
d’Olivier Kaeppelin |
Il y a des réalisations mémorables
et beaucoup d’autres
qui ne le sont pas quand on songe à ce que l’Etat a pu réaliser
ou aider à réaliser en France depuis quelques décennies.
Parmi les commandes publiques qui ont laissé une trace, je pense à l’Hommage à Albert
Camus de Bernard Pagès (Nîmes, 1992), La Confidence de Daniel
Dezeuze au jardin des Tuileries (2000), le signe de Cy Twombly exécuté à Paris
en 1989 ou les Huit carrés bleus de Felice Varini dans l’orangerie
du château de Versailles (2006). D’autres pourraient être
oubliées, comme l’Hommage à Pablo Picasso de César
(Paris, 1985), dont personne ne voulait et qui a fini, hélas, par échouer
place de la Croix-Rouge à Paris, le Feu de Rebeyrolle (Chooz, 1998),
Le Chat des rives de l’art (Schillingen, 2001), Ascension, de Kirili
(Arles, 2002), M. A. de Natacha Lesueur (Versailles, 2006), Le Cri, l’écrit
de Fabrice Hybert (Paris, 2007), Transport amoureux de Sophie Calle (tramway
de Toulouse, 2007) : continuer cette liste serait bien trop fastidieux.
Comme toujours, il y a plus d’échecs que de réussites.
Il faut seulement se demander si la situation est meilleure ou pire que
par le passé. C’est difficile à dire. Le déplacement
radical de la notion de monumentalité, sa quasi-disparition ont
changé profondément la relation à la ville, mais aussi à la
fonction symbolique de l’oeuvre. Un certain nombre de ces réalisations
ont un caractère éphémère (matériaux
périssables, jeux de lumière, ou création d’un
seul jour) et ne sont plus souvent que des interventions fugaces pour modifier
le regard sur une architecture ou un paysage urbain.Le débat qu’ont
provoqué les deux Plateaux de Daniel Buren installés au sein
du Palais Royal n’a jamais cessé : l’absence totale
de connotation traditionnelle et donc de représentation sans assumer
la valeur d’une composition abstraite a posé et pose encore
un problème. Désormais l’intervention de l’artiste
est un acte qui perturbe le sens sans nécessairement en ajouter
un autre… |
La Bourgogne, la
famille et l’eau
tiède,
Gérard Garouste,
Galerie Daniel Templon |
La dernière exposition de Gérard Garouste chez Daniel Templon
a été pour moi un grand choc : rarement en effet des tableaux
réunis dans une pièce ne m’ont plongé dans une
telle angoisse. Je connais Garouste depuis longtemps et je peux me vanter
de très bien connaître son travail. Il est vrai aussi que
ses précédentes expositions allaient déjà dans
ce sens, mais pas avec une telle violence. En quoi consiste-telle au juste
? En une violence contre soi-même, à la mise en scène
hallucinée d’une autobiographie qui ne dissimule rien. Rien
d’impudique dans ces oeuvres, mais la vérité est toujours
blessante. On y voit l’artiste aux prises avec ses démons
et se représentant dans des scènes de cauchemar épouvantables.
Le mémorialiste passe devant le peintre, ou plutôt se sert
du peintre pour parvenir à ses fins. Toutes ces scènes irréelles
parlent d’une réalité parfois effrayante et de souvenirs
insupportables. Garouste a commenté chacune de ses compositions
dans le catalogue pour expliquer ces autoportraits tous plus dérisoires
les uns que les autres (le sourcier, l’homme à la gigue et à l’hysope,
la fable de l’étudiant et de l’autre lui-même,
sans parler du triptyque formant un portrait de famille). Sans doute sacrifie-t-il
une part de son immense talent au nom de la vérité, mais
il laisse peut-être quelque chose de plus précieux que ses
grandes peintures virtuoses. |
Mouvement Madi international,
Maison de l’Amérique latine.
Teorie del Madi, Matteo Gabiati, Scoglio di Quaro, Milan |
Le groupe Madi est né en 1946 avec la publication du Manifesto Madi
rédigé à Buenos Aires par l’artiste uruguayen
Camilo Arden Quin. S’il est contemporain du Manifesto blanco de Lucio
Fontana qui marque la naissance du groupe spatialiste, s’il plaide
en faveur de thèmes liés à l’abstraction, il
constitue d’abord une critique du réalisme socialiste en même
temps que l’affirmation du matérialisme pur et dur. Les oeuvres
produites par le petit groupe au bord du Rio de la Plata n’ont heureusement
pas la sécheresse de l’énoncé d’Arden
Quin dans sa déclaration. Il en est sorti une autre conception de
l’art abstrait, plus dynamique et plus libre. Dans son extrême
générosité, Arden Quin, bien des décennies
plus tard, a laissé se créer un nouveau groupe Madi, élargi à des
artistes du monde entier. Une seule condition est requise : une conception
abstraite géométrique mais déterminée par une
vision non statique de l’espace. L’exposition de la Maison
de l’Amérique latine et celle, plus petite, mais néanmoins
significative à la galerie Scoglio di Quarto à Milan ont
permis de faire un véritable bilan de la longue histoire de Madi. |
Dans le coeur de Picasso,
Geneviève Laporte,
Editions du Rocher |
Pablo Picasso n’a pas eu de chance avec les femmes - tout du moins
pour sa postérité. Elles se sont presque toutes emparées
de lui, de son succès, de sa personnalité extravagante et
elles ont souvent écrit des livres. Geneviève Laporte n’en
est pas à son coup d’essai. Dans ce livre, elle égrène
des souvenirs et se place au centre d’une histoire où, au
fond, elle s’est toujours trouvée à la périphérie.
On peut glaner de-ci de –là quelques indications sur son mode
de vie après la Libération, sur ses relations avec Cocteau,
Eluard et Aragon, mais, on ne sait pas même qu’elle a été la
vraie nature de sa relation avec cette femme. Cette dernière a au
moins un grand mérite : ne pas être vindicative. Ce qu’elle
avait en commun avec le peintre ? Si on y pense bien, on pourrait répondre
: l’amour des chiens. |
Ferdinando Scianna
préface de Maurice Nadeau
Photo Poche, Actes Sud |
Ferdinando Scianna est un des grands photographes de l’aprèsguerre.
Il d’est bien entendu rangé dans le camp du nouveau réalisme,
mais avec toutes les libertés que ce courant a pu consentir. Voyageurs
aguerri, il a commencé par photographier sa Sicile natale (il est
palermitain de naissance). Son goût pour les contrastes divertissants,
surprenants ou mortifères du réel ne l’ont pas empêché de
faire des compositions recherchées et aussi d’être l’ami
des écrivain : Barthes, Montalban, Sciascia sont quelques uns de
ses modèles de prédilection. Scianna est l’un de ceux
qui représente le mieux ce moment de la culture italienne, avec
Rossellini et De Sica pour le cinéma ou Vittorini et Brancati pour
la littérature. |
En suivant la Narmada
précédé de
Souvenirs d’Inde,
Claude Lagoutte,
préface de R. Couster, Diabase
Claude Lagoutte, voyages et autres traces,
Le Festin/Musée des beaux-arts de Bordeaux
Carnet du Tibet Claude Lagoutte
préface de Charles Juillet
Diabase |
Claude Lagoutte est un artiste un peu déroutant. Il est abstrait
par nature et, pourrait-on dire par défaut : en effet, il ne s’intéresse
pas aux spéculations parfois arides sur les relations entre la surface,
la ligne, la couleur comme ont pu l’imaginer les suprématistes,
les constructivistes, les néo-plasticiens et les membres de Cercle
et Carré. Son ambition esthétique est d’une bien autre
nature. Il puise dans le spectacle du monde des inspirations, peut-être
des thèmes géométriques ou chromatiques. Mais il ne
tient pas à représenter ce qu’il a pu découvrir
et aimer. Ses tableaux paraissent des travaux de couture ou encore de tissage.
Il y a quelque chose dans sa démarche qui l’apparente à François
Rouan. Mais il s’en distingue à la fois par une quête
spirituelle revendiquée et par ses références à des
pays ou des lieux précis. Lagoutte a été un grand
voyageur, avec une prédilection pour l’Inde. C’est ce
qu’il manifeste dans un petit livre d’une grande originalité de
ton, En suivant la Narmada, qui relate, entre autrechose, le voyage le
long d’un grand fleuve. Il y explique d’ailleurs très
clairement sa démarche : il voit ses oeuvres comme des écritures-paysages,
comme des récits d’émotions et de traces laissés
par tout ce dont il a voulu conserver la mémoire. Ces écritures
ont été achevés en 1989, un an avant sa disparition.
Ce qui est frappant, c’est qu’il n’y a pas de méthode à proprement
parler, mais l’affirmation d’un langage exclusivement plastique
dans ses compositions qui font écho aux textes qu’il a pu
rédiger. En somme, Lagoutte est un écrivain et un peintre
qu’il convient de découvrir en confrontant ses deux sphères
d’expression. |
Les Images du monde, Pierre
Zarcate,
Villa Tamaris |
Pierre Zarcate a longtemps travaillé dans l’aire abstraite.
Aujourd’hui il présente à la Villa Tamaris une importante
série d‘oeuvres à partir de documents photographiques.
Leur assemblage constitue des foules compactes et angoissantes polychromes
ou en noir et blanc. L’intérêt de ces travaux est d’élargir
considérablement le champ des références. Parfois,
on a le sentiment qu’il exhume les photomontages de Rodtchenko, d’autres
fois, qu’il procède à des accumulations dérivées
d’Arman. Mis à part le caractère un peu répétirif
de la formule, Zarcate a produit des compositions fortes et prenantes. |
|