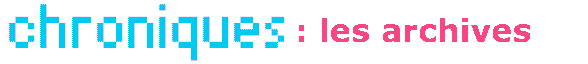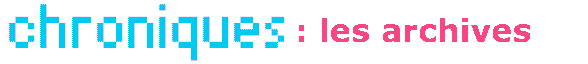Bref, je me perds en vaines conjectures et il vaut mieux essayer de voir ce qu’en disent mes contemporains. Par exemple Lydie Salvayre, dans son Portrait de l’écrivain en animal domestique. Ici encore, on trouve une configuration a priori connue : l’Écrivain au service du Puissant. Racine, promu historiographe de Louis XIV, était-il heureux et content de lui ? Une femme, la narratrice, est convoquée par un des hommes d’affaires les plus riches du monde (forfanterie de l’intéressé ou pas, disons qu’il loge très haut dans la pyramide des fortunes), pour – puisqu’elle est écrivain – écrire sa vie. Le Puissant, auquel la femme d’esprit a ici affaire, n’est pas un roi mais quand même, c’est Tobold, le roi du hamburger, qui lui confie la tâche de relater ses « faits et gestes de […] champion hors classe de la mondialisation ». Ce vrai prophète du Marché Mondial, d’une vulgarité sans nom, d’une solitude totale, cent quarante-six pièces dans sa maison, un chien (Dow Jones), trois cent soixante-cinq voitures, une femme qui fut strip-teaseuse, témoigne d’un cynisme sans limites et d’un mépris absolu pour tout ce qui relève de l’esprit. On n’est plus à la Cour, on est chez les dirigeants du Marché.
Entre la Cour et le Marché, on se souvient qu’il y a eu une époque bénie où être artiste signifiait n’être pas bourgeois, et même, combattre le Bourgeois (pour cela, il suffisait quasiment de persévérer dans son être d’artiste). Plus d’un siècle de positions bien tranchées, de postures bien marquées, et confortables, confortables (moralement), dont il ne nous reste que le fantasme – le simulacre souvent (entendez-les vouloir être absolument subversifs, absolument dérangeants…). Donc : à quoi pourrait bien servir un écrivain aujourd’hui ? Ou encore : quelle est sa place dans l’univers de l’argent roi ? Quoi faire de son sentiment de révolte dans un monde où elle n’a plus cours ? Comment s’inscrire dans le réel de la « petite planète » ? Aujourd’hui où, de plus, on a l’impression, au vu des transformations de la machine éditoriale, que l’art du roman pourrait devenir une espèce aussi rare et confinée que la poésie ? Lydie Salvayre, en organisant la rencontre de l’artiste et du roi de l’économie, au début du 21e siècle, apporte une réponse. Elle indique que dans cette confrontation se trouve matière à penser pour aujourd’hui (ce qui me rappelle, par parenthèse, que notre ministre des finances vient de déclarer que des livres et des théories, nous en avions suffisamment pour les siècles à venir et que, je cite : « assez pensé maintenant, retroussons nos manches » pour nous mettre au travail. Elle confirme ainsi ce que je pense depuis quelques mois : le travail, dans la conception de ces gens-là, qui n’est pas la mienne, c’est le contraire de la philosophie et de la sagesse : un empêchement à penser. Bouh !).
Comme Lydie Salvayre l’a souvent déclaré, l’écrivain a la responsabilité de sa prise de position dans l’époque. Si nul n’est désengagé, celui qui écrit, qui rend sa parole publique, l’est encore moins que d’autres. Parler pour tous, c’est commenter, d’une façon ou d’une autre, son temps. Par la mise en scène de ses deux personnages, entre France et Amérique (mais notre monde n’est-il pas justement, comme le suggère la géographie de son roman, déterritorialisé ?), Lydie Salvayre nous invite à penser la réalité de notre société, c’est-à-dire d’une petite planète où règne la marchandise, bien plus hégémonique que l’étaient les rois d’Ancien Régime.
L’écrivain du roman, comme il va de soi, meurt de faim – enfin, vivote comme il peut. En outre, son personnage n’est pas brillant : coincée, mal assurée, frustrée, gourmande, elle peut difficilement poser à l’Artiste. Tobold, vivant fastueusement de ses « extorsions, confiscations, participations, négociations sanglantes, opérations juteuses » dans cent vingt pays, souhaite – mais pourquoi donc ? il ne le dira jamais – que son évangile, sur le modèle de celui de l’Incarné (ainsi le nomme-t-il), soit fixé. L’écrivain, tout en se le reprochant vivement et en se détestant sans cesse, accepte, pour gagner enfin un peu d’argent, et, misère, prend goût au luxe qui lui est offert.
Mais Tobold a besoin d’amour et d’estime autant que les autres. Quand il apprend par hasard à quel point il est haï et méprisé, il plonge dans la dépression. Comment s’en sortir ? Selon le vieux principe qui consiste à piquer le beurre et l’argent du beurre et à s’attirer quand même le sourire de la crémière : il décidera de devenir le plus grand bienfaiteur de l’humanité en créant la plus grande fondation caritative du monde. Qu’on se rassure, elle rapportera, et pas seulement de l’amour. Quand on pense que Bill Gates est parfois perçu comme un nouveau saint, que tous les acteurs célèbres et richissimes n’ont de cesse de s’ériger en défenseurs de la planète (contre le sida, le trou de la couche d’ozone, etc.), on est content quand quelqu’un se moque un peu de la nouvelle « philanthropie innovante », n’est-ce pas.
Sans doute peut-on reconnaître un écrivain à sa forme d’humour et aussi à la distance précise qu’il instaure avec les personnages dont il est le plus proche (aussi proche que possible) : il y a chez Lydie Salvayre un ton goguenard (si c’est le mot), moqueur, sans complaisance, qui évite toujours que la dénonciation tombe dans la jérémiade et qui préserve longtemps l’ambivalence des sentiments du lecteur à l’égard de l’héroïne. Alchimie très discrète : ces délicieux imparfaits du subjonctif, par exemple, qui sont l’inscription dans le discours du roman de l’identité même de la narratrice, aussi significatifs que le geste d’arranger son matériel intime qui caractérise Tobold… Une des habiletés (romanesques) de ce roman consiste à avoir mis fugitivement en scène des personnes réelles parmi le personnel romanesque : les personnages fictifs du roman croisent parfois Robert de Niro (dont la narratrice est éprise), Sophie Marceau, Sharon Stone, Bill Clinton, Bill Gates et d’autres. L’idée n’est pas sans modèles, mais le renouvellement en est très intéressant et il constitue aussi une proposition romanesque atirante concernant la pertinence des sujets possibles : c’est la réalité, « spectaculaire » et économique, qui constitue un vrai sujet pour le roman contemporain. Car enfin, comment les romanciers pourraient-ils éviter de parler de ce qui hante nos vies, nos façons d’être, nos désirs et notre idéologie au sens le plus large : l’économie, le marché ? Façon de sortir de la tour d’ivoire, de se frotter à la violence d’aujourd’hui, de continuer de tenir le discours critique qui assure notre liberté d’esprit.
La fin du roman (tout en restant grinçante) est plutôt optimiste : quoique frustrée et vaguement grotesque, la narratrice trouve quand même en elle cette réserve d’amour-propre qui lui permet de se détacher, au bout de dix mois, de Tobold, et de bâtir ce projet romanesque (celui que nous lisons) mûri pendant deux ans. Optimiste car croyant en la vertu du roman qui nous apprend (comme la narratrice l’a appris) « les grands jeux, les grandes marques, les grandes tromperies, les grandes manigances, les grands désastres […], les marchés qui se mangent eux-mêmes, les décisions prises à la légère et dont les effets s’avéraient aberrants ». Optimiste car la narratrice, après être passée par cet enfer, retrouve « l’espoir entêté, l’espoir opiniâtre, l’espoir increvable […] le goût fervent du monde » et celui de « brocarder ce qui [lui] semblait l’enlaidir ». Optimiste enfin car c’est en s’emparant de ce qui nous paraît si complexe, la machine économique, en la parlant, que l’écrivain, et nous avec lui, échappons mentalement à ses rouages, et donc à une condition d’animal domestique. Leçon pour aujourd’hui. Allez ! Nous resterons quand même sur Terre, même si, tout compte fait, cette planète est devenue bien petite.
|