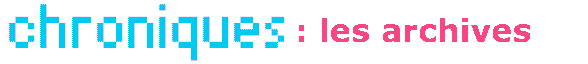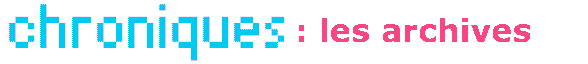Le Voyageur nocturne,
Maurizio Maggiani, tr. Marguerite Pozzoli, Actes Sud. |
Maurizio Maggiani peut-il être regardé comme le représentant d’un nouvel orientalisme ou, plus largement, d’une nouvelle littérature exotique. Avec lui, nous sommes très loin de Théophile Gautier et de Pierre Loti. Toutefois, dans ce roman, il accumule les références évoquant des terres lointaines : la migration des hirondelles en Afrique du Nord, celle des Touaregs dans le désert et puis la migration spirituelle du Père de Foucault. On éprouve le sentiment que l’auteur s’est dit qu’il allait écrire quelque chose sur le désert et qu’il fallait trouver des éléments de plusieurs natures pour bâtir une trame sur ce thème. Mais il faut reconnaître que même si toute cette histoire est bâtie au cordeau, elle fonctionne très bien. Le Voyageur nocturne demeure un authentique roman d’aventure et surtout d’aventure spirituelle. |
L’Horizon est en feu,
présenté par Jean-Baptiste Para, “Poésie”, Gallimard. |
Jean-Baptiste Para présente une anthologie de la poésie russe du XXe siècle qui ne retient que cinq poètes : Alexandre Blok, Anna Akhmatova, Ossip Mandelstam, Marina Tsvétaïéva, Joseph Brodsky. Il n’explique pas pourquoi ces cinq seuls noms et pas, par exemple, Maïakovski ou Khlebnikov. Quoi qu’il en soit, ce petit volume constitue une belle et utile introduction à la culture poétique russe. Avec Block qui naît avant la parenthèse soviétique et Brodsky, qui s’af- firme peu avant qu’elle ne se referme, ce choix a le mérite de mettre en évidence comment cinq immenses talents ont réagi devant les diktats de l’histoire et ont pu néanmoins construire une œuvre qui n’en soit pas tributaire. |
Alexandre Blok,
Jean Blot, Éditions du Rocher. |
Jean Blot vient d’achever un excellent portrait d’Alexandre Blok. Ce n’est pas une biographie à proprement parler (bien que cet ouvrage puisse très honnêtement en tenir lieu), mais plutôt une tentative de comprendre la personnalité du grand poète russe. Il nous le présente vieillissant, au moment où la guerre fait rage et où la révolution commence, écrivant une pièce pour Stanislavski et traduisant des poètes tels que Byron, privé de son inspiration, à bout de souffle. Il a fallu toute la sensibilité de Jean Blot pour restituer toute la complexité de cet homme et les subtilités de son œuvre. L’auteur ne s’attarde pas dans les méandres et les détails comme ce genre l’exigerait pour dégager le caractère, la démarche et la pensée d’un être si singulier. Et ce qui ressort le plus dans ce livre, c’est la nature de l’amitié profonde le liant à André Biely… |
| Le Roman de Vienne, Jean des Cars, Editions du Rocher, 19, 90 euro |
La collection dirigée par Vladimir Fédorovski aux Éditions du Rocher où se raconte le « roman» des villes se traduit souvent par de médiocres digressions sur l‘histoire et la culture des cités concernées. Le Roman de Vienne de Jean des Cars qui est un peu mieux que l’épouvantable et grotesque Roman de Séville) se matérialise par une somme hallucinante de lieux communs et d’anecdotes sur une Vienne réinventée pour des touristes distraits et à la culture maigre. On saura tout de ce Herr Sacher qui invente la célèbre tarte au chocolat dont il porte le nom et on apprendra que « les amoureux de la musique légère font le pèlerinage». C’est de la littérature de spleeping car qui me font recommander au lecteur d’acheter d’urgence Danube de Claudio Magris, un immense érudit et un écrivain de haute volée qui a su parler de Vienne avec intelligence mais aussi avec les ruses révélatrices d’un authentique conteur. |
| En français dans le texte |
Pour un tombeau d’Anatole,
Stéphane Mallarmé, introduction et notes de Jean-Pierre Richard, “Points”, Seuil. |
Jean-Pierre Richard a eu la chance de mettre la main sur un important manuscrit de Mallarmé. Il s’agit d’un considérable projet de poésie pour célébrer la mort de son deuxième enfant, disparu en 1879. Jamais l’auteur d’Igitur ne l’a achevé. La parution de cet inédit au début des années 60 a inauguré cette exhumation de textes laissés dans le tiroir et qui ont fini par lui donner l’image d’un poète manqué. Pour un tombeau d’Anatole est un brouillon et même encore un chantier mal dégrossi. Sans doute peut-on apprendre par son intermédiaire beaucoup de choses sur sa méthode de travail et sur sa pensée, mais on voit aussi les coulisses de la création qui ne sont pas en sa faveur. Qu’on publie ces pages ? pourquoi pas ? mais qu’on les présente comme une œuvre presque achevée, là on s’aventure un peu loin. Car je crois qu’il faudrait plutôt parler du Monument élevé à la gloire de Jean-Pierre Richard… |
Cahier, Ivry, janvier 1948,
édition d’Evelyne Grossman, Gallimard. |
La publication du cahier d’Ivry qu’Antonin Artaud a rédigé en janvier 1948 à Ivry provoque une double réaction. D’une part, le plaisir que je ne saurais bouder de découvrir des manuscrits inédits de l’auteur du Théâtre et son double. De l’autre, je ressens un certain trouble en me retrouvant devant un exercice forcé de fétichisme littéraire : la transcription du brouillon est accompagnée du fac-similé de ce modeste cahier d’écolier cousu au dos. A-t-on exhumé un chef-d’œuvre? Sans doute pas. On a mis la main sur un texte passionnant que montre un homme qui retrouve son cheminement poétique après de longues années d’internement où il a rédigé des textes d’une nature hallucinée. Mais c’est un homme brisé qui trace ces mots sur ces pages quadrillées, qui tente avec difficulté de retrouver du sens dans une immensité tourmentée et dont le sens l’a dépassé et submergé. Je crois qu’un excès d’idolâtrie va à l’encontre d’une bonne intelligence des derniers moments d’Artaud rendu à la liberté. Un sourd débat fait rage autour de cette question depuis longtemps. Était-il encore dément ou n’était plus qu’un être qui épuisait ses dernières forces à reprendre pied dans sa propre poésie ? Le mystère restera entier. Ce cahier révèle une renaissance douloureuse. Et cela est fondamental dans l’idée que nous pouvons nous faire rétrospectivement d’Artaud. |
Romans,
tome 2, Raymond Queneau,
édition d’Henri Godard, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard. |
C’est en 1942 que Raymond Queneau commence la rédaction de ses Exercices de style. Des extraits paraissent trois ans plus tard dans plusieurs revues et finalement en volume en 1947. Pastiches, parodies, faux poèmes, ce sont là des bribes romanesques élaborées dans toutes les formes imaginables pour raconter une seule et même histoire (d’ailleurs à peine une histoire) d’un individu prenant un autobus. C’est une petite merveille de littérature expérimentale dont l’aspect purement démonstratif est contrebalancé par un humour communicatif. Ces Exercices sont à mes yeux le plus grand accomplissement littéraire de Queneau. Ne faisant pas partie des laudateurs de Zazie dans le métro, je retiendrai des œuvres romanesques rassemblées dans ce volume Les Œuvres complètes de Sally Mara, parues en 1962. Le meilleur de l’esprit joueur et falsificateur de Queneau se retrouve dans ce récit extravagant, bourré d’humour et d’une grande finesse. La parution dans la prestigieuse collection de La Pléiade est toujours une curieuse épreuve: certains auteurs en ressortent grandis, d’autres amoindris. Dans le cas de Queneau, nous dirons que c’est un match nul. Une partie de ses livres, aussi plaisants soient-ils ne méritent que notre estime et notre sympathie. D’autres sont dignes de rester à la postérité. |
Le Bonheur de la nuit,
Hélène Bessette, Postface de Bernard Noël, «Lauréli», Léo Scheer. |
Il faut reconnaître à Laure Limongi le grand mérite d’avoir ramené à la surface l’œuvre d’Hélène Bessette. De quel grand plaisir nous nous sommes privé en laissant tomber dans l’oubli cette femme exceptionnelle ! Elle a inventé une façon vraiment originale de concevoir la relation romanesque. Dans Le Bonheur de la nuit (écrit entre 1967 et 1968 et inédit jusqu’ici), c’est avec des phrases courtes, une impression d’annotations rapides, un enchaînement elliptique, un effet de synopsis qui raconte comment le roman aurait pu être envisagé (tout en l’accomplissant en même temps), on se trouve nez à nez avec quelque chose que même le Nouveau Roman ne nous avait pas habitué à faire l’expérience. Cette fiction est dépouillée de toutes les scories du récit tel qu’on l’avait conçu jusqu’à une date récente. A la place, l’écrivain a introduit, le rythme, le tempo de la pensée, en somme, une dynamique de la relation qui rappelle la poésie américaine des années 50 et 60, mais qui ne s’en inspire pas. Cela ne l’empêcha d’aucune manière de bâtir sa trame arachnéenne et de dépeindre avec force le malentendu qui s’instaure entre les hommes et les femmes d’autant plus que le monde moderne souffle sur les braises du désir pour le ranger dans des catégories subordonnées à la réussite sociale, au pouvoir et à l’argent. C’est un livre magistral, qui se lit presque dans un seul souffle, mais toujours à perdre haleine. C’est à la fois une œuvre tonique et angoisse, d’une vitalité enthousiasmante et d’une mélancolie épuisante. A ne manquer sous aucun prétexte. |
Le voyage à jupiter et au-delà. Peut-être,
Jean Ristat, Gallimard. |
Dans sa dernière création poétique, Jean Ristat s’avère au sommet de son art. La forme est classique (du moins c’est l’effet qu’elle donne), mais les images sont surréalistes, ou triviales ou que sais-je encore, mais jamais ordonnée par un principe souverain et étroit. La construction des parties de l’œuvre repose sur le sentiment d’une respiration : parfois on les lit d’un seul souffle, parfois les strophes permettent de fugaces pauses. Mais quoi qu’il en soit, le poème passe des désirs les plus impérieux à la conscience d’un effondrement du désir d’un autre monde. Alors le voyage commence chez les dieux de l’Olympe pour retomber sur la Terre où nous tentons d’exister hic et nunc, pour repartir dans l’espace de la poésie où Mallarmé et Rimbaud figurent. Tout n’est que paradoxes, dans la forme et dans l’esprit. Jean Ristat est le Cyrano de Bergerac de notre temps. Son invitation au voyage est un mélange de sublime et d’amertume, de rêves et de brutal réveil devant l’état des lieux. Il joue avec les règles de la poésie et s’en joue, il joue avec la pensée qui se dérobe, il se divertit des illusions perdues et retrouvées, alors qu’il pourrait en pleurer. Dépassement, transgression des clauses de cet art ? Je ne crois pas que ces termes lui plairaient. Je parlerais plutôt d’un baroquisme de sa démarche dans le sens étymologique – une irrégularité qui dévoie la poésie et lui donne un mauvais genre. Belle à en mourir et pourtant défaite et un peu dépravée. Sa rédemption ? L’amour de la collusion sensuelle des mots, un phrasé sensuel, une connivence spirituelle par l’usage dévoyé et l’abus de langage. |
L’invisible des pierres,
Valère-Marie Marchand, Édition Le Pli. |
Valère-Marie Marchand fait montre d’une rare qualité : celle de faire parler les pierres. Son dernier ouvrage est le fruit d’une curieuse démarche : façonner des récits sur la vapeur d’eau, le galet, la brique de thé ou le galet comme autant de poèmes sans jamais prétendre s’insinuer dans le territoire interdit de l’art poétique. Son voyage dans l’univers minéral englobe beaucoup de ses à-côtés et lui donne ainsi toute sa profondeur. Chaque pierre examinée, chaque élément ou objet envisagé est l’occasion pour elle de jouer et de méditer sur leur nature propre ou impropre. Elle ne se fait pas tout à fait peintre pour restituer la surface des choses, mais elle ne se fait pas non plus métaphysicienne pour en percer l’essence. Son style dépouillé et pourtant riche et subtil suffit à nous offrir son sentiment profond sur ce qui l’émeut, la touche, la provoque, l’interroge. Chacun de ses petits textes est un récit sur ce qui l’a sollicité. Prenons par exemple ce qu’elle écrit de la pierre de lune: un homme voyage avec un caillou arrondi et se rend dans une île où l’on collectionne les mots et elle y découvre qu’on a baptisé des « pierres issues de l’autre monde ». Sa pierre lui permit de découvrir la beauté du monde et lui apporta le bonheur. Par le biais de cette pierre, elle traduit ce qu’elle lui a inspiré. C’est par conséquent une idée de l’univers qu’elle dévoile par fragments et par touches intuitives. Et c’est aussi une idée de la beauté qui se dégage par le sentiment et l’écriture. |
|