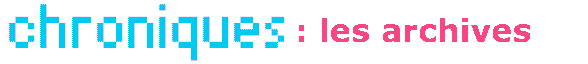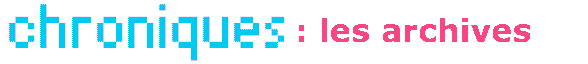Petit éloge de la peau,
Régine Detambel, «Folio », Gallimard. |
Régine Détambel fait partie de ces écrivains qui aiment jouer avec les sens et les contresens que leur procurent les mots. Dans son Petit éloge de la peau, elle digresse sur le thème, en explore tous les aspects, fait remonter à la surface des points de vue inattendus et des enchaînements analogiques vertigineux. Une partie de son histoire personnelle avec la peau tient dans le rapport qui a pu exister avec le parchemin et la kyrielle de métaphores qui s’en sont suivies. Il faut prendre ce petit livre comme une exploration épidermique qui nous force à savourer ce que chaque moment du langage offre comme surprise et comme curiosité, offrant au lecteur un micro encyclopédie sur ce thème des plus fantasques et extravagantes. |
Moments perdus,
Robert Davreu, José Corti. |
«Splendeur du gris prêté de proche en proche à toutes les couleurs»: ce vers est pour moi l’esprit même de la poésie subtile et raffinée de Robert Davreu qui, dans ce nouveau recueil, retrouve les résonances du grand classicisme sans pour autant rien abolir de sa démarche si singulière. Il y poursuit cette quête obscure avec cette tonalité mélancolique (il y fait état de ces eaux noires à traverser) qui sous-tend chacune des lignes qu’il trace, avec cette hantise désabusée du temps, avec ce regard qui se pose sur «le ciel au passé simple ». Dans ce mince ouvrage mais ô combien intense, l’auteur nous convie à le suivre dans cette enquête inépuisable du sens qui oscille entre l’atonal et les couleurs qui ne se disent pas mais qui sont distribuées dans l’espace d’une peinture qui n’ait que de mots. Un poème plus que tous mes autres m’a comblé: «Ivre de l’or des livres/Tu changeas ton or en papier / Et nourris d’encre ta lumière / Mais sur le support jaunissant /Ta lumière en or ne changeas/Si d’or pour tous fut ta parole/Et l’impression que tu laissas/Dans l’inquiétude de ton erre. » N’est-ce pas par ce biais que nous pouvons nous réconcilier avec la poésie de notre temps qui, cette fois, a été loin de se perdre? |
Pound caractère chinois,
Claude Minière, “L’Infini”, Gallimard. |
Claude Minière nous offre un petit voyage en Chine. Mais la Chine dont il nous entretient est celle de sa culture insondable d’idéogrammes. Et, encore plus précisément, de la façon dont certains poètes s’en sont emparés – tout particulièrement Ezra Pound. Les Cantos, on le sait, sont à la fois le journal d’une grande partie de sa vie d’écrivain (le journal intérieur) et le fruit de sa pensée poétique. La Chine y est entrée comme pour donner la véritable clef de sa démarche. Minière en commente les arcanes, les fait apprécier. Mas qu’on ne s’imagine pas un très savant et austère mémoire : c’est plutôt une lecture poétique d’une plus ancienne histoire poétique. C’est pourquoi il se lit avec délice tout en nous faisant apparaître ce qui a mobilisé le fougueux poète américain venu s’égarer en Europe. Il nous fait comprendre comment ces caractères chinois «jouent » dans le flux des Cantos et dans les termes de sa connaissance et de sa passion conjointes. Cela donne un assez beau résultat. |
Gustave Flaubert,
un monde de livres,
Eric le Calvez, Textuel. |
Les éditions Textuel présentent un volumineux album iconographique consacré à Gustave Flaubert dans la collection « Passion ». L’auteur de La Tentation de saint Antoine est remémoré à travers les lieux où il a vécu, ses portraits, ceux de ses amis et relations, ses manuscrits, ses livres. De page en page, son univers se reconstitue. L’auteur a écrit une courte préface pour chaque période de l’existence du romancier et de courtes notes explicatives pour donner un sens et une profondeur aux documents recueillis. Sans doute aurait-on aimé que le texte soit plus étoffé et que ce voyage dans le microcosme flaubertien soit plus étoffé. Quoi qu’il en soit, c’est un ouvrage utile, nécessaire même, pour tous ceux qui désirent mieux connaître Flaubert alors qu’on célèbre le 150e anniversaire de la parution de Madame Bovary. |
Marguerite Duras,
Jean Vallier, «Passion», Textuel. |
La fiction de Bastien Gallet ne saurait laisser indifférent. Une longue forme complètement rouge doit être regardé comme un singulier mélange de roman traditionnel et de roman expérimental, l’un ne cessant d’ailleurs de renvoyer à l’autre dans un jeu de miroir troublant. Tout repose ici sur un drame à tiroirs secrets ; comme si la hantise de la mort était le déclencheur de cette écriture. Il y a au moins une unité de lieu – le château. Mais il n’y a pas d’unité de temps puisque plusieurs générations interfèrent les unes sur les autres, comme le présent avait aussi le pouvoir d’envahir le passé. Une mère qui se meurt, un grand-père ancien combattant (il était monté dans un des premiers chars d’assaut de l’histoire et, comme Cendrars, avait perdu un bras). Et dès que ce dernier est évoqué, ce sont les guerres puniques revues par Gustave Flaubert dans Salammbô qui permettent de ressentir l’horreur des champs de bataille. C’est un poème de mort que l’auteur a transformé en un parcours de la mémoire capable de triompher par l’écriture à l’effroi de la perte des personnes aimées. Voilà un livre qui ne ressemble à aucun autre et qui mérite qu’on s’y arrête. |
Baraliptons,
Philippe Barthelet, Éditions du Rocher |
Baraliptons de Philippe Barthelet est un livre surprenant : comme son titre peut l’indiquer, c’est d’abord sur la langue, sur l’esprit de la langue, que se porte sa réflexion. Alors, comme tous les livres qui reposent sur une idiosyncrasie, des jugements, souvent lapidaires et d’autres fois partiaux, heurtent et suscitent des réactions violentes. Mais beaucoup de ceux-ci provoquent l’étonnement et la réflexion et font, que tout bien pesé ce périple dans l’usage et dans l’esprit des mots reste attachant. L’intelligence est une grande et belle chose. Philippe Barthelet fait preuve ici d’une intelligence aiguisée. Le baralipton, cette cocasserie logique peu recommandable, dont Louis Aragon s’était fait le héraut dans son Traité de style, est ici l’instrument d’une vaste enquête au sein des lettres anciennes et modernes, mais aussi dans les langages modernes et le langage vernaculaire. Il fait parler l’étymologie et les dictionnaires, il montre du doigt des passages incongrus au sein de l’histoire, traque l’insolite linguistique, met à nu la folie des encyclopédies. Quiconque voudrait comprendre dans quel univers sémantique il vit pourra y puiser matière à penser et surtout à ne pas prendre tout au pied de la lettre. |
Les Arbres noirs,
Henri Deluy, «Poésie», Flammarion. |
La poésie d’Henri Deluy, dans son dernier recueil baptisé Les Arbres noirs, semble être une course haletante, vibrante, passionnée et pourtant désabusée. Il faudrait peut-être l’envisager comme une autobiographie qui se construit de manière elliptique, mais aussi par recoupements, croisements (comme on le dit pour les espèces animales), associations de mille sortes (qui ne sont pourtant pas liées au pur hasard). L’auteur nous invite à un voyage dans les temps et les espaces de son imaginaire en se servant d’un langage épuré, comme s’il tenait à capturer ce qui représente l’essentiel de l’existence non par condensation de son essence, mais par l’accentuation de ses accidents et de ces vicissitudes. Les Arbres noirs se lisent comme un roman (qu’on ne se méprenne pas: je ne fais pas une comparaison hâtive et superficielle), dans une tradition paradoxale de la poésie narrative qui nous fait remonter à ses origines. Et je ne peux pas m’empêcher de le voir comme tel, un grand roman écrit avec les outils de la poésie moderne. |
Chants populaires,
Philippe Beck, “Poésie”, Flammarion. |
Philippe Beck, dans ses Chants populaires, en revient à la problématique du conte populaire. Dans son introduction, il revient sur l’histoire des frères Grimm : ceux-ci n’ont pas recueils ces récits auprès de gens du peuple, mais de personnes cultivées de la bonne société. Cela, nous le savions. Cette mise au point lui sert à jeter les fondements théoriques de sa propre entreprise et d’expliquer le titre qu’il a donné à ce recueil. Sans doute est-ce enfin le moyen de rendre compte du paradoxe qui traverse ces textes qui ont la forme fluide d’un récit, mais se construisent en fait par juxtaposition elliptique d’images souvent disjointes. Tradition et moderne s’y conjuguent. Ce qui donne à ce livre une saveur particulière. |
Les Dieux nus,
L’Invention du temps V,
Claude Michel Cluny, Éditions de la Différence. |
Claude Michel Cluny poursuit la publication de son journal littéraire. Dans son nouveau volume, il aborde les années 78-79. Il nous propose une curieuse plongée dans les milieux littéraires de cette période, avec un grand nombre de considérations sur le petit milieu poétique. Ce n’est pas tendre et c’est même cinglant par moments. L’auteur nous convie au grand banquet de la dévoration des écrivains qui sévissaient alors, de la mise à mal des revues spécialisées, etc. ; mais il nous convie aussi à un autre banquet, celui de l’amitié. Et là, il nous donne une leçon exemplaire. |
| BOURLINGUER ! |
Ruines italiennes,
Vincent Jolivet, Gallimard |
Les trois frères Alinari, Leopoldo, Giuseppe et Romualdo ont créé leur studio photographique en 1852. A partir de cette date, ils ont accumulé une archive considérable surtout sur l’Italie. Cet album rassemble un choix de clichés intéressant toutes les régions de ce pays. Il s’agit exclusivement de monuments qui ont été photographiés de la manière la plus dépouillée possible. Si l’on fait exception d’un groupe de voyageurs à Agrigente, il n’y a guère que quelques paysans du cru qui sont entrés dans le champ de leur appareil. Du temple de Trajan à Ancône aux rues de Pompéi, du forum à la villa Adriana à Rome, des sanctuaires d’Héra à Paestum au théâtre de Ségeste, les frères Alinarina nous fournissent l’occasion de voir ces ruines antiques telles que les ont vues les peintres qui sont venus de toute l’Europe pour s’en inspirer. Ce sont là des documents exceptionnels non seulement pour leur valeur documentaire mais aussi pour leur grande inscription symbolique désormais disparue. |
Poussières de Paris,
Jean Lorrain, “cadratin”, Klincksieck |
Entre 1896 et 1902, Jean Lorrain a tenu un journal, qui n’a rien d’intime, où il relate ses voyages dans le Midi et surtout sa vie parisienne. D’une plume alerte, il dépeint ou mieux, il esquisse les bals, les fêtes, les cirques, les courses, avec un ballet étourdissant de danseuses espagnoles, de danseuses des Folies Bergères, de chanteuses. Mais l’écrivain nous fait aussitôt les expositions présentées par les galeries de son temps, l’Exposition universelle et tout ce que Paris peut offrir de curieux ou d’exotique. Plus qu’une chronique (même s’il nous introduit chez de grands personnages d’alors, tels que la belle Otero, le marchand d’art Bing ou l’affichiste Jules Chéret), c’est un état d’esprit qu’il nous fait ressentir, avec une forme d’enthousiasme inépuisable, de griserie de l’instant brûlé au nom de plaisirs qui vont du music hall au legs Gustave Moreau. C’est mieux qu’un document: c’est une véritable radiographie de la Belle Époque.
|
Les Exilés de Montparnasse,
Jean-Paul Caracalla, Gallimard. |
Paris, entre les deux guerres, a été la capitale de plusieurs genres d’exilés. Les premiers sont des exilés volontaires et ce sont ceux-là qui intéressent Jean-Paul Caracalla. Ce sont surtout des citoyens américains, comme Gertrude Stein, Ezra Pound, Scott Fitzgerald, Helena Rubinstein, Hemingway, autant d’Américains attirés par la ville lumière et sa liberté de mœurs. Il y a aussi des Britanniques et des Irlandais, comme James Joyce et la libraire Sylvia Beach, D. H. Lawrence. Le point de ralliement de cette colonie? Montparnasse pour la plupart et ses cafés devenus la plaque tournante d’un cosmopolitisme étourdissant. Cette étude des mœurs littéraires et artistiques des étrangers à Paris demeure un peu superficielle et ne nous apprend rien de bien nouveau. Mais elle constitue une introduction honorable aux moments les plus intenses et aussi les plus chargés de nuages obscurs de notre capitale. Dommage tout de même qu’il n’ait pas élargi sa perspective pour parler des autres exilés, venus de l’Europe centrale et orientale, emportés par le vent de l’histoire. |
|