| |
24-01-2019 17-01-2019 10-01-2019 03-01-2019 13-12-2018 06-12-2018 29-11-2018 22-11-2018 15-11-2018 08-11-2018
|
|
[verso-hebdo]
11-12-2014
|
La chronique
de Gérard-Georges Lemaire |

|
| Chronique d'un bibliomane mélancolique |

Benjamin-Constant, merveilles et mirages de l'orientalisme, sous la direction de Nathalie Bondil, d'Axel Hémery & de Samuel Montiège, Hazan, 400 p., 49 euro
Deux expositions, l'une au musée des Augustins d'Albi, l'autre au musée des Beaux-arts de Montréal, font revivre la figure bien oubliée du peintre Constant de Salinié (1845-1902). Le catalogue s'est transformée est une monographie d'une dimension impressionnante ! Il est vrai qu'il n'y avait aucun ouvrage disponible consacré à cet artiste. Il fait partie de la dernière génération de peintres qui, au XIXe siècle, ont fait raisonner la corde sensible de l'orientalisme. S'il admirait profondément Delacroix (il avait étudié à Toulouse sous la direction d'un ami de cet artiste, François Jean Joseph Benjamin Constant était bien loin de ses Femmes d'Alger ou de son Giaour. Il a retenu une chose de son enseignement : la couleur. Mais pas la recherche du style qui, chez lui reste, assez conventionnel. Il ne faut pas oublié qu'il a été l'élève de Cabanel aux Beaux-arts de Paris. D'autre part, comme ses collègues Gérôme, Regnault, Maria Fortuny i Marsal, il a joué passablement sur le registre des clichés de l'Orient fabuleux et, bien sûr, le harem. Il fait son premier voyage en Espagne et au Maroc en 1871. Ses échecs au prix de Rome, mais son premier succès au Salon en 1867 (Hamlet et le roi, qui est acheté par l'Etat) lui donne l'envie d'exploiter différents filons. Il se marie une seconde fois après le décès de s a première épouse, avec la fille d'Arago et a dès lors ses entrée dans le grand monde parisien. Il fera de nombreux portraits de personnages influents. A la ville il fréquente les hommes et les femmes en vue et, au Salon, il continue à montrer ses visions d'Orient, dont l'Entrée de Mehmet II à Constantinople, qui est acheté par l'Etat pour le musée des Augustins de sa ville natale. Les honneurs vont de paire avec les commandes publiques, comme celle de la salle du conseil académique de la Nouvelle Sorbonne, de la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Paris, de la salle des Illustres du Capitole de Toulouse, de la gare d'Orsay. Il expose à l'étranger, en particulier en Angleterre et à New York, où il réalise de nombreux portraits et fait même le portrait de la reine Victoria à Windsor ou celui du pape Léon XIII. Peu avant sa mort, en 1902, on lui commande une Apothéose de Victor Hugo. En somme, on découvre l'existence d'un homme qui a croulé sous les honneurs, a participés à plusieurs jurys et a fréquenté les grands de ce monde. L'Orient qu'il nous représente est un Orient en grande partie d'invention : seuls les costumes, les objets, les types humains sont vrais. Le reste est le fruit de son imagination qui va à la rencontre du goût de l'époque. Il avait du talent à revendre. Mais sa peinture a vite été oubliée. L'image de l'Orient a été refondue par Matisse, par Kandinsky, Franz Marc, August Macke, Camoin, Paul Klee et quelques autres artistes qui ont été les piliers de l'art moderne. Mais son goût pour l'érotisme aurait dû le sauver de cette déroute ! Comme Gérôme, il a osé des scènes libidineuses dans ces harems qu'il n'a jamais vu. Mais il n'a cependant jamais eu ni la hardiesse, ni le génie d'Ingres avec son Bain turc. Mais nous mettons à son crédit quelques jolies scènes sur les toits de Tanger et des paysages qui, eux, ne mentent pas.
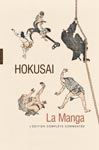
La Manga, Hokusai, présenté par Matthi Forer, Hazan, deux volumes de 450 p. chacun, 57 euro
Les éditions Hazan nous offre le plaisir de découvrir l'intégralité de la Manga, qui se compose de 15 volumes et dont l'exécution a commencé en 1812. L'artiste l'aurait commencé lorsqu'il s'est arrêté dans la ville de Nagoya dans son voyage dans les provinces occidentales du Japon. Il aurait imprimé le premier volume sur place. Cette oeuvre colossale a été entreprise en même qu'il a réalisé les deux tomes de ses Leçons de dessin rapide (1812-1814). Comme définir ce livre ? C'est d'abord une gigantesque encyclopédie visuelle de tout ce qui constitue la vie dans son pays, des paysages aux animaux de toutes sortes, des types humains et des différentes gestuelles, des métiers et des activités humaines, des divertissements et des sujets religieux. Il va à l'encontre de ce qu'il avait pu faire en xylographie, dans le sillages des grandes maîtres de la période d'Edo, qui repose sur une simplification de la ligne et donc de la composition dans son ensemble, mais qui requiert une application extrême. Il est parvenu à obtenir la spontanéité de la peinture zen et une forme graphique très simple et dépouillée, qui saisit l'essence des êtres et des choses. C'est un foisonnement incroyable de manière de représenter le monde physique, les poissons, les animaux domestiques, les bêtes sauvages et de montrer l'humanité dans ce qu'elle a de plus quotidien, mais aussi de plus passionnant. Il ne sublime rien. Mais tout ce qu'il touche, avec son extraordinaire technique, qui conserve toute la saveur du dessin, sa finesse, sa fraicheur et aussi sa précision rendue en quelques traits véloces. Avec Hokusai, l'art d'Edo change de nature : il joue sur deux registres très différents et en principe contradictoires. Et la richesse infinie de son iconographie montre à quel point il a désiré exalté ce Japon et sa culture, mais aussi son industrie et sa manière de vivre. Il veut tout montrer, sans une parole. Ce serait l'Encyclopédie de Diderot et de d'Alembert sans texte !

Camille Claudel, au miroir d'un art nouveau, Gallimard/La Piscine, 250 p., 39 euro
Une littérature considérable a entouré la « redécouverte » de Camille Claudel. Il s'est créé un mythe qui frôle souvent l'absurdité : Rodin aurait été la cause de sa folie, elle aurait meilleur sculpteur que lui, et j'en passe. Des expositions se sont multipliées, avec des hauts et des bas à cause des différents parti-pris des commissaires. Cette fois, nous avons l'impression qu'une rétrospective nous révèle enfin cette artiste telle qu'en elle-même. Les auteurs se sont tous attachés à l'histoire de son oeuvre et non à ses à côtés. Ensuite, on voit bien deux choses : ses qualités techniques dans les ouvrages les moins personnels - je pense aux portraits - et ensuite ce qui la distingue de manière décisive de Rodin, même si son influence se fait encore sentir. Il y a une étrangeté dans son travail quand elle s'affirme qui frappe aussitôt. D'une part, elle entend que ses oeuvres aient une dynamique, qui la pousse à des excès, comme dans son Persée ou dans son Clotho, mais encore plus dans La Fortune ou La Valse. On retrouve chez elle quelque chose de Boldini et aussi de l'Art Nouveau, avec cette dose d'emportement dans le mouvement et de bizarrerie qui fait parfois songer à Wildt. Cet élan, ce mouvement qui va devenir peu après le fondement de la sculpture futuriste italienne, c'est une vision radicale qu'elle apporte au début du XXe siècle. D'autre part, il y a une volonté d'aller outre Rodin, de pousser certaines de ses innovations plus loin, de travailler la matière dans un contraste entre l'anatomie et tout ce qui entoure le sujet. Enfin, il faut ajouter une dose de pathos, dans L'Implorante ou L'Age mûr. Tous ces aspects sont bien mis en valeurs dans le choix qui a été fait par les commissaires de l'exposition, Anne Rivière et Bruno Gaudichon. Je pense que s'il fallait choisir parmi tous les ouvrages publiés sur Camille Claudel celui-ci est le plus riche et surtout le plus à même de révéler les orientations de sa sculpture.

D'un art pour tous, Lionel Richard, La Lettre volée, 78 p., 15 euro
C'est une étude vraiment intéressante : l'auteur nous y révèle comment cette idée, qui paraît si banale de nos jours, a pris corps en France. A partir de 1882, la revue L'Art populaire diffuse une idée novatrice : elle veut vulgariser l'esthétique du beau. En 1893, c'est L'Imagerie populaire qui diffuse ce genre de conception. Un concours est lancé en 1899 pour l'Exposition universelle de Paris pour des objets d'usage courant. Parallèlement, des esprits éclairés voient dans l'industrie la possibilité de produire des choses destinées à tout un chacun. Et, en 1901, paraît La Revue de L'art pour tous. En somme c'est la conjonction de deux aspiration : la diffusion la plus large possible de l'art et sa conjonction avec la production de masse. Bien sûr, on y retrouve l'esprit des Arts & Crafts britanniques et les cycles de conférences pour les ouvriers donner à la Whitechapel Gallery (une institution destinée au peuple située dans le East End de Londres) par John Ruskin, Rossetti et autres artistes ou historien de renom. A partir de là, l'auteur fait l'histoire de la modernité à partir de Charles Baudelaire et de Constantin Guys et c'est absolument passionnant.

Ces sacrés Toscans suivi de Deux chapeaux de paille d'Italie, Curzio Malaparte, « Le goût des idées », Les Belles Lettres, 256 p., 14,90 euro
Excellente idée que de rééditer ces deux ouvrages de Curzio Malaparte ! Moi, j'aurais plutôt associé au premier ouvrage un second qui est son complément, Benedetti italiani. Et puis j'aurais changé le titre qui est erroné : Malaparte a intitulé ce livre Maledetti toscani, ce qui signifie « maudits Toscans ». Ce n'est pas la même chose ! Mais cela est bien secondaire face au plaisir de relire cette étonnante description de l'univers que constitue la Toscane au sein de l'Italie. L'Italie est le pays des particularisme : un Napolitain est bien loin d'un Milanais et une Vénitien n'a pas grand chose à voir avec un Sicilien, ne serait-ce déjà du point de vue de leurs dialectes respectifs. Mais la mentalité et le mode de vie sont différents. Les Lombards ont un côté autrichien qui leur est resté, alors que les Sardes ont un caractère insulaire et une culture toute autre. Ce que fait l'auteur, c'est de montrer en quoi les Toscans se sentent non seulement différents du reste des habitants de la péninsule, mais aussi supérieurs ! Son livre n'est pas construit comme un essai habituel. On a l'impression qu'il est une sorte de dérive sans gouvernail ni barre. Or, en réalité, sa manière d'écrire lui permet de faire des rapprochements ou des distinguos en établissant toutes les nuances possibles. Ce n'est pas un portrait flatteur, mais ce n'est pas non pus un portrait charge : il se moque de la vanité des Toscans qui croient avoir tout inventé en Italie à commencer par la langue commune, l'italien national. C'est vrai qu'elle sort pour une bonne part du toscan de Dante et de Boccace, mais les choses sont plus compliquées que ça ! C'est une merveille de pénétration de l'esprit d'un peuple avec un humour un peu vache et, en fin de compte, une admiration qui accompagne les coups de pieds de l'âne. Je dois dire que j'avais complètement oublié de quoi traitaient les Deux chapeaux de paille d'Italie. Il s'agit de considérations rédigée 1947 sur l'Italie d'après guerre où Malaparte parle de l'épuration (avec ses excès tragiques), des mutations politiques, de la reconstruction, de la tension entre les communistes et les démocrates-chrétiens : ils reprochent aux communistes d'avoir fini par instaurer la dictature sournoise des partisans de l'Eglise. Il a une telle façon de prendre de la hauteur qu'il voyait alors ce que nous comprenons maintenant, un demi-siècle plus tard !

Charles Demailly, oeuvres narratives complètes tome III, Edmond & Jules de Goncourt, édition de Jean-Didier Wagneur et François Cestor, Classiques Garnier, 876 p., 49 euro
Les éditions Garnier poursuivent la publication des romans des frères Goncourt. La préface des auteurs de l'édition est remarquable car elle constitue une monographie du livre sous tous ses aspects, l'histoire de son écriture à sa réception, en passant par ses références et ses desseins. Elle est rédigée avec clarté et un souci de rendre sa lecture aussi agréable qu'instructive. De même, les notes sont toujours pertinentes et ne consistent pas en un pur jeu d'érudition. Elles éclairent le roman. L'affaire de Charles Demailly est une affaire qui commence mal pour les Goncourt et qui ne se termine pas très bien non plus. A l'origine, ils voulaient faire jouer une pièce de théâtre, Les Hommes de lettres. Ils avaient éprouvé le besoin de s'en prendre à un milieu qui avait pris de l'importance dans la presse et dans le monde littéraire, et pas seulement à cause d'Henri Murger. En 1856, ils se décident d'écrire une pièce de théâtre intitulée les Hommes de lettres. Mais les théâtres pressentis n'en veulent pas. Dépités, ils finissent par transformer cette pièce en roman. C'est leur second roman (le premier, En 18.., devait paraître le 2 décembre 1851 ! Il ne sortit que le 5. Jules Janin fut le seul à leur avoir été favorable). Achevé en janvier 1859, il paraît sous sa forme romanesque sans avoir pu être diffusé en feuilleton (autre échec) en janvier 1860 chez l'éditeur Dentu. Le livre est très mal reçu. D'abord, c'est un livre déséquilibré dans sa conception : il conserve une partie des dialogues de la pièces et certains chapitres ne sont pas assez développés. D'autre part, le sujet déplaît beaucoup au milieu, car il est question d'un homme qui déserte la presse (Demailly quitte la rédaction du Scandale pour se consacrer exclusivement à la littérature) et c'est aussi un roman à clefs où l'on retrouve les principaux protagonistes de ladite bohème, on y retrouve Nadar, Scholl, Champfleury ; Théophile Gautier, Théodore de Banville, Constantin Guys. Il est étrange de constater qu'il n'est question ni de Murger ni de Baudelaire... Quoi qu'il en soit, c'est une exercice de sociologie d'un milieu qui mérite d'être redécouvert (on y puisera des comportements toujours actuels dans ce microcosme !), Charles Demailly incarnant l'esprit libre qui entend aller jusqu'au bout de sa conception de la fiction. Le plus amusant de l'affaire est que, bien plus tard, une pièce est tirée du roman (le manuscrit de la pièce originale avait disparu)...
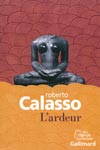
L'Ardeur, Roberto Calasso, Gallimard, 608 p., 29,90 euro
Roberto Calasso est un auteur à deux visages. Il y a le lettré et l'amateur d'art, qui a un perception personnelle et aigue des choses, souvent originale et déconcertante (je pense à la Folie Baudelaire et à le Rose Tiepolo, qui est pour moi son meilleur livre, le plus curieux et le plus juste aussi), le lettré capable d'avoir une lecture raffinée d'une oeuvre complexe, comme c'est le cas avec K. Et puis il y a un autre personnage qui s'intéresse aux mythes et veut, à l'instar d'André Malraux, proposer une vision globalisante et géniale de telle civilisation, de telle culture, de telle religion. C'est alors l'auteur de la Littérature et les dieux, de Ka, et aujourd'hui de l'Ardeur. Il y alors chez lui une sorte de baroquisme cérébral qui se met en branle et aussi une forme de pédanterie de professeur de salon qui s'accroche à une chaire imaginaire. Il faut admettre qu'avec l'Ardeur, il a mis un peu d'eau dans son vin. Mais cette interminable explication des temps védiques et puis des cent chemins proposés par le bouddhisme. Il a fait un effort incontestable pour ne pas être amphigourique comme dans ses ouvrages précédents et il nous faut l'en remercier. Son explication des temps védiques est ici remarquable. La dimension rituelle qui en résulte est aussi exposée avec pertinence et clarté. Les choses commencent à se compliquer avec la figure de Jajñavalkya, qui paraissait détenir la connaissance suprême. A qui l'on s'adressait pour lui poser les questions les plus ardues. Mais là, Calasso commence à tisser un labyrinthe de références anciennes et moderne, de Baudelaire à Renou, qui ne nous aident pas vraiment à comprendre la spécificité de ce personnage. Il glose sur le sacrifice et considère que c'est ce dieu qui aurait aboli le sacrifice des animaux. A partir de là, il part dans un savant développement sur la question rituelle en multipliant les citations qu'experts du passé. Le chapitre consacré à l'érotique védique est plus digeste et donc plus saisissant. Ainsi jusqu'à la fin de l'ouvrage alterne des parties obscures et des parties plus éclairantes. Vers la fin de son immense somme, il donne enfin une raison sous-tendant son énorme travail : « Le Satapatha Brahmana est un contrepoison puissant à l'existence actuelle. C'est un traité qui démontre comment l'on peut vivre une vie totalement consacrée à passer dans un autre ordre des choses, que le texte ose appeler “vérité”. » Après quoi il se lance dans une philippique sur l'introduction du sacré dans le monde sensible. Et il en vient même à parler de l'holocauste en se trompant sur ses causes : il ne s'agit pas uniquement d'assainissement, mais aussi (et de plus en plus) de spoliation. L'holocauste finançait le IIIe Reich. Je ne ferai pas de conclusion. Ce livre est respectable car il représente une quantité incroyable de recherches et de réflexions. L'auteur en tire des conclusions que je laisse à d'autres que moi le soin de juger.

Journal d'un poète, Sergueï Essenine, édition bilingue, traduit du russe et présenté par Christine Pighetti, Editions de la Différence, 288 p., 23 euro
Nous avons tous entendu parler d'Essenine : nous le voyons comme un des grands poètes de la révolution russe de 1917, comme l'époux d'Isadora Duncan et comme le jeune suicidé de Petersburg. Mais son oeuvre, nous n'en avons pas la moindre idée. Cette anthologie conçue par Christine Pighetti est une merveille car elle permet de mesurer le talent immense de ce jeune poète qui s'est donné la mort à l'âge de trente ans. Tout d'abord, sa poésie est aux antipodes de celle de Maïakovski et de Khlebnikov. Ce n'est ni un moderniste, ni un propagandiste du LEF. Non, c'est un regard sur la Russie rurale pour l'essentiel, celle d'où il provient, de ce monde des Grands Russes et aussi des Vieux Russes, ces chrétiens orthodoxes extrémistes. On y voit plus Riazan, sa ville natale, que Moscou et on y voit surtout cet univers ce monde rural qui paraît ne pas avoir d'âge. Surtout dans ses poèmes courts, on découvre sa faculté inouïe de représenter un moment, un paysage, une émotion avec une rare concision et pourtant un langage moderne, car Essenine n'est pas un passéiste. Ses sujets (pour l'essentiel) sont bien ceux de son enfance, son écriture est celle d'un jeune auteur qui veut changer les paramètres de la poésie dans un pays en pleine ébullition. Mais il a conscience que ce grand chambardement ne va rien apporter de bon en littérature. Quoi qu'il en soit, il faut découvrir Essenine !

La Marquise de Sade, Rachilde, préface d'Esther Silva, « L'Imaginaire », 322 p., 9,50 euro
Idée amusante que celle de rééditer ce roman de Rachilde, publié en 1897. Il n'a pas fait vraiment scandale à l'époque, mais il a tout de même soulevé quelques polémiques. A part Jean Lorrain, son grand ami, pas grand monde ne l'a apprécié. Monsieur Vénus, paru trois ans plus tôt avait fait plus de tapage. Et le personnage de Rachilde (de son vrai nom Marguerite Eymerie) se voulait scandaleux : elle se qualifiait d'homme de lettres et portait des vêtements masculins ! Elle cherchait par tous les moyens à faire sensation. Aujourd'hui, ce qui pouvait sembler extravagant et même violent dans ces pages fait sourire. L'histoire de cette petite fille de militaire (son père, Daniel Barde, est colonel de hussard) qui perd sa mère lorsqu'elle donne naissance çà son frère cadet (qu'elle laissera mourir écrasé sous le poids de la nourrice ivre morte), qui vit ensuite sous le toit de son oncle, un médecin déjà âgé d'excellente réputation, doit faire face aux duretés de l'éducation des enfants au XIXe siècle. L'oncle tombe amoureux de la nièce, mais celle-ci s'est vit décidée : elle veut épouser le comte Louis de Caumont, un viveur. Le soir de leurs noces, elle lui explique qu'elle ne sera jamais à lui. L'homme en perd en partie la raison. Elle finit par retourner vivre chez son oncle et y retrouve un jeune homme, Paul Richard, qui est le fils illégitime de son propre mari ! Celui-ci tombe éperdument amoureux de la jeune femme, tente de se suicider, tombe malade, et elle continue à le voir, en faisant qu'attiser son désir et son désespoir. Elle a décidé de faire souffrir tous les hommes qui l'aiment. En somme, cette histoire, qui se situe entre le mélodrame et le vaudeville, qui a une indéniable connotation féministe, est celle d'une femme qui veut vivre sans entrave. C'est divertissant, mais ce n'est pas une grande oeuvre !
|
Gérard-Georges Lemaire
11-12-2014 |
|
|
| Verso n°136
L'artiste du mois : Marko Velk
|
visuelimage.com c'est aussi
|
Afin de pouvoir annoncer vos expositions en cours et à venir
dans notre agenda culturel, envoyez nous, votre programme, et tout
autre document contenant des informations sur votre actualité à : info@visuelimage.com
ou par la poste :
visuelimage.com 18, quai du Louvre 75001 Paris France
À bientôt.
La rédaction
Si vous désirez vous désinscrire de cette liste de diffusion, renvoyez simplement ce mail en précisant dans l'objet "désinscription". |
|
