
Rik Wouters, rétrospective, Musées royaux des Beaux-arts de Belgique / Somogy Editions d'art, 304 p., 39 euro.
Cette exposition a le grand mérite de nous présenter un artiste que nous ne connaissons pas à moins d'être spécialisé dans l'art belge du début du XXe siècle. Rik Wouters (1882-1916) a eu la chance de ne pas voir son projet de devenir artiste entravé par sa famille : son père est fabriquant de meubles et utilise les talents précoces de son fils pour son atelier. Il peut ensuite s'inscrire à l'Académie des Beaux-arts de Malines, sa ville natale, puis à celle de Bruxelles. Mais ses début dans la capitale belge sont très difficiles : il ne vend rien. Il se marie avec Hélène Duerinckx en 1905 et le couple connaît la misère. En 1907 Wouters présente au Salon triennal de Bruxelles une sculpture, Rêverie, qui lui vaut un second prix. Il fait surtout des portraits pour vivre, qui sont d'une facture plutôt classique. Mais il commence à peindre des peintures allégoriques, qui s'inscrivent dans l'esprit du symbolisme de l'époque. Ce changement de thème correspond à une profonde modification de sa manière de peindre, plus libre et aussi plus élaborée. Il est néanmoins demeuré dans une optique assez classique. Mais il a évolué très vite. A la fin des années 1900, il est conquis par le fauvisme comme le prouve ses Rayons de soleil. Toutefois on ne saurait parler d'un suiveur, car la lumière joue dans ses compositions un rôle aussi important que celui de la couleur. L'influence de Paul Cézanne s'est faite ensuite sentir très profondément : il a éclairci sa palette et n'a plus cherché la finition des formes et encore moins des paysages. C'est alors qu'il s'est trouvé un style propre, qu'il avait déjà ébauché dans de petites pièces dès 1907. Son Intérieur d'aquarelliste (1908) monte bien qu'il avait déjà opté pour une facture moderne et libre, ce qu'il a confirmé dans son Autoportrait de la même année. Ses paysages se sont alors révélés une interprétation très personnelle de l'enseignement de Cézanne : il suffit de contempler le Jardin du Coin du Bali de 1910-1911 pour comprendre que ce que le maître à peine disparu a pu lui apporter sans pour autant le placer dans sa perspective. C'est surtout pour lui un instrument d'émancipation et aussi une manière de laisser dans le vague les fonds, car il se libère de cette question par des ajustements peu élaborés de la couleur pour se concentrer sur le sujet, comme cela se voit même dans ses portraits. IL subit aussi d'autres influences, ce qui lui assure une grande indépendance dans sa conception du tableau. Sa Femme assise devant une fenêtre ouverte (1911) en est la démonstration. Il y a un peu de postimpressionnisme, un peu de Cézanne et un peu de l'esprit des Nabis. La Femme dans un intérieur (1912) a une lointaine connivence avec Bonnard alors que sa nature morte, Les Champignons (1911), est plus proche de Cézanne pour la table au premier plan et plus voisine des Nabis pour le fond. Quant à La Repasseuse de 1912, il a commencé à prendre le large, même si le principe de la composition est une réminiscence de Manet. Cette année 1912 est déterminante dans son histoire car non seulement il a travaillé beaucoup, mais il a aussi pris de l'assurance. Il est devenu un peintre moderne au plein sens du terme, il a possédé dès lors son langage plastique. Cependant, il n'a pas voulu s'arrêter à une formule : un an plus tard, il en est revenu à des formes plus dessiné. Mais l'abondance de tissus colorés dans Hommage à Cézanne (Pommes et fleurs artificielles) introduit une autre inclination de son esthétique : il y a en lui un fort désir de rester ancré dans la réalité, même s'il la métamorphose. Et, encore en 1913, il a achevé Les Rideaux rouges, avec un portrait de femme en pied, qui tire vers la monochromie et fait un peu songer à Matisse. Tous ces rapprochements sont à prendre avec précaution, car il s'agit d'analogie plus ou moins voulues, mais toujours avec une profonde distance. Qu'on observe de près Le Ravin (1913) : là, il serait plus dans l'optique des expressionnistes, avec des teintes plus tendres. De fait, il joue de tous ces registres avant et au début de la Grande Guerre. Les nombreuses oeuvres sur papier sont là pour nous conforter dans l'idée que Wouters a été un artiste d'un grand intérêt. Mobilisé, il tombe malade en 1915 et est opéré à Utrecht d'un cancer. Il a perdu un oeil et une partie de sa mâchoire a été détruite. Mais il s'est remis à travailler et est opéré une troisième fois et il est mort en juillet 1916. On ne peut donc connaître l'artiste de la maturité.

Pissarro à Eragny, la nature retrouvée, sous la direction de Richard Brettell & Joachim Pissarro, Musée du Luxembourg / Réunion des musée Nationaux - Grand Palais, s. p., 35 euro.
Camille Pissarro (1830-1903) n'a pas été un puriste ni le gardien de l'idée première de l'impressionnisme. C'est une vision superficielle des choses. Il a été un peintre acharné à rechercher dans la peinture une autre manière de transposer la réalité. Il a préservé la réalité et pourtant il a su la représenter sous une forme encore jamais connue. Mais qu'on ne fasse pas de lui le chantre de la vie rurale, une sorte de Millet qui magnifie la vie paysanne et les paysages encore inaltérés des champs et des vergers. La dernière partie de son oeuvre s'est d'ailleurs tournée vers la ville et, comme Manet, Renoir ou Caillebotte, il a eu la volonté d'en restituer la beauté et la modernité. Il est vrai néanmoins que les scènes champêtres, comme dans le cas de Claude Monet, l'ont profondément inspiré, parce que sans doute c'était le meilleur moyen d'approfondir le sillon d'une recherche picturale exigeante et complexe. L'idée de choisir un des lieux où il a vécu, Eragny, où il s'est installé en 1884, est excellente car le musée du Luxembourg à Paris ne saurait contenir une rétrospective. C'est vraiment étonnant car on a la possibilité de voir l'évolution incessante de sa manière de peindre. En effet, presque chaque tableau est une expérience différente. Bien sûr, il y a des fondamentaux qui ne changent pas. Mais il y a aussi des tentatives faites dans telle ou telle circonstance, qui ont été le début de quelque chose de neuf. Je prends un exemple : la Vue de Bazincourt, ciel rouge. Le ciel tient en effet une place prépondérante. Au sol, c'est le vert et un peu de brun qui domine, qui s'accordent assez aisément à la nature. Le ciel, lui, est traité avec une plus grande liberté, car ce n'est pas le fait qu'il soit envahi en partie par une tonalité rouge, mais la façon dont ce rouge cohabite avec des bleus et des jaunes, et contraste avec le champ et les arbres. Et regardons maintenant cette autre vue de Bazincourt : Effet de neige - soir. Là, c'est naturellement le blanc qui domine. Mais le ciel est d'un jaune cireux assez étrange, comme granulé mais cependant uniforme. En revanche, quand il a peint Le Bain de pieds, il a traité cette scène charmante un peu comme l'aurait fait Corot, avec les branches des arbres se penchant harmonieusement vers la petite rivière. Il s'y montre à la fois plus pondéré dans sa manière et aussi plus poétique. Il n'y a pas une seule oeuvre où il n'ait pas entrepris d'introduire une variation dans son style. On découvre ainsi un peintre d'une richesse inégalée. Ses aquarelles, ses gouaches, ses dessins sont eux aussi très instructifs sur son état d'esprit. Là aussi, tout est en mouvement. Il ne s'arrête jamais à une formule ou à une vision figée de comment aborder un paysage ou un groupe de figures. Il peut vouloir le cerner d'un trait appuyé ou, au contraire, en faire une rapide ébauche chromatique. En somme, c'est une leçon que nous dispense cette exposition, une leçon qui ne passe que par l'accrochage des oeuvres aux cimaises. Elle nous fait revoir Pissarro comme un artiste brillant, intelligent, qui n'arrête jamais de repenser sa peinture et qui ne renonce jamais à ses convictions, même s'il a pu avoir plaisir à faire, parfois, un petit pas en arrière, pour renouer avec une belle façon d'envisager le sujet.

Rodin, son musée secret, Nadine Lehni, préface de Catherine Chevillot, musée Rodin / Editions Albin Michel, 272 p., 35 euro.
Tous ces dessins ne sont pas inédits : il y a déjà eu des expositions dont celle du musée Singer Laren en 2013 et celle du musée Félicien Rops. Mais peu importe. Ce livre est une petite merveille et le titre d'ailleurs est parfait, car il ne fait pas de lui une sorte de pervers obsessionnel ! En effet, il faut séparer absolument les études de nus des oeuvres proprement érotiques, dont de passionnés accouplements. Si beaucoup de ses nus de femmes peuvent paraître très osés, c'est qu'il recherchait des positions du corps souvent inusitées dans la sculpture, mais même dans la peinture. Il tentait de découvrir ces corps dans leur vérité la plus saisissante et inconnue dans l'art. Il est évident qu'en procédant de la sorte, il a mis à nu ce sexe loin d'être stylisé que Courbet avait représenté de manière provocante avec L'Origine du monde. Et justement, Rodin stylise, rend presque abstrait ces femmes aux positions singulières. Il les rend plus nues d'un côté, mais les rend plus irréelles de l'autre. C'est dans ce paradoxe qu'il a joué cette quête de vérité anatomique. De plus, il y a ajouté un surcroît de beauté, car jamais il n'est arrivé jusqu'à la pornographie, comme a pu le faire Félicien Rops, qui avait l'oeil égrillard, mais aussi caustique et provocateur. Auguste Rodin n'est pas un artiste qui court derrière l'idée de provoquer ou de choquer. Il y a chez lui quelque chose qui se rapproche de Degas, qui a aimé cultiver des distorsions des figures, autant pour ses danseuses que pour ses femmes en train de se laver. Bien sûr, Rodin a aussi rendu une sorte de culte au sexe féminin en procédant de cette sorte et l'on n'ignore pas qu'il portait au sexe faible un intérêt très marqué. Un désir de crudité sans excès se double donc d'un désir de mettre en avant le désir dans son exercice le plus criant. La pureté du trait (pas nécessairement classique), le choix chromatique avec ces ocres très clairs, souvent limpides, parfois usant de bichromie avec du rouge ou du bleu. Ces couleurs sont choisies avec soin pour rendre son dessin un peu éthéré et ses croquis sexuels comme appartenant à un monde onirique dépourvu de violences ou de vulgarité. Son « musée secret « est composé de cent vingt et un numéros. Sur les quelques sept mille dessins qu'il a pu exécuter, c'est peu de choses. Mais, en fait, c'est assez considérable. Une autre chose à préciser : si, comme tous ses contemporains, Rodin connaissait et appréciait les xylographies japonaises de l'ère d'Edo, dont un bon nombre étaient de nature érotique, il ne place pas les scènes d'amour qu'il a reproduites selon sa propre vision dans un contexte concret. Elles surgissent toujours dans un univers de coloris tendres et hors du temps. C'est un corps à corps imaginaire, même si les êtres ont une densité et une forme qui ne sont pas irréelles. Il faut enfin se souvenir qu'à la même époque des artistes comme Gustav Klimt et Egon Schiele ont fait des tableaux qui avaient une intensité érotique encore plus incisive dans des oeuvres en partie présentées au public. Il participe à une époque marquée par la psychanalyse et aussi des formes d'érotismes qui ont pris des tournures très différentes au sein de l'Art Nouveau et des Sécessions d'Europe centrale, et parfois avec une intention mystique. Point de mystique chez Rodin, mais un abyssal amour de l'amour et une vénération pour le corps féminin qui n'est ni sacralisé ni désacralisé. Il le transporte néanmoins dans la sphère du beau, l'idéalise en dépit de son naturalisme, même si les gestes sont de temps à autre dignes du culte de Priape chez les Latins.

Éloge de la couleur, sous la direction de Sylvette Botella-Gaudichon, Cloé Pitiot, Marion Guibert, La Piscine, Roubaix / Centre Georges Pompidou, 29 euro.
Cette exposition pourra paraître dans un premier temps assez ésotérique pour les visiteurs car elle traite d'un sujet assez mal connu du public (et même des personnes liées à l'art et à l'architecture). Mais c'est justement ce qui fait tout son intérêt : si les relations entre la couleur et l'architecture, du Parthénon à Le Corbusier, en passant par les cathédrales médiévales sont bien connues, on ignore presque totalement qu'il existe des spécialistes de la question de la couleur dans l'architecture moderne et contemporaine. On peut ainsi apprendre comment ces personnes, qui ne prétendent pas être des artistes ni des architectes, ont pu penser la construction en couleur. En fait, apprend-on, c'est après la dernière guerre qu'apparaissent des professionnels qui jouent un nouveau rôle dans l'urbanisme : le coloriste conseil. Leurs méthodes de travail sont exposées et expliquées. Ils plaident tous pour une polychromie de la ville ou des ensembles industriels, pour rompre la monotonie du paysage engendré par ces bâtiments. Pour ce faire, ils imaginent des considérations liés à l'urbanisme d'un quartier ou d'une zone géographique et imaginent des échelles de couleurs en fonction de ces dernières. C'est passionnant car chacun a une démarche différente. Les commissaires ont retenu un petit groupe de ces nouveaux acteurs : l'Atelier Cler, Jacques Fillacier, Victor Grillo, Bernard Lassus, André Lemonnier, Jean-Philippe Lenclos, Georges Patrix, Fabio Rieti, Ryoichi Shigeta (décédé en 2016, auteur d'un projet de décoration de cheminées d'usine tout à fait remarquables), et Dan Resinger. Les gammes chromatiques peuvent prendre chez eux un caractère somme toute classique, dans le droit fil des recherches de Michel-Eugène Chevreul, dont l'influence a été énorme chez les postimpressionnistes, ou s'appuyer sur l'organisation minérale, florale et construite d'un territoire donné. D'autres encore tiennent en ligne de compte les données chromatiques issues de la tradition vernaculaire. Ce voyage dans ce monde inconnu permet de réfléchir sur le devenir de l'architecture, dont certains grands représentants ont inclus la couleur dans leurs recherches, comme par exemple Auguste Perret au Havre avec des bétons colorés, mais il s'agit ici de voir la question plus largement encore en incluant d'emblée la couleur dans les plans des édifices. Cette exposition des plus instructive est complétée par la donation de deux de ces professionnels qui ont eu une activité artistique propre, André et Monique Lemonnier. Ce qui est curieux, c'est que les oeuvres se situent dans le prolongement de leurs spéculations architectoniques. Bien sûr, il aurait été bien qu'on puisse voir des travaux d'artistes qui ont oeuvré sur des questions parallèles, comme Agam ou Rougemont et surtout l'artiste de Saragosse, Santiago Arranz, qui est le seul artiste qui ait pensé l'intervention dans une construction en parfaite symbiose avec l'architecte. Mais deux oeuvres en relief de Jean-Loup Champion, sans combler ce manque, donne une idée de cet intérêt portée par certains créateurs à l'intervention artistique dans un tel contexte.
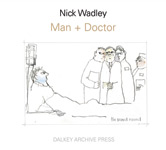
Man + Doctor, Nick Waldey, Dalkey Archive Press, s. p., $ 17.95. pour les autres ouvrages : www.nickwadley.net
Nick Waldley s'est forgé une solide réputation comme historien de l'art (surtout à propos de Gauguin et du postimpressionnisme) et comme collaborateur du Time Literary Supplement. Mais il a une autre corde à son arc : le dessin. Il n'a affirmé ce don incontestable que depuis quelques années. Il peut être rangé dans la catégorie des « Humoristes » comme on aimait à qualifier au XIXe siècle ces artistes qui ne cherchaient pas à exposer au Salon puisqu'ils avaient dans les journaux une salle d'exposition permanente et un vaste public pour les y connaître. Il n'a jamais cherché à pénétrer dans la sphère de l'art avec un grand A, mais il n'en est pas moins un grand artiste car la caricature peut être un art. Beaucoup de grands artistes l'ont cultivé comme Frantisek Kupka et encore plus Daumier ; d'autres l'ont intégré complètement dans leur art majeur, comme Reynolds ou Félicien Rops. Dans son cas, chaque vignette est un petit bijou d'humour, certes, mais aussi une merveille graphique. Il n'est pas allé du même pas de ses contemporains. Il a voulu retrouver l'esprit des grands dessinateurs des années 1950, avec leurs traits très sobres et leurs rondeurs. Il peut avoir recours aux légendes, ou non. Cela le laisse libre de créer un effet comique par le seul jeu de ses crayons ou de renforcer l'effet (ou même de le redoubler) par l'usage du langage. Son univers est placé à l'enseigne de la simplicité et de l'expérience commune. Dans Men + Doctors, il ne fait que mettre en scène ce dont nous faisons l'expérience dès que poussons la porte du médecin ou de l'hôpital. Il recherche même cette banalité pour parvenir à engendrer une universalité de son propos. Son dépouillement du côté sémantique comme du côté graphique va de pair avec cette sobriété de son dessin. Et s'il privilégie le noir et blanc, il ne rejette pas la couleur si elle lui est utile. Enfin, s'il peut être caustique, il s'applique à ne jamais tomber dans la caricature politique, sociale ou humaine. Dans Women Seen... and Thought, il a élargi le champ des possibles en utilisant d'autres techniques et plus de couleurs. Il a aussi multiplié les options stylistiques selon l'objectif visé et croque de nombreux portraits de types de femmes. Quant à Man + Table, il cultive volontiers son goût prononcé pour l'absurde, mais toujours avec la même économie de moyens. Chacun de ses recueils est donc spécifique, délivre un autre aspect de sa personnalité et de son envie de se servir de la technique du dessin selon la fin qu'il a voulu poursuivre. Dans son Blue Owl, qualifié de « poèmes-tableaux » (ou l'inverse), il a beaucoup utilisé des citations ou des références à de grands personnages de l'histoire, comme Francis Picabia ou Joséphine de Beauharnais, Gauguin et même Brahms. Il peut aussi avoir recours à des pastiches ou à ses propres mots. Enfin, il a exécuté récemment un magnifique et luxueux album à tirage limité avec dix planches sur Franz Kafka, qui sont magnifiques. Mais toujours dans le même esprit. J'irai jusqu'à croire que le sérieux imperturbable du TLS, où il ne s'agit pas de plaisanter, l'a renforcé dans son envie de cultiver un humour parfois mordant, mais jamais féroce - un humour un peu bouffon, et grandement poétique.

Expression Terre, Cloches, clochettes et grelots, La Piscine / Edition école d'art de Douai, 104 p., 10 euro.
Les deux règles de ce concours organisé par l'école d'art de Douai étaient précises : que les objets soient réalisés en céramique et que ce soit de vrais cloches (mais avec la possibilité de décliner le thème : clochettes, grelots, etc.). Et le résultat est franchement plaisant car les propositions sont aussi diverses que singulières. Il y a là la manifestation d'une créativité tout à fait étonnante dans le domaine des arts appliqués. On aimerait beaucoup que tous les concours présentent la même qualité d'ensemble. Au fond, c'est dans la sphère des arts plastiques que les choses sont déconcertantes quand on peut voir les ateliers des aspirants artistes. Là, on est le plus souvent très loin du compte. Ici, au contraire, on constate que, bien dirigés, les élèves ont su trouver des solutions vraiment originales et de toutes les sortes imaginables. C'est une belle réussite. Si vous avez l'occasion d'aller à la Piscine pendant sa période de grands travaux, cette petite exposition mérite qu'on s'y arrête un moment.

Jean-Louis Delbès, une autre histoire, Philippe Cyroulnik, Romain Mathieu, avant-propos de Laetitia Pesenti, Arnaud Bizalion Editeur / Images Actes liés, 168 p., 29 euro.
Disparu en 2004, Jean-Louis Delbès a été un artiste apprécié en son temps. Philippe Cyroulnik, qui a été l'un de ses principaux défenseurs, connaît donc bien l'évolution de son oeuvre, de sa pensée, de ses rêveries plastiques. Voilà un artiste qui représente assez bien la situation de l'art français de la fin du siècle dernier. Il a navigué entre différentes influences, qui vont de la figuration narrative au grafitisme, en passant par bien d'autres, de Francis Picabia à Cy Twombly. Mais ce fut tout sauf un imitateur ou l'homme d'une mode. Il a tenté de faire des synthèses personnelles et aussi de faire des expérimentations personnelles dans un esprit tout autre que conformiste. En plus de l'introduction très dense de Cyroulnik, on trouve une anthologie de textes écrits à son sujet de son vivant, avec Lamarche-Vadel, Kæpellin, Partouche, Pradel, etc. L'ouvrage est richement illustré, ce qui nous permet d'avoir une image assez claire de son parcours et des réactions qu'il a suscitées. Ce qui est très surprenant pour un observateur tel que moi, qui a commencé à observer de près l'art de son temps au milieu des années 1970, c'est l'extrême facilité avec laquelle ce peintre a pu changer d'orientation aussi aisément et aussi souvent. Au fond, il n'a pas du tout eu l'idée d'une ferme conception qu'il aurait maintenu coûte que coûte. Au contraire, il a souhaité brouiller les pistes. La présentation simultanée de quatre expositions à Marseille va donner l'occasion aux amateurs de découvrir toutes les facettes de son art. Je me garderai bien de donner un jugement définitif sur sa production plastique car sa vie a été tronquée trop vite. On ignore s'il aurait voulu, un jour ou l'autre, choisir une voie qui ne soit pas toujours entre deux ou trois tendances contemporaines ou modernes, comme s'il croyait que la peinture n'avait plus rien de neuf à dire et ne peut plus se faire que par le biais du pastiche ou de synthèses improbables. En plus, on s'aperçoit qu'il a eu des périodes où il a affirmé un style et une idée. Puis il a de nouveau brouillé les pistes. Cela mérite réflexion et je ne doute pas un instant que ces quatre lieux proposent plus de quatre visions contrastées du même créateur.

Umberto Mariani, Skira / Opera Gallery, Paris, 144 p.
Le nom d'Umberto Mariani ne sera pas des plus éloquents pour la plupart des amateurs français. Il ne l'était d'ailleurs pas tant en Italie il y a quelques années sauf dans les petits cercles très informés de l'art contemporain. Il y a trois ou quatre ans, son nom est apparu soudain au firmament de cette sphère exclusive et bien au-delà. Il apparaît maintenant parmi les grandes figures de l'art italien. Sa première exposition personnelle à Paris (il a bien participé à des expositions collectives, comme « Le Noir absolu ») s'inscrit dans cette dynamique. L'année dernière, la fondation Mudima de Milan lui a rendu hommage à l'occasion de ses quatre-vingts ans avec une grande exposition où l'on a pu découvrir ses dernières oeuvres, des monochromes blancs et des monochromes en or (le tout accompagné par un fort volume publié par ladite fondation). Le parcours de Mariani n'est pas banal : il a commencé par des tableaux figuratifs, entre le Pop Art et la figuration narrative. Puis il s'est orienté vers une abstraction radicale. Par « radicale «, je veux parler de la monochromie. Mais il n'a pas été un lointain suiveur de Robert Rauschenberg. Il a éprouvé le besoin de jeter un pont entre l'art classique (ou néoclassique) qu'il a découvert pendant ses études à l'Accademia di Belle Arti di Brera à Milan. L'idée du plissé, du drapé, en somme des vêtements antiques des copies en plâtre ornant les couloirs de la vieille institution, est restée comme le meilleur moyen de faire ce lien entre le passé de l'art et le présent. Pour parvenir à ses fins, il a fini par trouver la solution technique à ses problèmes (surtout le rendu des plis) en utilisant le plomb, malléable et donnant une sensation paradoxale de légèreté et de souplesse. La gamme de ses couleurs est très étendue car elle embrasse le blanc aussi bien que le noir, le rose autant que le bleu, les rouges ou le jaune. De plus, il ne cesse de varier la disposition de ses plissés, qui peuvent être disposés simplement, donnant l'impression d'un rideau de scène, ou soumis à des entrecroisements complexes. Ils peuvent aussi associer des rouleaux horizontaux et des plissures plus ou moins serrées formant des triangles alternés ou emboîtés ou des cercles, ou des ovales ou des losanges, etc. En sorte qu'il ne s'arrête jamais à un mode de production unique. Il a aussi conçu des pièces qui sont de grandes lettres (le X, le K, le Y, rappelant, là encore de très loin, les spéculations des suprématistes russes). Plus récemment, il a exécuté des ouvrages en deux couleurs (noir et blanc) qui sortent de l'espace conventionnel du châssis. Il ne fait aucun doute qu'Umberto Mariani sera montré d'ici peu de temps dans un espace public dans notre pays. C'est une oeuvre formidable, qui prouve que la peinture moderne peut encore être transposée dans un registre propre à notre nouvelle sensibilité.

Un amour de mille-an, Akira Mizubayashi, Gallimard, 268 p., 20 euro.
C'est d'abord un roman d'amour. Mais d'amour dans le sens le plus vaste qui soit : un amour entre homme et femme, mais aussi un amour dévorant pour la musique, et surtout avec l'opéra européen, surtout pour Mozart. Tout commence au Japon. Un jeune garçon Sen-nen éprouve une grande attirance pour la musique et surtout le chant. Cela devient bientôt une vraie passion. Mais après la disparition de son père, il doit songer à une profession plus conventionnelle. Et puis il a fait la connaissance d'une jeune fille française, Mathilde, avec laquelle il se marie. Ils ont une fille, Emilie (qui va hériter plus tard de la passion de son père pour le chant et l'opéra). Leur vie se déroule d'abord au Japon et puis ils vont s'installer à Paris. Notre héros fréquente l'Opéra Garnier, sans doute pour se distraire de la pensée de la maladie de sa femme. Là il est subjugué par la soprano, Clémence, qui tient le rôle de Suzana dans Le Mariage de Figaro. Il va l'écouter tous les soirs. Et puis il trouve le courage de lui écrire et, n'ayant pas de réponse, il recommence. Ils se connaissent et se perdent de vue, mais se revoient plus de vingt ans plus tard et renouent leur relation avec une passion renouvelée. C'est un roman somme toute classique, construit avec délicatesse, mais reposant tout de même sur des lieux communs (Mozart !) et sur des circonstances dramatiques un peu trop exagérées pour justifier une relation amoureuse, aussi cachée soit-elle. Tous ces sentiments et tous ces rêves esthétiques sont traités avec beaucoup de délicatesse - mais exclusivement derrière le nom du grand génie musical ! Je dois avouer l'avoir lu avec plaisir car c'est bien écrit, jamais ennuyeux, et le récit se déroule sans accroc, avec une narration sobre et agréable. L'amour a du goût et de la sensibilité, mais reste bien trop conventionnel.

Hemingway, Hammett, dernière, Gérard Guégan, Gallimard, 240 p., 18 euro.
Il existe dans le style de Gérard Guégan une force d'attraction assez puissante. Elle peut étonner car il a écrit ce curieux roman d'une manière qui n'a rien de surprenant dans son écriture : lisse, brève, sans porosité. Mais la construction de l'histoire est, elle, très spéciale puisqu'elle repose sur des chapitres très courts et des sous-chapitres qui sont encore plus concis. C'est là que réside sa force. C'est prenant et ingénieux et, malgré sa brièveté, l'histoire est prenante. Et pas seulement parce qu'il s'agit de deux écrivains célèbres, Ernest Hemingway et Dashiell Hammett (avec en plus la présence insistante et saugrenue de Dorothy Parker). En réalité, ce sont les relations entre les deux hommes et le croisement de leurs obsessions qui se trouvent au centre de cette affaire. J'ai parlé de roman, mais ce n'est pas un roman dans le sens banal du terme (loin s'en faut) et l'auteur parle d'ailleurs de « mélodrame », ce qui est d'ailleurs surprenant. Peut-être est-ce une connotation ironique, peut-être est-ce dû à la forme qu'il a choisie. Car, en fin de compte, il n'y a rien de mélodramatique dans cet ouvrage. Sans doute l'auteur a-t-il voulu y distiller un parfum de paranoïa car les deux hommes de lettres sont convaincus d'être surveillés par le F.B.I. L'un aimait séjourner à Cuba après la révolution et l'autre était communiste : leurs craintes étaient peut-être justifiées. A partir de là, Gérard Guégan joue sur leurs grandes différences et sur ce qui les rapproche contre toute attente et esquisse ce qu'a pu être l'atmosphère politique qui a régné aux États-Unis après la chasse aux sorcières lancée par McCarthy. On découvre du même coup deux personnages qui [ont ?] ce rapport assez bizarre motivé par leur anticonformisme et leur goût de l'excès. Ce qui se dessine dans ces pages, ce sont des portraits croisés, qui sont à la fois réels et imaginaires et deux destins qui ne vont plus tarder à se conclure, Hammett mourant d'un cancer et Hemingway se donnant la mort peu après. Quelques personnages secondaires renforcent la noirceur de l'histoire, comme l'énigmatique Geena. Mais c'est presque une pièce, entre le vaudeville et le mélodrame : ce serait plutôt comique si l'on ne comprenait pas que ces deux magnifiques écrivains ne sentaient pas un danger les menacer. Il s'éloigne beaucoup des biographies officielles qui arrondissent les angles et ont tendance à magnifier le personnage, sans pour tomber dans la caricature et le renversement des idoles.

Imagine que je sois parti, Adam Haslett, traduit de l'anglais (États-Unis) par Christophe Mercier, 448 p., 23 euro.
Pour moi, Adam Haslett est un inconnu. J'apprends qu'il est né en 1970 à Port Chester, qu'il a fait des études assez modestes, que c'est un chasseur de bourses (Guggenheim, Rockfeller, etc.) et qu'il n'a eu jusqu'à présent qu'un seul recueil de nouvelles traduit, Vous n'êtes pas seul. Il a écrit ensuite Union Atlantic, qui a paru en 2010. Il a eu quelques récompenses et son nom est apparu en vue de grands prix, comme finaliste, mais il n'a en obtenu aucun. Toutefois, la presse de son pays semble bien l'aimer et loue ce dernier livre pour son humanité et sa description de l'« économie politique des familles » [sic]. Pour moi, c'est l'apologie du bon vieux roman américain, vraiment à l'ancienne (avant Kerouac, avant Saul Bellow, mais même avant John Dos Passos !) avec des descriptions à n'en plus finir et un tempo de série télévisée où l'on tente de mettre en scène la vie familiale de monsieur et madame tout le monde d'aujourd'hui. On se noie littéralement dans des extrapolations psychologiques qui n'en finissent pas, tout cela parce qu'une certaine Margaret a finalement décidé d'épouser un certain John qu'elle savait déjà malade (il souffre, le malheureux, de dépressions de plus en plus aiguës). Ce dernier décline sans cesse et c'est son épouse qui tient la barque de la maisonnée où sont arrivés des enfants. L'aîné est lui aussi détraqué et son extrême sensibilité, son intelligence, ne lui permettent pas d'échapper au même mal qui a frappé son père. Tout y est lent, laborieux, ennuyeux à périr et franchement démodé. On ne croit d'ailleurs pas que tout commence au cours des années soixante : l'esprit n'y est pas. Mais Adam Haslett est un coureur de fond : il fait passer de page en page des histoires qui sont larmoyantes et pitoyables. Mais, heureusement, la rédemption vient par Mère Courage qui sauve tout ce petit monde du naufrage. Bien que je sois un lecteur compulsionnel, je ne suis pas arrivé jusqu'au bout. Il est certain en tout cas que cet écrivain va désormais donner une idée de la littérature romanesque made in USA parfaitement en phase avec la lame de fond réactionnaire qui submerge ce pays. C'est ennuyeux en diable et donne bien l'idée de la dégradation de l'art du roman. Mais comme disait Madame de Sévigné, cela passera, comme le café.

Une ombre au tableau, Dominique Gilbert, Les Editions du Littéraires, 192 p., 19,50 euro.
Personne n'oserait dire que ce n'est pas un ouvrage d'une singulière étrangeté. L'auteur commence d'ailleurs sa fiction comme un conte. Et l'on se trouve plongé dans un univers qui mêle différentes époques, de l'ère médiévale aux Cent Jours et à la Restauration, mais aussi aux années 1950, surtout avec des scènes du célèbre film d'Alfred Hitchcock, où se rencontrent Gary Grant et Eva Marie Saint. On y revoit la scène des enchères et celle de la fin, dans la magnifique maison construite sur la montagne. Mais ce sont surtout dans des châteaux où nous entraine l'auteur -, des châteaux avec des princesses et des chevaliers (un nombre vertigineux de chevaliers !) tout un univers onirique qui percute parfois la réalité. C'est comme un flux d'images baroques, entre la mièvrerie d'un film d'animation et la véritable beauté d'une époque qu'on imagine pleine de grandeur. Il y a toutes sortes de personnages qui passent et disparaissent et d'aucuns réapparaissent pour nous entraîner dans une autre sarabandes d'images et de récits sans suite. Je dois avouer qu'on s'amuse beaucoup à lire ces pages, qui ont une saveur à elles, où rien n'est vrai et où rien n'est faux. Au fond, on ignore l'intrigue, qui se résume peut-être à un mariage jusqu'à la naissance d'un enfant. Ce monde-là est-il celui de l'enfance, ou celui que les adultes ont conservé dans leur for intérieur mais tente de chasser à tout jamais comme étant caduc ? Au fond, peu importe. Seul compte l'imaginaire que l'écrivain a développé et auquel on s'agrippe volontiers car il est aussi beau qu'absurde et suranné. Dommage qu'on ne sache rien de Dominique Gilbert ! Bien sûr, un livre se dispense de la présence physique de l'écrivain, mais dans ce cas précis, la curiosité est de mise...
|
