
Alberto Giacometti, Yves Bonnefoy, Flammarion, 440 p., 30 euros
Si l'on va sans doute oublier la poésie d'Yves Bonnefoy (1923-2016), il y a de fortes chances qu'on conserve longtemps le souvenir de ce grand essai, qui lui a demandé dix ans de travail. C'est une somme qui jusqu'ici n'a pas été dépassée. Il y a dans ces pages beaucoup d'ambition et aussi beaucoup d'humilité. Il a cherché de reconstruire pas à pas un parcours mais aussi de pénétrer les intentions de cet artiste qui a suivi une logique complexe, qui peut parfois sembler labyrinthique, au moins jusqu'à l'après-guerre. Bonnefoy expose avec force détails ses jeunes années, car il est né dans une famille d'artistes. Son père Giovanni est peintre et un peintre de grand talent, dont le meilleur ami est Cuno Amiet, l'un des grands artistes suisses de la Belle Epoque. Il a donc grandi dans un cercle familial qui lui a permis de développer très jeune ses dons artistiques. Après avoir étudié aux Beaux-arts de Genève, il voyage en Italie (il visite en particulier Venise), et y fait des découvertes fondamentales. Ensuite, il se rend à Paris en 1922 et s'y installe. Il s'inscrit à l'Académie de la Grande Chaumière et entre dans l'atelier d'Antoine Bourdelle. S'il a manqué la période héroïque de l'art moderne, il est à son tour profondément influencé par l'art nègre et l'art égyptien. Mais il ne va pas suivre la trace des cubistes et de leurs épigones. Il s'intéresse aux métamorphoses possibles du visage humain. Cela lui permet de s'éloigner radicalement de tout ce qu'on a pu enseigner et même de la pratique de son père. Mais la question reste pour lui : être peintre ou sculpteur ? Il a été plus sculpteur, certes, mais il a aussi été un grand peintre. Sa rencontre avec les surréalistes à la fin des années vingt marque un tournant dans son histoire personnelle. Mais elle s'est traduite par des audaces qu'il n'aurait peut-être pas osé faire. Mais elle s'est conclue de façon désastreuse : son esprit d'indépendance ne pouvait pas s'accommoder des diktats d'André Breton. Le reste de son existence, qui s'est déroulée dans son austère atelier de la rue Hyppolyte-Maindron derrière la gare Montparnasse (où il a vécu en compagnie de son frère, Diego, grand créateur de mobilier) nous la connaissons mieux car elle marque la reconnaissance de l'originalité profonde de son oeuvre et lui vaut les éloges de Jean-Paul Sartre et d'autres écrivains notoires. Quoi qu'il en soit, on ne saurait se passer de ce volume pour découvrir et sa vie et le sens de l'oeuvre de Giacometti. Il est vraiment incontournable.

2O ans d'art en France, une histoire sinon rien, sous la direction de Michel Gauthier et Marjolaine Lévy, Flammarion, 296 p., 49 euros
La présentation de ce copieux volume peut être matière à réflexion : de petites reproductions avec de petits textes d'accompagnement. La mise en page est un peu ingrate et rappelle les catalogues annuels du Palais de Tokyo ! Comme l'un des auteurs est un conservateur, on ne trouve ici que des artistes achetés par les musées ou ayant reçu un des nombreux pris mis en place récemment pour l'art contemporain. Le fait que personne n'a pas plus d'importance qu'une autre est assez significative de la situation actuelle : faute de pouvoir véritablement identifier les nouveaux artistes ayant une place prédominante, on accumule les noms, pensant sans doute qu'on trouvera les bons dans ce vaste florilège ! Quoi qu'il en soit, l'ouvrage permet toutefois de se faire une certaine idée de la production artistique récente (en dehors du fait que des créateurs qui n'ont pas eu la chance de plaire aux conservateurs ou encore aux jurys sont complètement exclus de cette sélection. Et l'on sait qu'un bon nombre d'entre eux mériteraient de retenir l'attention ! Il faut donc prendre le livre comme une initiation ce qui est en faveur en ce moment et non à ce qui est destiné à s'inscrire assurément dans la durée. Fabrice Hyber, pourtant célèbre, à tort ou à raison (c'est une toute autres histoire) a une place équivalente à un artiste qui n'est apprécié que par un cercle restreint de fonctionnaires de nos musées. C'est d'ailleurs là un problème français qui remonte assez loin. Je ne donnerai qu'un seul exemple : les achats effectués par les FRAC ont été motivé, en général, par des critères de mode ou même de galerie ; quand on consulte le catalogue de ces années d'acquisition, on est effaré par leur médiocrité (il y a eu, heureusement, bien des exceptions). Conclusion : ce livre est très utile pour s'initier à ce qu'il serait possible de découvrir dans les lieux institutionnels et va nous permettre de savoir qui sont ces élus. Ce n'est déjà pas si mal ; car on se perd volontiers dans le labyrinthe de l'art contemporain. Un nouvel académisme est né : ces vingt années nous le dévoile et l'on en droit de s'interroger sur ce qui se passe dans la sphère artistique ! Le fait qu'il n'existe plus de hiérarchie dans ces pages démontre parfaitement qu'il n'existe plus d'artistes d'excellence et que la critique, ayant disparu, n'est plus en mesure de faire contrepoids à cette sélection très arbitraire. Faites-vous votre idée et aussi vos propres choix ; peut-être trouverez-vous votre bonheur.

Gustave Moreau, vers le songe et l'abstrait, musée Gustave Moreau / Somogy Editions d'Art, 192 p., 29 euros
Il y a déjà bien longtemps quel les Américains ont insisté sur la question de l'abstraction dans l'oeuvre de Gustave Moreau (1826-1898). Cette exposition au sein même de la maison que l'artiste a voulu léguer à la postérité et dont personne n'a voulu à l'époque, une belle exposition accompagné d'un catalogue d'un intérêt indéniable, met en avant cette dimension qui peut, à première vue, paraître bien étrange pour un artiste qui avait donné l'impression de mettre en avant la primauté du dessin. On peut se rendre compte dans ses études de couleurs, dans ses ébauches, mais aussi dans quelques uns de ses tableaux aboutis, comme Le Triomphe d'Alexandre le Grand, mais aussi dans plusieurs des es compositions (notez au passage que quand vous visitez le musée, avec les toiles qu'il avait choisies avec soin et mais refaites quand il les avaient vendues pour qu'elles soient présentes dans ce qu'il voulait faire valoir de sa recherche), qui semblent n'avoir pas été terminée, comme si ce non-finito avait été intentionnel. Et puis, il y a ces tableaux où le sujet, parfois complexe, est littéralement dessiné sur le fond coloré. Si l'on veut bien examiner avec soin ses travaux, force est constater qu'il a construit ses huiles de plusieurs manières différentes et parfois avec un fond coloré en complète contradiction avec ses figures, ses architectures et ses paysages. Si l'on s'arrête un moment devant sa Salomé dansante, exécutée entre 1874 et 1875, on voir que le corps nu de la jeune femme est recouverte de dessins qui forment comme un tatouage, mais qui sont ceux qui décorent son ultime voile devenu si transparent qu'il n'est plus discernable. Ce goût marqué du peintre pour ce système de superpositions graphiques se reproduit ailleurs. Plus on se familiarise avec son oeuvre, plus on doit admettre qu'il a chaque fois traité sa mythologie ou sa vision de l'histoire antique avec des procédés discordants, qui était à rebours de l'art académique de son temps et se révélait d'une curieuse modernité. Sans nul doute, il ne faut pas faire de Moreau un ancêtre de l'art abstrait, mais il avait de la peinture une conception qui se trouve en rupture avec ce qui était de règle alors sans pour autant se rapprocher des peintres les plus novateurs, avec lesquels il n'a aucune affinité (les rapprochements avec les techniques de certains d'entre eux me semble tout à fait hors de propos). En revanche, il est justifié de placer ces jeux chromatiques sans formes définies dans la perspective du rêve ; il n'a pas été un « peintre d'histoire «, comme l'on disait encore en ce siècle, mais un peintre onirique. Le rendu de ces sujets mythologiques ou bibliques le prouve amplement et ses écrits : dans le recueil de ses écrits, justement intitulé L'Assembleur de rêves (Fata Morgana), on se rend compte à quel point les rêves ont compté pour lui et ont envahi l'esprit de sa peinture (les surréalistes l'ont d'ailleurs redécouvert et admiré pour cette sensation de bris de rêve réélaborés). La haute mélancolie qui se dégage de ses créations ne fait que renforcer cette impression l'idée que ses tableaux ont été pensé comme autant de rêves, qui possède une puissance peu commune ; il faut visiter cette exposition et consulter ce catalogue qui sera pour beaucoup une véritable révélation.

Monochromes, Serge Charchoune, galerie Le Minotaure / galerie Alain Le Gaillard, 128 p.
Ces deux galeries de la Rive gauche de Paris s'associent souvent pour présenter des expositions de caractère historique de grande qualité. Cette fois, elles ont décidé de présenter un aspect de l'oeuvre de Serge Charchoune (1888-1975). Ce dernier est arrivé à Paris en 1912, n'ayant pu être reçu à l'Académie des Beaux-arts de Moscou et attiré comme beaucoup d'aspirants artistes par les sirènes de la capitale française. Il étudie dans l'atelier d'Henri Le Fauconnier ; en 1014, il s'installe à Barcelone et y fait la connaissance de Picabia, de Marie Laurencin, d'Albert Gleizes. Il expose ce qu'il appelle ses toiles cubistes ornementales en 1916 et en 1917 à la galerie Dalmau. Il fréquente le petit cercle dadaïste `à partir de 1920 et y joue une part assez active. Fasciné par la révolution d'Octobre, il tente de rentrer en Russie. Il se rend d'abord à Berlin et expose à la galerie Der Stürm. Mais il renonce à poursuivre son voyage et rentre à Paris. En 1926, il expose à la galerie Jeanne Bucher et, un an plus tard, à la galerie Aubier, avec une préface d'Ozenfant, puis à la galerie Percier en 1929 avec une préface d'André Salmon. Il s'oriente alors toujours plus vers l'abstraction. A la fin des années quarante, il se tourne vers la monochromie, ce qui est l'objet des deux expositions conjointes. On ne peut qu'être subjugué par ces belles compositions souvent très claires (et parfois blanches) où subsiste de temps à autre la forme d'un objet ou alors des traductions personnelles de constructions cubistes ; il ne s'inscrit pas dans l'esprit de l'abstraction de l'Ecole de Paris : son art conserve des liens, mais très diffus, avec le monde tangible -, ou pas, selon son caprice. Michel Seuphor écrit sur son compte en 1957 : il souligne le caractère déconcertant de sa démarche. S'il prétend imposer une grande cohérence plastique à ses compositions, il ne fait rien de manière systématique. C'est tout le paradoxe de sa peinture. Mais il est toujours parvenu à engendrer des espaces où ce radicalisme de la couleur souvent unique est contredit sotto voce par des jeux graphiques ou allusifs. Il est à noter que la musique tient une place de plus en plus grande dans son inspiration et les noms de Bach et de Beethoven apparaissent dans les titres de ses tableaux de la fin des années cinquante. Serge Charchoune n'est pas un maître oublié ou méprisé, mais peut-être pas encore tout à fait reconnu à sa juste valeur. Je conseille donc aux amateurs de voir ses tableaux ou sinon de consulter ce précieux catalogue.

Les Egyptiens et leurs mythes, Dimitri Meeks, Hazan / Louvre éditions, 272 p., 25 euros
Le titre ce cet ouvrage peut sembler paradoxal car l'auteur commence dans sa préface par dire que que les croyances des Egyptiens anciens n'avaient pas beaucoup à voir avec ce que nous appelons mythologie, surtout en songeant à la Grèce et à Rome. Il ajoute ensuite que le terme de « dieu » n'a pas non d'équivalent avec nos conceptions. Il souligne que ce statut peut être impermanent (il prend l'exemple d'Osiris). De plus, il n'y aurait pas de rupture entre le sacré et le profane. Son dessein est de nous expliquer ce qui fait la spécificité et - peut-être - l'unicité de la religion de cette civilisation. Ce qui le conduit à penser que tout reste encore à reconstituer en ce qui concernent l'histoire, les faits et les gestes, les pouvoirs des dieux, car il n'existe pas un récit complet, loin de là, mais plusieurs versions et beaucoup de digressions. Ce que la connaissance des textes sacrés qui nous sont parvenus peut nous suggérer reste encore sujet à caution, car il y a d'autres de lacunes. Le système théologique égyptien a évolué au fil de tous ces longs siècles et n'a cessé de se métamorphoser. Il y a eu de nombreux changements autant dans les rites que dans les conceptions du divin. De plus, les récits mythiques sont étroitement associés à la vie des êtres vivants et à la vie quotidienne. En somme, cette étude est une invitation pressante à revisiter de fond en comble de quelle manière les divinités égyptiennes ont pu changer de valeur plus que de forme. La tradition a véhiculé des représentations qui sont demeurées à peu près identiques et c'est d'ailleurs ce qui peut confondre le chercheur, car chacune d'entre elles, selon les époques, a pu changer profondément d'essence. Les mythes égyptiens ont une histoire qui n'est pas du tout linéaire et qui n'a pas converger à une histoire unique (mais j'objecterai ici qu'il en est de même des mythes gréco-latins, qui sont en réalité constitués d'une multitude d'histoires, souvent disloquées, qui ne sont pas forcément le complément des précédents, mais plutôt des prolongements, avec de nombreuses différences, de temps à autres contradictoires). Quoi qu'il en soi, l'essai de Dimitri Meeks est un instrument utile pour tenter de comprendre sous un éclairage nouveau cet univers de l'Egypte ancienne, qui est moins statique qu'il ne le semble.
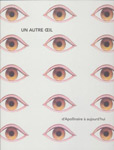
Un autre oeil, d'Apollinaire à aujourd'hui, sous la direction de Daniel abadie, Somogy Editions d'Art / LAAC, Dunkerque / musée de l'Hospice Saint-Roch, Issoudun / musée de l'Abbaye Sainte-Croix, Les Sables d'Ollonne, 158 p., 25 euros
Le sous-titre peut prêter à sourire, car il ne qualifie en aucun cas ce livre qui, pour l'essentiel est une exposition accompagnée des textes que Daniel Abadie a pu écrire au cours de sa longue carrière. Il a divisé l'ouvrage en plusieurs parties. La première concerne l'abstraction. On peut y trouver ses artistes de prédilection, comme Hans Hartung, Marcelle Cahn, Sophie Tauber-Arp, Jean Fautrier, Camille Bryen, entre autres. La seconde partie est réservée au réalisme dans ses manifestations les plus diverses (il faudrait d'ailleurs plutôt parler de figurations) avec Gaston Chaissac, Errò, Asger Jorn, Antonio Segui, Jean Dubuffet, etc. Il y a une autre section qui s'intitule « Le poids du monde », et qui rassemble des artistes ayant eu recours des méthodes de travail incongrues, comme les artistes du Nouveau Réalisme (Raymond Hains, Arman, Villeglé, Daniel Spoerri, César), des membres de l'éphémère groupe Supports/Surfaces, comme Louis Cane, Claude Viallat, Daniel Dezeuze, et d'autres artistes qui sont proches de cette conception esthétique peu académique comme Jean-Pierre Péricaud, Jean-Paul Meurice ou, dans son isolement altier, Pierrette Bloch. Enfin et d'autres peu classables comme François Rouan figurent une dernière partie dite « Minuscule/Majuscule », avec ou Philippe Favier ou Bernard Moninot. Je dois dire que, dans l'ensemble, le choix d'Abadie est intéressant et échappe aux modes et aux poncifs, ce qui est déjà beaucoup ; il nous offre sa vision de l'art, qui est plutôt honorable et nous nous fait la démonstration de la critique « vieux jeux -, et je le dis sans méchanceté, au contraire, plutôt avec une sorte d'éloge. Daniel Abadie appartient à un monde qui disparaît, avec des personnalités qui avaient vraiment un oeil, une indépendance d'esprit, une forme d'écriture pour parler des hommes, des femmes et de leurs oeuvres. Ce catalogue est intéressant pour ce qu'il présente, mais aussi pour cette vaste anthologie critique.

Pascal Quignard, ou les Leçons de ténèbres de la littérature, Mireille Calle-Gruber, Galilée, 218 p., 20 euros
Cela est l'évidence même Pascal Quignard est l'un des grands écrivains français vivants. Et il ne nous en reste plus beaucoup ! L'étude que lui consacre Mireille Calle-Gruber est remarquable. Tout d'abord, elle n'est pas écrite de manière conventionnelle (et souvent rébarbative), mais essaye de placer le projet littéraire de cet écrivain dans certaines perspectives majeures ; la première est sans aucun doute celle des Leçons de ténèbres : mais là, il ne s'agit pas de la Semaine Sainte, mais plutôt d'une littérature qui se révèle paradoxalement dans l'obscurité. En sorte que sa démarche va à l'encontre de celle des philosophes qui veulent mettre en lumière tous les aspects du monde. Il propose donc d'écrire « à la manière noire », et alors le rêve tient alors une place de premier plan. C'est là d'ailleurs une constante de sa pensée de la littérature, car dès qu'il se met en tête de produire un roman, il ne donne que le moins bon de lui même. Il n'est pas fait pour une architecture lumineuse, mais pour des traces éparses, « sidérantes » de cet univers obscur qui est enfouis dans son for intérieur. Il défie les interdits, efface les frontières. Au fil des pages, Mireille Calle-Gruber nous fait toucher du doigt la réalité de ce monde secret et merveilleux, mais aussi vertigineux où il va puiser les trésors et les merveilles dont il va ensuite se servir pour composer ses ouvrage ; son analyse est d'une très grande finesse, et évite le travers de tout vouloir expliquer et de mettre à jour un système car il n'y pas de système, non, mais des intuitions, des errements provoqués, des traductions des plus fantasques, des échos soudains, des éblouissements, des rencontres incongrues. Et les Leçons qu'il a imaginées, pensées et puis couchées sur le papier ont un double sens : ce sont aussi celles qu'il a suivies par ses lectures. Paul Celan est l'un de ses maîtres, mais pas dans le sens classique : il lui a appris quelque chose dont il a su pu faire bon usage par le suite. Et notre auteur nous invite aussi à mieux saisir sa relation à la musique (essentielle) et aussi à la danse et au spectacle en général. Pour ceux qui l'apprécient et le juge comme un auteur de grande valeur comme pour ceux qui éprouvent des difficultés à le suivre en tous lieux, cet essai est un excellent guide : personne ne pourra plus se perdre dans cet étrange labyrinthe, mais ce qui fait son mystère et sa particularité n'est pas défiguré ou encore trahi par un abus de rationalité. C'est une exploration remarquable à tous points de vue.

Les Beaux mariages, Edith Wharton, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Suzanne Mayeux, « Domaine étranger », Les Belles Lettres, 576 p., 15 euros
Edith Wharton (1862-1937) est une riche Newyorkaise qui a eu une seule grande admiration parmi ses aînés : celle d'Henry James. Son oeuvre (romans, nouvelles, essais, voyages) etc.) est vraiment pléthorique, presque autant que celle de son mentor vénéré, mais elle est loin de l'égaler. Cela ne signifie pas pour autant que ses écrits soient médiocres et dépourvus d'intérêt. Au contraire. Ce roman publié en 1913 sous le titre de The Custom of the Country, en est la démonstration. Il s'agit de l'histoire d'une jeune femme, Undine Spragg, qui est issue d'une famille aisée d'Apex (une ville imaginaire du Middle-West), qui a été favorisée par les fées à sa naissance, car elle est belle et vive. Et nantie de surcroît. A New York, elle épouse Ralph Marvell, qui appartient à une bonne famille de la ville. Toutefois, il est moins riche qu'on aurait pu le croire, et la dote qu'il a reçue ne suffit pas à Udine de mener le train de vie que son épouse aurait pu souhaiter. Elle tombe enceinte et rejette le fils qu'elle met au monde, Paul. Son mariage la déçoit. En voyage en Europe, elle rencontre le banquier Peter Van Degen, qui est déjà marié. Elle s'empresse de divorcer de Ralph, mais son amant ne compte pas se séparer de son épouse Clare. Cette situation la place dans une posture délicate, car elle a perdu son précieux statut social. Elle décide d'accomplir alors plusieurs voyages de part et d'autre de l'Atlantique et revient à Paris et entend bien retrouver une place de choix dans le beau monde. Et la chance lui sourit quand elle rencontre le comte Robert de Chelles qui tombe amoureux d'elle et veut l'épouser. Mais cet aristocrate est catholique et ne peut se marier avec une femme divorcée. Undine fait un véritable chantage auprès de son ancien mari à propos de leur fils et aussi en lui demandant une forte somme d'argent pour que son divorce n'apparaisse pas (elle pense corrompre les autorités pontificales !). Ralph n'arrive à trouver la somme voulue dans les temps et en même emprunte beaucoup à Elmer Moffat. Celui-ci fait chanter Ralph, qui finit par se suicider. Malgré tous ces stratagèmes éhontés et qu'elle soit finalement parvenue à ses fins, elle se lasse de Raymond et surtout de sa famille, qui n'est riche que de terrains et d'antiquités. Elle décide de divorcer et de se remarier avec Elmer Moffat. Mais, à la fin, elle rêve d'épouser un diplomate ! Malgré la fin de l'ouvrage que se change en roman feuilleton un peu tiré par les cheveux, Edith Wharton se révèle une brillante femme de lettres. Elle met aussi très bien en relief toute la différence entre l'Ancien et le Nouveau Monde en matière de justes noces, elle ne dépeint pas seulement une jeune femme d'une ambition démesurée, mais l'état d'esprit qui s'impose désormais dans cette jeune Nation. Elle se révèle d'une grande modernité par rapport à James. Mais elle appartenait à une autre génération.

La Perfection de la technique, Friedrich Georg Jünger, traduit de l'allemand et préfacé par Nicolas Briand, Allia, 4oo p., 22 euros
Friedrich Georg Jünger (1898-1977) est le frère cadet d'Ernst Jünger, l'auteur des Falaises de marbre et d'Orages d'acier. Sans doute son oeuvre a-t-elle souffert de cette parenté écrasante, car son aîné a connu la gloire et ses innombrables livres ont retenu l'attention du public en Allemagne et dans le monde alors que les siens, avec ses recueils de poésie, des essais, des fictions, sont passées quasiment inaperçus. Les éditions Allia ont eu l'excellente idée de faire connaître au public français l'un de ses ouvrages majeurs, Perfektion der Technich, qui a connu un sort presque aussi malheureux que le sien (voulant s'engager volontaire pour suivre l'exemple de son frère, étant trop jeune, il n'a pu être incorporé qu'en 1916 ; il est gravement blessé lors de la bataille de Langemark et c'est son frère, qui a été averti de la situation qui lui sauve la vie) : ce livre devait paraître en 194o, mais il a du le remanier pour ne pas être censuré et il ne sortit de presse qu'en 1942, mais le stock a été détruit par un bombardement anglais ; un autre éditeur décide de l'éditer en 1943, mais un autre bombardement détruit presque tous les exemplaires stocké un an plus tard. Ce n'est donc qu'en 1946 qu'il a pu enfin voir le jour et circuler. Il a été profondément remanié et augmenté à la faveur des rééditions suivantes. L'auteur français a décidé de traduire la version ultime. Pour l'essentiel, ce grand essai est une réponse au livre de son frère, Le Travailleur, publié en 1932. Ce dernier y préconisait la fusion de l'organique et du mécanique. C'est aussi une réplique aux thèses de Karl Marx et leur réfutation, sans pour autant prendre fait et cause pour le capitalisme tel qu'on le connaissait alors. S'il préconise une nouvelle relation entre l'homme et la machine, pour parler en termes simples, il marque là une différence majeure : il déplace la problématique et propose une perspective d'une autre portée : la relation que l'homme et ses techniques avec le monde naturel. Ce nationaliste extrémiste, qui avait suivi son frère dans ses aventures politiques, préconisant l'abolition du gouvernement de Weimar par un coup d'Etat, a évolué en comprenant que les nouvelles techniques, de plus en pus puissantes, représentaient un risque sérieux pour les richesses minérales, végétales et animales du globe qui n'étaient pas inépuisables. Il parle de « régression élémentaires ». Bien sûr, il développe ses vues sur la propriété foncière ou industrielle, sur l'assujettissement de l'homme, sur les conséquences de cette quête de la richesse et du bien-être que le recours à la technique, perpétuellement renouvelée et améliorée, a ses limites et ses conséquences néfastes. Je ne saurai résumer ici les considérations très détaillées et très éclairantes qu'il a couchées par écrit pour exposer ses convictions. Mais je tiens à souligner la grande importance de ce livre qui est sans doute le premier à échapper à cette tension philosophique entre deux représentations du monde absolument opposées et pourtant ayant des points communs sur des points fondamentaux. C'est une oeuvre visionnaire, qui a le mérite de regarder la modernité et les effets des progrès techniques toujours croissants sous un éclairage nouveau et qui sont bien plus proches de nous bien qu'elles aient été pensées et articulées sous le régime nazi. Il convient donc de prendre son courage à deux mains et à en suivre le cheminement théorique.

Les Parapluies d'Erik Satie, Stéphanie Kalfon, Folio, 192 p., 6,60 euros
Je dois dire que ne suis guère amateur de biographies romancées. Mais celle que Stéphanie Kalfon a consacrée à Erik Satie sort véritablement du lot ; elle est d'abor une oeuvre littéraire originale, tonique, pleine d'invention et d'humour, tout en préservant l'intégrité de son modèle. D'une certaine façon, elle a conçu sa biographie avec l'esprit de son modèle, qui a été tout à la fois un immense musicien, mais aussi un personnage des plus extravagants. Il était l'exact opposé de son grand ami Claude Debussy (qu'il rencontrait à la Taverne du Bagne), qui a été lui aussi un novateur, mais en faisant une carrière beaucoup plus classique. L'auteur nous restitue les faits et geste de ce curieux bonhomme, qui a tenu le piano au Chat Noir de Rodolphe Salis ! Et elle l'a fait avec une fantaisie débridée, mais en même temps un sérieux impeccable, car elle ne fait pas un portrait forcé de ce créateur merveilleux, qui a eu une vie assez misérable. Si son écriture est libre, parfois même ébouriffée, toujours drôle et toujours juste, elle est aussi bien mesurée et toujours respectueuse, même si le sujet Satie a pu laisser prise à bon nombre d'histoires loufoques et de légendes tenaces. Elle parvient cet exploit si rare : entrer dans la peau du personnage et nous le restituer tout en composant une oeuvre qui put et doit être lue comme un roman. Ce jeune auteur a vraiment du talent, un talent qu'il faut encourager et applaudir ce qui est très réconfortant dans cette période de vaches très maigres dans le domaine romanesque.

Remèdes à la mélancolie, la consolation par les arts, Eva Bester, Autrement, 304 p., 18 euros
Le projet est plaisant et construit de manière très singulière et intéressante. A partir d'entretiens réalisés avec des personnalités de tous genres, de Gérard Garouste à Geneviève Brissac, en passant par Philippe Stark, Bernard Blier, Eric Naulleau, et pas mal de figures à la mode à Paris, l'auteur a choisi de nous parler de la mélancolie ; et elle le fait avec intelligence. Rn effet, elle a divisé son ouvrage en différentes parties, la première étant un diagnostic pluriel de ce mal qui a frappé beaucoup d'écrivains, de peintres et de musiciens, sans parler de tous ceux qui en ont souffert et qui sont restés anonyme. L'énorme, la pléthorique et très passionnante étude de Robert Burton au XVIIe siècle a donné toute la mesure de l'intérêt qu'on a porté depuis longtemps à cette affection de l'âme. Démocrite déjà l'avait étudiée pour en trouver les remèdes, et Burton était d'abord un médecin. Ici, l'auteur n'a aucune prétention à en fournir une définition précise et définitive, mais tente de comprendre comment les personnes entretiennent ou non une relation avec la mélancolie ; ensuite, elle va rechercher quelles sont les solutions qu'on pourrait y apporter. Et elle le fait non seulement en posant la question à ses interlocuteurs, mais aussi en apportant des documents, surtout des citations de grands auteurs. Ces textes sont choisi la plupart du temps par des auteurs anciens ou modernes. C'est ce qui fait la richesse de son ouvrage, qui ouvre toutes sortes de champs pour l'esprit afin de comprendre ce qu'elle la mélancolie et comment on pourrait en guérir. A la fin de ce tour d'horizon, Eva Bester a choisi de faire reproduire plusieurs tableaux de l'admirable Léon Spillaert, qui a été l'un des grands peintres symbolistes belges qui ont le mieux représenté l'état mélancolique. Même si tous les protagonistes présents ne nous fascinent pas vraiment, elle a néanmoins su tirer parti avec intelligence de tous ces échanges.
|
