
Jacques-Emile Blanche, Editrice Silvana / Palais Lumière ville d'Evian.
Jacques-Emile Blanche (1861-1942) n'a pas été très bien traité par la postérité. Bien sûr, on le voit dans quelques musées, il figure dans des expositions collectives, surtout pour ses portraits de contemporains célèbres, mais, au fond, jamais on ne lui avait rendu un grand hommage posthume. Le Palais Lumière d'Evian vient de la faire et c'est assez impressionnant. Le catalogue est un peu décevant du point de vue des essais, car ne concernent que certains aspects de son oeuvre, de sa vie et de sa pensée. Par exemple, l'un parle de ses rapports avec l'Angleterre (qui sont importants), l'autre de la sculpture (ce qui est un sujet mineur) et un autre encore, de ses conceptions politiques, où l'on découvre, hélas, qu'il avait été antidreyfusard. Mais rien sur l'écrivain, sur le critique d'art ! Il a pourtant écrit une histoire de la peinture française et un grand nombre d'ouvrages où il a réunis ses articles sur l'art (Cahiers de peintre, puis Propos de peintre), un parcours allant d'Edouard Manet au surréalisme en passant par l'impressionnisme et ses conséquences. Sans doute peut-on, rétrospectivement, lui reprocher beaucoup de choses et un certain conformisme qui s'est traduit par une complaisance pour les artistes académiques. C'est vrai. Mais tout de même, il a su observer avec curiosité et intérêt ce que les peintres et les sculpteurs qui l'ont accompagné pendant sa longue vie à cheval sur deux siècles, sans compter des monographies, sur William Sickert, par exemple. Et puis il a écrit des livres de souvenirs, un ouvrage sur Passy ou sur Dieppe, des oeuvres de fiction également. Sa bibliographie est pondéreuse. Ces portraits constituent une véritable histoire de la littérature et des arts en France (Proust, Barrès, Mary Cassatt, Gide, Cocteau, Radiguet, pour se limiter à ces noms). De plus, cette exposition étonnante, très bien agencée, montre qu'il n'est pas uniquement un peintre mondain très apprécié. Il a accepté l'influence de l'impressionnisme et est même allé un peu plus loin. Sans doute n'a-t-il jamais franchi le saut décisif qui en aurait fait un artiste d'avant-garde, mais il n'appartient pas non plus à l'arrière-garde. Ses tableaux méritent la réhabilitation à condition de leur donner leur juste dimension.

Les Arts de l'Afrique, Carl Einstein, présenté et traduit de l'allemand par Liliane Mettre, Editions Jacqueline Chambon, 336 p., 24 euro.
Carl Einstein (1885-1940), comme Walter Benjamin, s'est suicidé devant la frontière espagnole, se jetant dans le gave d'Oloron. Il est vrai que sa situation, en tant qu'Allemand et que Juif, en tant que communiste et combattant en Espagne dans les rangs de la CNT (il fait partie de la colonne Duruti pendant la guerre civile) était plutôt dangereuse s'il restait en France. Mais il s'était fait connaître surtout comme critique d'art et auteur dramatique. Les Editions Jacqueline Chambon ont eu l'excellente idée de faire découvrir ses remarquables écrit sur l'art en 2011 (L'Art du nobr>XXe siècle). Grâce à cette même maison, on a pu récemment découvrir la valeur de ce qu'il a pu écrire sur les artistes de son temps et l'incroyable lucidité de son jugement qui en fait certainement le meilleur observateur de l'art du début du siècle précédent. Ce livre, qui n'est pas resté sans échos, paru en 1915 et ensuite complété au fil des rééditions est sans aucun doute le meilleur sur la question de « l'Art nègre » (ce terme n'adopte aucune connotation raciste ou péjorative dans sa bouche). D.-H. Kahnweiler ne s'y est pas trompé, pas plus que Michel Leiris qui a fait paraître ses arts sur l'art africain dans la revue Documents. Mais il a fallu attendre les années 70 pour que Jean Laude parvienne à convaincre de la nécessité de faire paraître ces textes. Cette fois, c'est l'intégralité de ce qu'il a pu écrire sur ce sujet qui se retrouve dans ce livre Et quel bonheur ! Ce n'est pas seulement le premier essai qui a paru en 1915, sans doute aussi le plus pertinent, mais l'ensemble de ses considérations de ce sujet qui sont réunis dans ce volume ! En termes clairs, concis, efficaces, il expose ce qu'est cet art, d'un point de vue formel et élaboré dans une optique très éloignée de la nôtre, mais aussi d'un point de vue religieux, culturel et plus globalement culturel. En fait, ces deux manières d'envisager les choses s'emboîtent l'un dans l'autre. Même si ces arts sont le plus souvent liés à des rites précis ou à des cérémonies, donc à un usage éphémère, ils n'en représentent pas moins une tentative très sophistiquée de projeter le monde et les êtres dans un espace. L'oeuvre, explique Einstein, « ne signifie rien, elle n'est pas symbole ; elle est le dieu qui conserve sa réalité mythique close dans laquelle il inclut l'adorateur... » En somme c'est un simulacre pour restituer le monde sacré. L'importante iconographie et les explications nourries qui les accompagne permettent de mieux s'entendre dans la variété extrême des formes et des ethnies. Tous ses articles sont aussi présents ici. En somme, cet ouvrage devrait être le viatique de tous ceux qui veulent découvre les civilisations africains ou qui veulent comprendre pourquoi il y a eu cette vogue de l'art nègre dans le premier tiers du XXe siècle.

La Civilisation du spectacle, Mario Vargas Llosa, Gallimard, 238 p., 20 euro.
Le grand écrivain péruvien, comme beaucoup d'auteurs de romans actuels, n'a pas de grandes connaissances en art moderne. Il ne le prétend pas non plus. Mais cela s'avère gênant quand il fait allusion à Marcel Duchamp ou parle du portrait de Staline par Picasso, ne connaissant rien de l'affaire des Lettres françaises. L'artiste n'a jamais adhéré au réalisme socialiste et a été au centre de la polémique qui a fait rage et qui a culminé avec la parution de ce dessin en 1953. Il n'en reste pas moins que la plupart des essais, conférences, articles réunis dans cet ouvrage font de lui un penseur de la culture, qui a ses limites, c'est vrai, mais qui n'en reste pas moins une voix qui compte. Malgré des imperfections sur des oeuvres et idées nouvelles (je ne dis pas : novatrices), Llosa s'appuie dans ses pages inaugurales sur T. S. Eliot, le poète d'avant-garde qui a par la suite a changé d'orientation en se convertissant au catholicisme et en adoptant une attitude conservatrice, et sur les livres érudits de George Steiner, un homme d'une culture remarquable insondable, et aussi un vrai penseur, mais pas très intéressé par la littérature et les arts les plus radicaux. On peut sans doute s'interroger sur ces fondements, qui ne sont pas dépourvus d'intérêt, mais qui sont loin d'être en accord avec ce qui a été accompli depuis la dernière guerre. Cela n'empêche pas l'auteur d'aller chercher ailleurs son modus operandi, en particulier dans la sociologie, mais aussi chez Baudrillard, Virilio et d'autres grands acteurs de la recherche des nouveaux principes esthétiques. Il a compris que la culture est désormais une culture où l'image est plus importante que l'écrit et que le bon vieil humanisme, dont nous avons été pétri n'est plus qu'un rêve qui s'estompe lentement, mais inéluctablement. Et il a raison : tout ce qu'on appelle « sous-culture » (je ne crois pas que l'expression soit bien adaptée, même si elle a envahi tout le domaine des arts et des lettres, du théâtre et du cinéma) passe désormais pour pétré de l'art. Il s'appuie sur la notion d'élite avancée par Eliot : seule une minorité argentée, qui serait donc une élite sociale, serait en mesure d'être le patron de tout ce qui concerne l'épanouissement de la culture. Mais voilà, la prétendue élite a bien en main aujourd'hui la maitrise de la création artistique, mais pour des raisons spéculatives et non plus en liaison avec une haute idée de la culture. Je relève aussi des essais amusant sur l'érotisme, l'un consacré à Freud, l'autre à Catherine Millet dont il a compris la spécificité. Ce livre est d'une lecture urgente et impérative : il nous donne à méditer sur ce qui est en train de se passer et qui est une mise à sac de notre mémoire - et par conséquent de notre présent.
Ce roman récent de Vargas Llosa, Un héros discret, touche à une question sérieuse et parfois dramatique de la vie des Péruviens modernes (mais cette situation, hélas, se retrouve un peu partout dans le monde, avec une plus ou moins grande intensité). Il nous parle d'abord du chantage exercé sur de petites entreprises à travers l'histoire du directeur d'une société de transport (Narihualà) dans la ville de Piura, la première cité coloniale fondée par les Espagnols. Felìcito Yanahaqué refuse de céder au chantage, malgré le danger qu'il court. Il écrit dans le quotidien El Tiempo pour rendre publiques des menaces qu'il reçoit. Le maître chanteur fait brûler ses locaux, enlève sa femme, puis la relâche, ne cesse de lui envoyer des lettres menaçantes. Et notre héros ne cède toujours pas. Sa lutte courageuse finit par donner ses fruits. A Lima, il s'agit de bien autre chose : un homme nommé Ismael Carrea est aux prises avec ses deux fils, qui font tout ce qui est possible pour s'emparer de ses biens. Il parvient à déjouer leurs manigances. Pendant une bonne partie du livre, les deux histoires sont parallèles. Elles finissent par se rencontrer à la fin, quand la veuve de Carrera se réfugie à Piura. Elle fait la connaissance de Yanahaqué et de sa famille. Elle leur relate ses mésaventures avec les fils et prémédite une vengeance avec leur aide. A son habitude, l'écrivain rend ses récits très mouvementés, avec une foule de personnages et non sans un humour mordant, même si le sujet demeure grave. Ce n'est pas à la hauteur de son chef-d'oeuvre, Conversation à La Catedral. Toutefois, il a un grand talent et sait manipuler ses marionnettes au fil de sa narration avec un art qui ne se dément jamais.
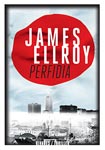
Perfidia, James Ellroy, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean-Paul Gratias, « Thriller », Rivages, 848 p., 24 euro.
La réputation de James Ellroy n'est plus à faire ! C'est l'un des principaux représentants de la littérature noire actuellement. Ne l'ayant jamais lu, j'en ignorais la raison ; je découvre, avec cette énorme saga, la mesure de son talent. Il bâtit une trame principale où le policier William Parker est la figure principale avec Kay Lake, qu'il charge d'une mission d'infiltration dans les milieux extrémistes de gauche. Le prétexte du nouveau volet de cette gigantesque histoire qui va de l'avant-guerre à l'après-guerre aux Etats-Unis (l'action se déroule pour l'essentiel à Los Angeles), dont une partie non indifférente a déjà été publiée, est l'assassinat de quatre citoyens d'origine japonaise. L'action début le 6 décembre 1941, la veille de l'attaque surprise de la part de l'empire nippon sur la base de Pearl Harbour. Bien sûr, le destin de ce grand pays pacifiste bascule à ce moment-là et tout change brusquement. Dans ce livre fleuve, ce n'est pas seulement une toile de fond historique. C'est l'élément majeur de l'intrigue centrale. Mais plusieurs autres trames narratives se proposent et se développent, s'enchevêtrent même, parmi les représentants de l'ordre et les malfrats, les personnes simples et les individus célèbres, certaines ayant vraiment existé, la plupart étant sortis de l'imagination de l'auteur. Cela donne une fiction touffue, qui ne cesse de croître dans un rythme effréné, plusieurs de ces récits s'entrecroisant. C'est écrit d'une façon galvanisante, fébrile et l'auteur sait parfaitement nous faire partager cette fébrilité surprenante. Ainsi sommes-nous entrainés dans ces aventures picaresques, mais élaborées dans une perspective ultramoderne, et une affaire apparemment subalterne prend soudain autant de relief que les affaires considérées comme majeures. C'est trépidant et d'une grande richesse : le moindre figurant a ici sa place assignée, mais aussi sa personnalité et ses propres problèmes. D'ailleurs, certains existaient déjà dans ses précédents romans, comme je l'ai déjà précisé au début, le lecteur étant supposé les connaître. La grande Histoire et les petites, les soldats, les mafieux, les ressortissants d'origine japonaise, les hommes politiques, les syndicalistes (et j'en passe) agissent dans cet enchevêtrement de trames touffues. Jusqu'au 28 décembre de cette année fatidique, nous sommes haletants pour suivre les faits et gestes de Parker et de tous les autres, plongé dans un univers foisonnant et en pleine ébullition. Sans doute Ellroy a-t-il pris quelques libertés avec les événements et surtout dans la façon dont ses créatures en prennent conscience, il a tendance à anticiper sur l'avenir proche de son pays. Mais peu importe : ce qui compte dans ce roman, c'est sa faculté incroyable de créer un monde si complexe, angoissé, mû par des idées reçues ou des préjugés, et si fascinant.

A l'agité du bocal, Louis-Ferdinand Céline, « Carnets », L'Herne, 94 p., 9,50 euro.
Plusieurs textes (dont certains inédits) sont recueillis dans ce petit livre. On y trouve ses carnets de guerre (fort succincts, mais qui éclaire cette partie décisive de sa vie), qui sont bien intéressants, un bel essai sur l'argot, comme langage de la haine (voilà une manière originale de voir le langage) et qu'il tient à décliner de Villon plus que les bas-fonds de Pierre Mac Orlan. Il y aussi un bon entretien qui le dévoilent pas mal : il dit des choses sans doute sincères, mais oubli une partie du reste, surtout quand il parle de sa famille - où est-on, dans sa famille ou dans celle du passage Choiseul dans Mort à crédit ? En tout cas il parle de ses premiers pas dans la vie, et ce ne sont pas ceux d'un fils de famille que se prépare à entrer dans le monde des lettres ! On lira la préface de Semmelweis, qui était sa thèse à la faculté de médecine, qui traitait des problèmes de prophylaxie, qui sera la plus grande partie de sa carrière modeste de médecin, car il fait plus de conférences pour la Société des Nations que d'années dans un cabinet, comme celui de Bezons pendant l'Occupation. Enfin on découvre un texte inattendu de 1930 sur les décorations d'un hôtel très particulier créé par H. Mahé. Enfin, il faut rire de cette merveilleuse préface sur un livre consacré à Bezons où Céline a exercé pendant l'Occupation. Bref, de petites choses, mais passionnâtes pour qui se passionne pour ce gigantesque écrivain et ce tout petit homme.

Saphira, sa fille et l'esclave, Willa Cather, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marc Chenetier, Rivages, 272 p., 21 euro.
Willa Cather est un écrivain américain qui a disparu en 1947. Mal connue en France, sinon inconnue de son temps, elle a été remise à l'honneur par les éditions Rivages. Ce roman paru en 1940, qui traite de la question de l'esclavage dans les Etats du Sud des Etats-Unis au milieu du XIXe siècle, juste avant la guerre de Sécession, a sans nul doute largement inspiré Toni Morrison. Son réalisme n'est pas celui de Steinbeck et se rapproche plus de la littérature anglaise de la période concernée par l'histoire qu'elle a voulu nous raconter. Elle nous présente une famille dont le père est meunier et dont l'épouse est issue d'une famille d'un plus haut rang. Chez les Colbert, qui vivent en Virginie, la mère adhère sans problème à l'esclavagisme (pour elle, cela est quasiment naturel et sans discussion), alors que son mari a des opinions plus ouvertes. Leur fille, Rachel, ne voit pas les choses de la même façon. Elle est émue par le sort des Noirs qui sont soumis à un traitement qu'elle juge indigne. Elle s'attache à une jeune fille, Nancy, et s'efforce de la sauver. Mais sa démarche n'est pas appréciée par sa mère et par le voisinage. Elle revient vingt-cinq ans plus tard, donc après la défaites des Confédérés, et elle peut constater que presque rien n'a changé. Si la thèse défendue par l'auteur est bien définie et sans surprise pour qui s'est un peu penché sur la question, le milieu des Blancs de cette époque est dépeint avec beaucoup de nuances et de finesse et le sort des esclaves est aussi décrit sans emphase, mais avec un réalisme qui touche le lecteur. Il faut aussi ne pas oublier que les années où elle écrit ce dernier roman, la situation de la minorité noire est encore déterminée par la ségrégation raciale. Il s'agit d'un livre courageux et sincère, qui n'est pas manichéen, mais qui néanmoins revendique l'égalité de tous, ce que la longue et terrible guerre civile était parvenue à acquérir en théorie. C'est émouvant mais sans le moindre pathos.

Redrum, A la lettre contre le fascisme, sous la direction d'Alain Jugnon, Les impressions nouvelles, « Traverses », 288 p., 20 euro.
L'idée d'Alain Jugnon pose un vrai problème à mes yeux : la notion de « fascisme » est trop liée à l'histoire. Elle ne me semble plus tout à fait adéquate pour définir ce qui se passe aujourd'hui. Même les partis d'extraction explicitement fasciste ont tenu à couper les ponts avec ce passé mortifère (l'exclusion de Jean-Marie Le Pen de son propre parti en est la démonstration - fasciste peut-être, mais avec classe !). Je crois que l'idée aurait du être de méditer sur la façon dont le fascisme s'est transformé à notre époque. L'islamisme radical est-il fasciste ? Les ultra-orthodoxes juifs sont-ils fascistes ? Les intégristes chrétiens le sont-ils aussi ? Il est certain qu'on peut faire des analogies. Mais c'est autre chose et c'est cet « autre chose » qui nous pose un vrai problème. En politique, le fascisme a conservé quelques lignes forces, mais s'est métamorphosé. De plus, les auteurs les plus connus qui ont participé à cette aventure collective, ne sont guère convaincants : Jean-Luc Nancy glose sur le principe de « communauté » avancé par Maurice Blanchot (ce principe n'est guère convainquant car quelle substance donnée à cette « communauté » ? Celle de Rousseau ? Celle Platon dans la République ? Celle des utopistes ? Christian Prigent, lui glose et pontifie sur la poésie -, grand bien lui fasse ! Alain Jouffroy fait référence au Grand Jeu. Rien là dedans n'est très probant. Chacun défend sa petite boutique en bon artisan du savoir et du savoir-faire. C'est presque indécent. Les autres textes, sous forme de récits, de poèmes ou d'essais sont encore moins percutants. Un livre pour rien ? Peut-être pas. Il souligne le décalage entre l'intelligentsia et la réalité politique de ce début de XXIe siècle. Il nous met dans l'obligation de nous pencher sur la question et de l'affronter dans des termes neufs et plus en phase avec ce transformisme idéologique, qui est d'une gravité indiscutable.
|
