
Kuniyoshi, sous la direction de Rossella Menegazzo, Museo della Permanente, Milan / Skira, 216 p., 35 euro.
A la fin du XIXe siècle, Edmond de Goncourt a consacré une monographie à Hokusai et une autre à Utamaro. Comme les plus cultivés de leurs contemporains, avait commencé à faire entrer dans leur collections des xylographies des plus grands artistes de l'ère d'Edo, qui ont magistralement inventé l'ukyio-é, ces « images du monde flottant ». Ce terme était apparu pour la première fois dans les Contes du monde flottant d'Asai Ryôi aux alentours de 1665. Aujourd'hui, les femmes au corps sinueux d'Harunobu, les masques d'acteurs de théâtre de Toshusai Sharaku, ou les scènes de théâtre kabuki de Kioyonobu, les compositions vernaculaires de Monorobu, les planches à treize couleurs de Masanobu, pour ne citer qu'eux, font partie d'un grand patrimoine qui est partagé en Occident. Les scènes érotiques et les paysages, les promenades bucoliques et les voyages à pied ou en bateau, les scènes de la rue et les spectacles populaires, les portraits des belles courtisanes et ceux des comédiens célèbres font partie de cet univers qui était celui de l'hédonisme, mais aussi la manifestation d'une culture nouvelle. Tout cela donna lieu à des livres et même à des encyclopédies (il n'est qu'à songer au manga d'Hokusai). Les thèmes et les techniques ne cessent d'évoluer au fil du temps. Kiyonaga impose un format plus grand dit ôban. Les fonds sont préparés d'une autre ânière : avec l'usage de paillettes métalliques (fonds micacés, dits kira-e) ou du gaufrage, l'usage de l'impression à vide, etc. La virtuosité graphique de tous ces maîtres a dû être sous-tendue par une toujours plus grande virtuosité technique mettant en valeur leurs qualités. Cet art qu'on dit sorti du quartier réservé de Yoshiwara à Tokyo, qui a remplacé l'ancienne capitale impériale, Kyoto. Hiroshige est sans aucun doute l'artiste qui a représenté le sommet et la fin de l'âge d'or de ces oeuvres gravées sur bois. Mais leur histoire ne s'arrête pas là. Une ultime phase crépusculaire s'esquisse au début du XIXe siècle et Utagawa Kuniyoshi (1798-1861) en est le plus grand représentant. Fils d'un marchand de soie, il aide d'abord son père à réaliser des pochoirs pour ses précieux tissus. Il est bientôt attiré par les illustres graveurs de l'ukiyo-é et choisit pour maître Utagawa Toyokuni. Il a étudié sous sa férule et a exécuté les illustrations pour un livre, une parodie de Chûshingura, puis a fait d'autres livres et des portraits d'acteurs et de samouraï. Mais faute de commanditaires, il revint au style de l'école Utagawa. Pendant les années 1820, il s'est spécialisé dans les scènes de guerre, non sans succès, et a commencé à définir son style propre. Il s'est vu alors commandé des illustrations pour les Cent huit héros et puis pour le roman populaire chinois le Shuiho Zhuan. Puis il a travaillé sur un grand classique, le Heiké Monogatari. Mais en 1841, une nouvelle ère politique commence : les réformes Tempo. Les gravures du monde flottant sont interdites. Mais les Japonais n'ont pas vraiment apprécié ces restrictions et l'artiste a pu continuer à exercer, en faisant attention à ne pas critiquer le nouveau pouvoir. Ce qui frappe dans son style, c'est d'une part la reconnaissance de l'incroyable tradition dont il est l'héritier, mais aussi son intention de la pousser à ses confins. Il a aimé les formes outrancières, et a aussi introduit des contrastes violents, avec beaucoup de noir, du rouge et aussi du blanc. De plus, s'il a fait des portraits de jeunes femmes et des paysages, il a privilégié les histoires fantastiques (présentes dans les contes anciens et modernes), allant jusqu'à représenter des scènes surréelles, effrayantes, souvent cauchemardesques, s'inspirant du théâtre ou de la littérature. Il faut aussi souligner qu'il avait eu une bonne connaissance de l'art occidental et qu'il avait utilisé certaines de ses ressources, ce qui l'a poussé à métamorphoser son écriture plastique. Même ses combats de sumo ont une expression terrible et terrible. La baleine gigantesque, blanche et noire, que tue le héros Musashi est à sa façon aussi puissante que La Vague d'Hokusaï. Son goût prononcé pour le triptyque lui permet de développer une scène ou d'en montrer plusieurs épisodes marquants. Il dépouille beaucoup ses compositions, comme on le voit dans L'attaque de l'embarcation des fantôme : la mer est rendue par des lignes sinueuses simplifiées. Et que dire de cette histoire de La Princesse Yakiyasha qui réveille un spectre monstrueux (1845-1846), le fantôme étant un gigantesque squelette qui s'en prend à de minuscules personnages ? A la fin de sa carrière, ses oeuvres sont le fruit d'une contamination entre Orient et Occident, surtout dans le rendu des personnages. Mais l'esprit qui a alors dominé est resté celui de sa culture. Et cette inclination rend ses sujets encore plus surnaturels ! Ce faisant il est devenu une sorte d'Edgar Allan Poe de l'art, où l'étrange, le fantastique et le morbide sont étroitement associés. Mais il n'en a pas moins été l'un des plus grands auteurs de son temps.

Lettres à Alice, 1914-1919, André Derain, sous la direction de Geneviève Taillade et Cécile Debray, édition de Christina Fabiani & Valérie Loth, Centre Pompidou / Hazan, 296 p., 25 euro.
André Derain en 15 questions, Stéphane Guégan, Hazan, 96 p., 15,95 euro.
La découverte, par le plus grand des hasards, d'une malle remplie de lettre d'André Derain écrites à sa femme au cours de la Grande Guerre n'est pas un événement anecdotique. L'ordre de mobilisation le surprend alors qu'il se trouve à Montfavet, près d'Avignon, en compagnie de Braque et de Picasso (ce dernier déclarera plus part qu'il ne le reverra plus après ce jour). Elles révèlent sa vie de soldat, qui commence par des missions de liaison à bicyclette. Longtemps stationné à Lisieux, il participe à la bataille de la Somme puis à celle de la Champagne et est versé dans l'artillerie où il se distingue pendant la première bataille de Verdun. On apprend des détails de sa vie professionnel alors qu'il se trouve sur le front : il y fait la connaissance du grand couturier et collectionneur Paul Poiret et est contraint de travailler avec un marchand qu'il n'aime pas, Level, car Kahnweiler, étant allemand, a dû se réfugier en Suisse. Les questions d'argent sont omniprésentes. Il charge même Matisse de vendre et d'authentifier ses toiles ! Derain tente de devenir chauffeur de camion ou peintre de camouflages. Mais il ne parvient pas à échapper à son sort. L'ennui est son quotidien quand les combats ne font pas rage. Il se retrouve sur la Somme en 1916, s'occupe tant bien que mal de ses affaires à Paris où se trouve sa femme dans leur appartement et atelier de la rue Bonaparte. Au début de l'année 1917, il prend part à l'absurde et meurtrière bataille du Chemin des Dames. Puis il est envoyé à Verdun. A la fin de l'année, il a fini par réaliser ce qu'il souhaitait : devenir conducteur de tracteurs. L'attente du courrier est une sorte de supplice pour le soldat qu'il était. C'était le seul lien possible avec la vie ! La guerre enfin terminée, il a dû faire partie des troupes d'occupation en Allemagne. Puis il est allé à Londres en mai 1919 pour s'occuper des décors et des costumes de La Boutique fantastique. Cette fois la page belliqueuse est belle et bien tournée.
Le titre de l'ouvrage de Stéphane Guégan, André Derain en 15 questions, et la couverture digne d'un livre pour les enfants, pourrait laisser croire qu'il s'agit là d'un petit traité de vulgarisation ou d'initiation des élèves du petit lycée. En réalité, l'auteur s'est attaché à certains points très précis de son parcours artistiques. Il le fait avec méticulosité, mais s'attache surtout à parler de moments critiques de son existence, en particulier du fameux voyage en Allemagne de 1941 en compagnie de plusieurs peintres et sculpteurs de la collaboration et aux avanies qui ont suivi après la Libération. Tout cela est bien rapide : l'auteur tend à expliquer que Derain n'a pas été un collaborateur ad hoc (ce qui est vrai) et qu'il s'en est sorti assez bien lors des qui ont lieu : il n'a eu qu'un an d'interdiction d'exposition et a été ensuite dédouané grâce au témoignage d'un Juif. Mais c'est trop rapide et parfois trop imprécis. Quand il parle de « l'acharnement communiste », il se laisse emporter par les mots car il n'y a pas eu d'acharnement. Tout ce petit monde peu ragoûtant s'en est sorti assez bien ! Quoi qu'il en soit, on apprend pas mal de choses sur ce qu'a pu représenter Derain en son temps, en particulier l'ascendant qu'il a eu sur Aragon et Breton avec son célèbre tableau intitulé Le Chevalier X (quant à dire qu'il est inspiré par Fouquet, il y a de quoi resté surpris, même si l'on sait que l'artiste l'adorait). Reste à savoir à qui s'adresse vraiment cet ouvrage !

« Un jour, ils auront des peintres », Annie Cohen-Solal, Folio Histoire, 688 p., 11,90 euro.
Avant toute chose, il faut dire que c'est là un livre remarquable. Qu'Annie Cohen-Solal ait eu l'idée de commencer par l'Exposition universelle de Paris en 1867 est sans doute une idée plaisante, car les Etats-Unis y avaient un pavillon. Ils y ont présenté un tableau de grande dimension de Frederic E. Church représentant les chutes du Niagara. Mais il ne faut pas oublié que Church a été un grand peintre et, que pendant la seconde moitié du XIXe siècle, ce pays avait déjà des artistes de valeur. Sans doute étaient-ils assez loin de e qui se faisait de plus novateur en France et ne savait rien de l'impressionnisme et même du réalisme de Courbet. Elle rappelle que Thomas W. Whittredge était allé en Europe en 1849 et avait fréquenté les peintres de Barbizon. Leur pratique ne l'a pas enthousiasmé. Et il est allé ensuite en Allemagne et en Italie se perfectionner dans l'art du paysage dans une perspective plus conventionnelle. Mais, de retour dans son pays, Whittredege a dû convenir qu'il avait été ébranlé par son expérience européenne. Quelque temps plus tard, le marchand de tableaux Paul Durand-Ruel parvient à organiser une exposition des impressionnistes à New York qui a lieu en avril 1886. Monet intéresse passablement la critique américaine. Les impressionnistes ont intéressé les amateurs d'Outre-Atlantique, aussi curieux que cela puisse paraître. Fort de ce succès, Durand-Ruel renouvelle l'opération en 1888. Après quoi deux grands peintres vont venir travailler sur le Vieux Continent, Whistler et Sargent. Le premier est de loin le plus audacieux et le plus novateur, au point même de froisser la sensibilité des esthètes anglais ou français. Le second, fasciné par l'Italie, a tout de même adopté une technique qui l'éloigne de ses contemporains américains. L'auteur n'oublie en aucun cas le rôle éminent Mary Cassatt, qui a été l'une des élèves d'Edouard Manet. Grâce à ces figures talentueuses, l'Amérique se met peu à peu à l'heure de Paris. Cela étant dit, avec d'autres artistes qui ont eux aussi fait le voyage comme Julian A. Wair, New York n'est pas devenue l'antichambre lointaine de Paris. On va y voir se développer un art moderne qui a eu sa spécificité. Le grand artisan de cette histoire a été Alfred Stieglitz, grand photographe s'il en est, mais aussi directeur d'une galerie qui fait découvrir des figures importantes de la nouvelle génération américaine. Mais elle insiste sur le fait que de plus en plus d'artistes américains sont venus étudier à Paris, par exemple à l'Académie créée par Henri Matisse. Sans doute, bien peu de peintres et de sculpteurs américains ont participé à la grande aventure esthétique qui s'est déroulée entre Montmartre et Montparnasse. Ce fut une affaire essentiellement européenne. Mais elle a eu des échos chez eux. Et les écrivains et les artistes français ont commencé à visiter New York, qui peu à peu se faisaient une place notable dans le marché de l'art et était une cité friande des nouveautés qui se faisaient jour dans la capitale française. Et cela a continué jusqu'au jour où les surréalistes ont dû émigrer à cause de la Seconde guerre mondiale et ont, par leur présence, accéléré la montée en puissance d'un groupe d'artistes qui n'a pas tardé a devenir célèbre en proposant une abstraction qui l'a emporté sur celle de l'Ecole de Paris. Tout l'intérêt de ce livre (indispensable à mon sens) est d'abord d'avoir pris du recul et d'avoir fait comprendre que tout n'a pas commencé avec Pollock et Rothko ! Ensuite, Annie Cohen-Solal a su très bien expliquer les choses et avec assez de détails pour que le lecteur puisse être convaincu qu'il s'agit là d'une histoire longue et complexe et non pas une stupide rivalité entre deux grandes métropoles voulant s'arroger le primat dans les arts. Ce livre est indispensable pour savoir l'histoire de l'art américain et même pour mieux apprécier ce qui a amener les artistes français à s'intéresser de plus en plus à ce qui se passait à New York.

Alberto Giacometti, Catherine Grenier, « Grandes biographies », Flammarion, 350 p., 25 euro.
Premier regret quand on lit les premiers chapitres de cette biographie d'Alberto Giacometti (1901-1966) : le peu d'intérêt que l'auteur porte à son père, Giovanni Giacometti (1868-1933), qui a été un peintre important qui a travaillé dans un esprit proche du postimpressionnisme. Il est indubitable que son père, que le cousin de ce dernier Cunot Amiet (1866-1961), qui avait été lié à l'Ecole de Pont-Aven, ainsi qu'un autre cousin de son père, Augusto (1877-1947), ont joué un rôle déterminant dans sa formation artistique. Il suffit de voir son Autoportrait dans l'atelier de son père aux Grisons (vers 1920) pour se rendre compte qu'il avait déjà atteint une maturité picturale remarquable sous la direction de Giovanni. Il va étudier quelque temps à l'Ecole des beaux-arts de Genève, puis se rend à Paris, où il arrive en 1922 (à une époque où tout avait été déjà inscrit dans l'histoire et où ne dominait plus l'esprit des avant-gardes, il décide de se consacrer à la sculpture. Il étude dans l'atelier d'Antoine Bourdelle et fréquente l'Académie de la Grande Chaumière. En 1926, il s'installe derrière la gare Montparnasse et ne quittera plus ce lieu jusqu'à la fin de sa vie. A ce moment-là, c'est le surréalisme qui domine la vie artistique à côté de l'Ecole de Paris qui était tout sauf une école. Il commence par exécuter d e petites pièces qui sont inspirées par les arts africains et océaniens, mais avec une volonté déclarée de simplification extrême des formes (ce qui rappelle de loin les pierres et le s bois taillés par Modigliani). Il participe à une exposition de groupe dès 1926 chez Jeanne Bucher puis au Salon des Tuileries un an plus tard. Il se rapproche d'André Breton et bientôt de bon nombre des artistes de son cercle ainsi que des poètes Tristan Tzara, Louis Aragon, René Crevel. Ses oeuvres deviennent plus complexes et plaisent aux surréalistes avec lesquels il expose. La galerie Pierre lui propose un contrat en 1929. Breton ne tarie pas d'éloges, en particulier à propos de sa Boule suspendue. Les Noailles l'invitent, ainsi que son frère Diego, dans leur incroyable villa ultramoderne de Hyères. En somme, Giacometti donne toutes les apparences de l'artiste « lancé ». Mais sa rupture avec Breton en 1935. Un soir de février, après un dîner, il est mis en jugement par les membres du groupe surréaliste, qui l'accuse de faire des oeuvres décoratives et puis d'être revenu au modèle. On lui demande de se repentir, comme à l'église ! Il ne peut pas accepter une telle humiliation. Ce refus le met provisoirement au ban de la société des artistes d'avant-garde. Mais cette mise à l'écart ne fait que le conforter dans sa volonté de suivre son propre chemin. A part ce démarrage un peu abrupt du début dont j 'ai déjà fait état, cette biographie est tout à fait correcte. Giacometti n'étant pas un inconnu, on aurait peut-être aimé un travail plus développé, entrant plus dans certains détails, en particulier sur ses amitiés. Ou on aurait aussi aimé le suivre dans la conception et la réalisation de son grand livre de lithographie (qui apparu posthume), Paris sans fin, quand il allait s'installer à la terrasse du Café de la Mairie pour dessiner les tours de Saint-Sulpice. Mais c'est un bon livre, une excellente introduction au destin de cet homme énigmatique qui est allé au bout de ses rêves esthétiques jusqu'au jour où il a conçu un des ses chefs-d'oeuvre, L'Homme qui marche, qui a été salué avec emphase et jubilation par Jean-Paul Sartre dans un essai magnifique.

Figura, la Loi juive et la promesse chrétienne, Erich Auerbach, traduit de l'allemand et préfacé par Diane Meur, postface de Marc de Launay, Editions Macula, 140 p., 16 euro.
Le nom d'Erich Auerbach (1892-1957) n'a pas une énorme résonance en France. Pourtant son grand oeuvre, Mimésis : la représentation de la réalité dans la littérature occidentale (commencé en exil à Istanbul en 1935 et publié en 1946) a été traduit en français et publié chez Gallimard en 1968. C'est une réflexion essentielle qui n'a pas encore eu l'impact qu'elle devrait avoir. Ce philologue de formation, qui a écrit aussi bien sur la littérature (Dante en particulier), que sur la philosophie (il avait une passion pour Giambattista Vico), sur l'art et même sur la théologie. Dans ce court ouvrage, Auerbach examine avec précision l'origine du terme figura dans la culture antique. Le terme apparaît pour la première dans un écrit de Terence (L'Eunuque) et signifie figure, mais prend par la suite, dans la culture latine hellénisée, le sens d' »objet façonné ». En même temps ce sens s'élargit et concerne tous les sens. Il étudie en particulier les différents emplois que fait Cicéron de ce mot, qui correspond dans ses écrits à l'idée de forme mais aussi, pour la première fois de figure de rhétorique, concept repris par Quintillien. Quant à Ovide, il lui attribue une autre signification : celle de « copie ». L'architecte Vitruve lui donne celle de forme plastique, plus proche de notre lexique. Pline l'Ancien déplore la décadence du portrait peint, qui s'éloigne de l'apparence de l'être. Avec l'avènement de la foi chrétienne, la figura prend un sens nouveau, déjà chez Tertullien, qui parle de la « figure du Christ », qui n'est cependant pas exclusivement allégorique. Quand le Christ parle de la « figure de son corps », qui serait l'accomplissement d'un intellectus spiritualis. Mais son corps n'est pas une ombre (imago): il est aussi réel. Donc ce corps est concret et réel tout en désignant une dimension spirituelle. Les choses sont assez compliquées à l'époque car Origène n'y voit qu'une pure allégorie morale (ce que Jérôme lui a d'ailleurs reproché). Augustin insiste beaucoup sur le fait que la Bible ne doit pas être interpréter qu'au figuré : le sens premier est figural. Le paradoxe est ici que le réalisme n'exclut pas l'idéalisme. Pour les premiers chrétiens, la figure désigne souvent la « prophétie réelle ». C'est ainsi que l'idée juive de Loi se transforme en celle de la foi. L'Ancien Testament se change en une figura rerum, perdant (plus ou moins selon les interprétations) ses racines judaïques. Mais demeure le fait de la prophétie figurative, qui demeure un événement réel qui en annonce à un autre. Ce serait la caractéristique de la nouvelle alliance. Quant il en vient à parler du Moyen Age, Auerbach a quelques difficultés à y intégrer l'interprétation figurative dans le monde de l'art roman et en appelle à Emile Mâle ! Mais, en revanche, il écrit des pages très lumineuses sur Dante qui renoue avec le monde romain -, celui de Virgile qui est son guide : il lui fait découvrir la perfection terrestre. Béatrice est elle aussi à la fois être de chair et être symbolique, allégorique, comme Virgile, dans la sphère supérieure du divin. Ce livre achevé à Istanbul en 1938, semble n'être que l'ébauche déjà très développé d'un travail plus amble que l'auteur n'a pu ou n'a pas voulu terminer. Mais son enquête philologique est très précieuse car elle permet de mieux comprendre ce que suppose le terme figure, dont le sens est toujours double, dans un équilibre précaire entre le monde tangible et le monde intelligible (ou sacré).

Pinocchio nell'arte, Giovanni Lista, Mudima, 312 p., 30 euro.
Après avoir bâti toute sa carrière en France sur l'étude du futurisme italien, longtemps méconnu et méprisé, n'hésitant pas à faire quelques tours de passe-passe historiques pour ne pas froisser les rares individus disposées à s'intéresser à la question (ce qui, pour un chercheur du CNRS relève de la haute trahison, mais cette noble institution n'a pas de cour martiale), au crépuscule de sa vie, Giovanni Lista a fini par s'intéresser enfin à d'autres question. Son livre sur l'impact de Pinocchio sur les arts plastiques. Il faut d'abord savoir que le livre de Carlo Collodi fait partie du petit bagage culturel tout enfant étant allé à l'école primaire. Pinocchio fait partie intégrante de la mémoire de tous les Italiens, au même titre que Dante aux Enfers ! On se rend compte d'un grand paradoxe, si les illustrations du livre sont innombrables, si des monuments ont même été dressés à sa mémoire dans bon nombre de villes de la péninsule, très peu de grands artistes ont utilisé le petit bonhomme de bois. Le plus célèbre de tous est Jim Dine, qui est Américain né à Cincinnati ! Il y a bien sûr la jolie petite sculpture en bois de Fortunato Depero, exécutée en 1917, le médiocre tableau de René Magritte, la sculpture en bois de Baselitz, l'autoportrait et le masque l'autoportrait de Miquel Barcelò, les oeuvres d'Aldo Spoldi, de Luigi Ontani, sans parler de Robert Combas et d'Errò, mais au fond tout cela n'est qu'anecdotique. Pinocchio n'a quasiment pas sa place dans les arts plastiques. Au fond, seul Igor Makarevich a pu imaginer à la fin des années 1990 une série de travaux dans des techniques très différentes (dont des pastiches très amusants de Malevitch) un travail qui s'est poursuivi sur plusieurs années. Tout le reste est très secondaires et réalisé par des artistes de second ou de troisième rang, sans originalité aucune. Cette compulsive réinterprétation croissante de la figure Pinocchio dans l'art contemporain me semble correspondre à une infantilisation toujours plus prégnante de la création. En revanche, Pinocchio est omniprésent dans la publicité, dans les bandes dessinées et a envahi le monde du cinéma et de la télévision. Ce livre est des plus intéressant car on peut apprécier à quel point un personnage littéraire (et appartenant d'abord à la littérature enfantine, même s'il est venu un « classique ») a connu une existence posthume immense, mais pas toujours de la manière qu'on aurait pu imaginer. Il n'a pas une place plus importante que Mickey Mouse ou Batman, alors qu'il aune toute autre portée. Mais les héros de Victor Hugo n'ont-ils pas connu un destin assez comparable, hélas, avec les dessins animés de Walt Disney et les comédies musicales kitsch ? On peut donc consulter avec intérêt cet essai pour prendre toute la mesure des mythes contemporains, qui sont souvent aussi obnubilants que vides.

Essais et pamphlets, Léon Bloy, édition établie par Maxence Caron préface d'Augustin Lafay, « Bouquins », Robert Laffont, 1.600 p., 34 euro.
On ne peut rêver écrivain plus bizarre que Léon Bloy (1846-1917), même en cette fin de XIXe siècle si riche en personnages extravagants, des Hydropathes à Lautréamont, en passant par Verlaine et Rimbaud. Il n'a jamais écrit que deux romans, le Désespéré en 1887 (pas de presse, aucun succès en librairie) et son pendant féminin, qui devait s'instituée « la Désespérée », et devenu la Femme pauvre, qui est sorti en 1897. Et pourtant, son oeuvre est loin d'être indifférente, avec son Journal (deux volumes dans la collection « Bouquins », robert Laffont) et ses innombrables essais sur des écrivains, des figures historiques (c'est un fervent admirateur de Napoléon) et sur la religion (il traite Jeanne d'Arc en héroïne). Si l'on éprouve le désir de savoir qui a été vraiment Léon Bloy, il ne faut pas oublier qu'il a été le fils d'un fonctionnaire franc-maçon et d'une fervente catholique et que, par la suite, après ses études à Périgueux, il est allé habiter à Paris, dans la très provinciale rue Rousselet, juste en face de Jules Barbey d'Aurevilly. Il a admiré sans réserve le « Connétable des lettres », ultra-catholique, ultra-monarchiste, ennemi des auteurs installés (qu'on songe à ses portraits au vitriol des académiciens) et terriblement désargenté. Ce dernier le ramène à la religion apostolique et romaine et, après la guerre contre la Prusse, où Léon Bloy s'est distingué par son courage au combat, le vieux « Connétable des lettres », dont il est devenu le secrétaire bénévole, le fait entrer dans le grand quotidien L'Univers. Mais ses débuts sont une suite d'échecs : il est expulsé du Figaro, ne trouve pas d'emploi rémunérateur et personne ne souhaite le publier. Il finit par travailler aux chemins de fer du Nord (dont il démissionne en 1878). Il s'éprend alors d'une prostituée, Anne-Marie Roulé, qu'il veut remettre dans le droit chemin, Mais celle-ci sombre dans la folie en 1882 et est internée à l'hôpital Sainte-Anne. Ce drame a été pour lui l'impulsion qui l'a conduit à la littérature. Il rassemble ses principaux articles dans Belluaires et Porchers en 1888. Il se lie d'amitié avec Huysmans, Jehan Rictus, Alfred Jarry et subsiste par quelques collaborations dans des périodiques, comme Gil Blas. La mise en oeuvre d'un essai tel que le Salut par les Juifs, en 1892, est surprenante pour l'époque : le catholicisme militant, comme celui du journal La Croix, fondé en 1883, s'accompagnait d'un antisémitisme revendiqué. La publication de la France juive, long pamphlet écrit par le directeur de La Libre Parole, Edouard Drumont (1844-1917), paru chez Flammarion en 1885 et financé par Alphonse Daudet, connaît un réel succès : plus de 60.000 exemplaires sont vendus la première année. Fort de son coup d'éclat, le médiocre journaliste et encore plus médiocre essayiste crée en 1890 la Ligue nationale antisémitique de France et est même élu député en 1898. Léon Bloy a d'ailleurs écrit ce curieux ouvrage en réaction à cette énorme somme de mensonges grossiers et d'ignominies. Si sa foi catholique est extrême et sans frein (c'est lui qui a converti le protestant Jacques Maritain et sa compagne juive !), il refuse toute forme d'antijudaïsme. Au contraire : il se met en devoir de défendre les Juifs et son attitude surprend une époque qui allait bientôt connaître la nauséeuse affaire Dreyfus qui commence en 1894 et qui culmine avec le J'accuse ! D'Emile Zola à la une de L'Aurore quatre ans plus tard. « Salus ex judæis est », a dit le Christ à la Samaritaine au puits de Jacob. Léon Bloy démontre une connaissance des Ecritures mais aussi des exégètes dans ce livre virulent contre le livre de Drumont « qui assomme régulièrement les peuples chrétiens » : « Car enfin, M. Drumont entrait en héros dans Babylone, après avoir déconfit toutes les nations sémitiques, et les admirateurs de ce conquérant reniflaient sur lui la poussière du saint roi Midas... » L'écrivain manie une langue insolite, associant étroitement la prose la plus virulente qui soit et le langage le plus sophistiqué et le plus érudit qu'on puisse imaginer. Pour exposer son point de vue, qui rappelle ce que tout bon chrétien doit à l'Ancien Testament, et que Jésus-Christ n'a fait que réactiver et prolonger l'enseignement des grands Patriarches. Il montre que le peuple juif est victime de son histoire -, une histoire comparable à aucune autre. Il démonte un à un les pauvres arguments de Drumont avec une jubilation féroce, lyrique, mais savante. Il démontre que l'Eglise a plutôt protégé les Juifs qu'elle ne les a persécutés. Il plaide même en faveur du malheureux Judas. Avec une poésie rageuse et rude, Léon Bloy rappelle que ce qui s'est passé depuis « les Matines du Jeudi absolu jusqu'à l'immense alléluia de la Résurrection » n'est que l'accomplissement d'une longue épopée spirituelle engendrée par la pensée juive. Et le Christ d'expliquer : « nul excepté le Père, ne le connaissait ! » Tout en faisant l'éloge du christianisme, Léon Bloy a tenu à expliquer aux dévots aveugles et bornés cette histoire qui s'enracine dans un passé biblique et que tous les défauts des Juifs ne peuvent faire oublier le fait que « le salut du monde est cloué sur Moi, Israël, et c'est de Moi qu'il faut descendre ». Même si ses réflexions peuvent parfois sembler étranges ou parfois paradoxales, Léon Bloy a fait preuve ici c'une intelligence rare en matière de religion, avec une grande compassion. Il est servi par un grand talent littéraire, lui aussi hors du commun et paradoxal, mais d'une force corrosive irrépressible.

Préface aux oeuvre posthumes de Spinoza, Jarig Jelles, traduit du néerlandais par Louis Meyer, précédé du Salut par l'Ethique, traduit du latin par Bernard Pautrat, Allia, 178 p., 6,20 euro.
Spinoza par ses amis, Jarig Jellez & Lodewijk Meyer, traduit du latin et préfacé par Maxime Rovere, Rivages Payot, 384 p., 8,50 euro.
Curieuse coïncidence que la réédition de ces deux ouvrages qui ont pour traits communs d'avoir été écrits par des contemporains du grand philosophe juif Baruch Spinoza (1632-1677). Baruch Abraham de Espinosa est d'origine portugaise. Ses grands-parents faisaient partie de ces marranes (Juifs convertis au catholicisme) qui ont été chassés de leur pays comme ce fut le cas en Espagne en 1492 (son grand-père se trouvait déjà à Amsterdam en 1493). Il n'a cependant pas été élevé selon les préceptes de la religion chrétienne, car les Juifs sont alors regroupés dans une communautés, qui a fini par revenir à ses croyances originelles. En 1656, il est vertement exclu de la communauté (par la déclaration du herem), ce qui est un fait vraiment exceptionnel. Il poursuit ses études auprès d'un philosophe peu conformiste, Franciscus van der Enden, émule de Francis Bacon et surtout de René Descartes, ce qui a eu une grande influence sur la pensée du jeune homme. (L'ascencant de Descartes est d'ailleurs très grand). Il gagne sa vie en fabriquant des objets d'optique et des lunettes. Il a commencé écrire l'Ethique, mais l'interrompt pour rédigé son Traité théologico-politique, qui paraît anonymement en 1670. Son livre est à deux doigts d'être interdit par les Provinces Unies. Mais il suscite des réactions très violentes et même après sa disparition, le grand philosophe des Lumières juif Moses Mendelsshon le traitera de « chien crevé » !) . Il n'y a guère qu'un esprit éclairé comme Leibniz pour le défendre. Il écrit ensuite un Abrégé de grammaire hébraïque, un Traité de la réforme de l'entendement, et un Traité Politique, tous inachevés. En revanche, il termine son Ethique en 1675 mais ne parvient pas à la faire publier de son vivant. Ses amis les plus proches, comme le médecin Lodewijck Meyer (c'est lui qui s'est chargé de l'édition de l'Ethique dès 1677) et le théologien Jarig Jellesz (ou Jelles), se sont employés à diffuser son oeuvre et à la commenter. La chose la plus singulière est qu'il en font un penseur chrétien et mette en avant son prénom latin, Benedictus. Comme il a souvent été accusé (à tort) d'athéisme, ils ont jugé bon de protéger l'originalité et la nouveauté de sa pensée en insistant sur ses références au Nouveau Testament. Cette pensée repose sur le rejet de la nature divine de la Loi juive, s'emploie à faire une exégèse rationnelle de la Bible et a aussi sur la conviction que l'homme ne connaît pas le libre arbitre. Il considère plutôt, pour dire les choses de façon schématique, qu'il existerait une convergence de déterminisme (causes extérieures contraires) et de liberté. Tout est gouverné selon lui par le conatus, l'idée que « chaque chose s'efforce de persévérer dans son être ». Mais, comme Descartes, il se sert de la mathématique comme fondement de sa philosophique. Dieu est pour lui une Nature « nécessitée », qui est une puissance absolue, dans la perspective d'une immanence. Il conçoit que la Raison intérieure, autrement dit l'intellect de Dieu, ne diffère pas de Dieu lui-même... » Erasme aurait eu, dit-il, déjà l'intuition de ce fait. Et la Raison (terme qu'il met à la place de Verbe dans la traduction de Logos) est le moyen d'arriver non seulement à la connaissance, mais aussi à la sagesse et à l'Esprit divin. Cette façon radicale de penser lui a valu soit d'être qualifié de panthéisme, soit d'être qualifié d'athée car il oublie la transcendance, la grâce, la révélation, etc. Jarig Jelle(z) et Lodewicjck ont apporté une lecture très subtile de Spinoza, qui le rend presque acceptable pour les lecteurs de la seconde moitié du XVIIe siècle et une vision claire de sa philosophie, qui ne la dénature pas, tout en s'efforçant d'en escamoter les arêtes les plus tranchantes.
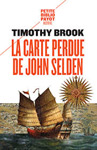
La Carte perdue de John Selden, Timothy Book, traduit de l'anglais (Canada ) par Odile Demange, Petite Bibliothèque Payot, 366 p., 10 euro.
John Selden (1584-1654) a été un juriste, mais surtout un homme politique qui a siégé aux Communes. Il est emprisonné en 1629 après la discussion de la Pétition des droits, brusquement interrompue par Charles Ier. Il est liberté sous condition deux ans plus tard et est obligé par le souverain à publier son livre Mare Clausum, réponse vigoureuse au Mare libertum du Hollandais Huig de Groot dit Grotius, où il définit les limites et les droits de la souveraineté navale britannique. Il se révèle aussi un grand orientalisme et connaît plusieurs langues dont l'hébreu, le syriaque, l'arabe, le persan, le turc et le chinois. Il est aussi l'ami de grands écrivains de son temps, dont Ben Johnson, Francis Baumont et John Donne. Son oeuvre concerne surtout les questions juridiques, dont une histoire du duel judiciaire, sur l'histoire de l'Angleterre, mais aussi la question du divorce chez les Juifs (Uxor Ebraica). Le livre de Timothy Brook évoque d'abord une célèbre carte de la Chine léguée par John Selden à la Bodeleian Library. Mais l'auteur a choisi comme point de départ la carte du monde exécutée en 1507 par Martin Waldseemüller et qui se trouve aujourd'hui à la Library of Congress de Washington. Cette merveille, retrouvée par un jésuite en 1901 dans un état excellent est une merveille, mais a surtout pour valeur ajouté d'y représenter l'Amérique pour la première fois. L'auteur relate avec beaucoup d'esprit les recherches qu'il entreprend pour voir de ses propres yeux la carte possédée par Selden, pour mieux connaître ce personnage important de l'histoire anglaise, décrivant les voyages qu'il doit faire pour compléter ses connaissances et expliquant aussi son désir de découvrir ce que les Chinois savaient pendant la période Ming. Le grand navigateur, l'amiral Zeng-He (1371-1433), qui a réussi à faire construire une flotte de 70 vaisseaux, sans nul doute les plus grands jamais construits jusqu'au XIXe siècle (138 mères de long sur 55 mètres de large avec neufs mâts) et a exploré les côtés de l'Océan indien, de l'Afrique et du Moyen-Orient. De ses voyages, il a pu faire dessiner des cartes très précises et ses aventures ont été narrées par son compagnon de route, Ma Huan dans un livre traduit en français Merveilles des océans. La Chine a connu sous les Ming une grande histoire navale, qui n'a pas été poursuivie par les dynasties suivantes. Notre auteur ne suit pas une narration linéaire, mais évolue en spirale, expliquant par exemple les tensions qui existaient en ce temps-là entre la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies en Asie pour la possession de certaines îles, sur les comptoirs commerciaux et la libre circulation maritime, ou comment les Chinois ont commencé à explorer le monde les entourant par les routes maritimes. Il expose longuement les différends qui ont opposé John Selden au pouvoir royal et comment son traité sur la Mer fermée a fini par voir le jour. Il analyse ensuite les commentaires apportés à la carte lui appartenant, qui avait été incluse dans le livre d'un ami, Samuel Purchas (vers 1575-1626) qui, non content d'avoir pastiché son histoire des Juifs en Angleterre dans ses Pilgrimages, paru entre 1613 et 1625, s'était aussi approprié la fameuse carte, sans doute issue de la prestigieuse collection de Richard Hakluyt, en y rajoutant des légendes qui n'y figuraient pas. La Chine, en revanche, assez bizarrement, n'a conservé pour sa part aucune des cartes de cette époque. Ce qui fait toute la valeur de l'oeuvre de Timothy Brook, s'est d'avoir su expliquer des questions réservées aux érudits et de faire revivre toute l'importance de ces cartes géographiques, qui avaient des implications navales, bien sûr, mais aussi géopolitiques et économiques de premier ordre. Il a écrit ce livre comme un roman personnel, mais sans jamais versé dans les pièges de la vulgarisation. C'est une véritable recherche historique qui s'est transformée en une quête dédalique du savoir.
|
