
Amadeo de Souza-Cardoso, sous la direction de Helena de Freitas, Réunion des Musées Nationaux - Grand Palais, 288 p., 40 euro.
Amadeo de Souza-Cardoso a subi le même sort face à la postérité que le grand peintre tchèque Bohumil Kubista : ils ont été l'un et l'autre emportés par l'épidémie de grippe espagnole juste à la fin de la Grande Guerre. Le premier a participé au groupe Osma, puis a été le chef de file du cubisme à Prague ; le second a été le principal représentant du cubo-futurisme portugais, qui s'était constitué autour du numéro unique de la revue Portugal futuriste en 1917. Fils de riches propriétaires, le jeune artiste, qui commence à peindre en 1908, n'a jamais connu de problèmes matériels ; mieux encore, son père l'encourage. Après l'université et les cours ennuyeux de l'académie, il décide de se rendre à Paris et il s'installe à Montparnasse, rejoignant alors quelques compagnons portugais. Après une expérience de deux ans, il rentre dans son pays natal et travaille dans un atelier situé dans un petit village. Il expose alors au Salon des Indépendants et au Salon d'Automne, revenant souvent à Paris. En 1911, il envoie un tableau intitulé Le Saut du lapin à l'Armory Show, qui a eu du succès et a été même acheté. Ses créations subissent alors diverses influences, celle du cubisme bien sûr, mais aussi celle du rayonnisme et du futurisme. Malgré ce contact permanent avec les nouvelles formes d'expression picturale, il parvient à inventer une manière qui lui est propre et qui se distingue de ses grands modèles. Sa gouache, qu'on a baptisée à posteriori Clown, cheval, salamandre (1911) le prouve amplement. Et quand il s'engage dans une voie plus expérimentale, il affirme toujours la même originalité, car il ne suit les pas de personne en particulier, utilisant souvent l'imagerie et les traditions populaires du Portugal. Son « futurisme » ne suit pas les préceptes de ses aînés italiens, mais se sert de ces préceptes pour gagner plus de liberté. Le futurisme portugais, où l'on retrouve ses amis et grands admirateurs Pessoa et le peintre Almada-Negreiro, n'a jamais partagé les principes de Marinetti (sauf peut-être sur le plan politique !). Quoi qu'il en soit, son exposition de 1916 à Porto et à Lisbonne engendre des polémiques, car il s'est orienté à la fois vers la notion d'homme-machine et vers une relative abstraction. Le public portugais de cette époque n'était pas préparé à ça ! Cet ouvrage, tout comme la magnifique exposition du Grand Palais, permet de découvrir ce magnifique artiste disparu à l'âge de trente ans.

Papiers, Soulages, sous la direction de Jean-Louis Andrade, Hazan : Musée Picasso Antibes, 160 p., 25 euro.
Ce catalogue présente de très belles oeuvres sur papier de Pierre Soulages et je regrette beaucoup de ne pas pouvoir visiter cette exposition. Je me console néanmoins car on y trouve sans nul doute le meilleur de sa production des années cinquante à nos jours. Bien sûr, l'artiste a tenu à mettre l'accent sur ses noirs, bien qu'il ait utilisé quasiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel jusqu'au jour où il a commencé à travailler ses Outrenoirs, je veux parler de ses grands monochromes noirs dont les plissures épaisses captent la lumière. Heureusement, quelques exemples colorés nous font échapper à une idée fabriquée de toute pièce d'un homme qui n'aurait jamais utilisé autre chose que le brou de noix ! Je dois avouer, en ayant examiné ce volume, que je trouve ses créations sur papier souvent plus belles et plus inventives que ses toiles, construites, depuis ses débuts, en règle générale, selon un canevas un peu rigide. Ces compositions sont plus spontanées et offrent une variété très grande de propositions plastiques, qu'on ne retrouve pas dans ses oeuvres peintes à l'huile. Là, on trouve le véritable artiste, moins soucieux des effets produits par ce qu'il prémédite pour ses tableaux (je fais allusion aux tableaux de ses débuts jusqu'aux années soixante-dix), avec une grande richesse dans l'expression plastique. L'aventure le tente toujours dans ce domaine, alors qu'il a figé sa peinture dans un registre immuable qui n’admet que de maigres variations. C'est donc un bel outil pour saisir la démarche de cet artiste qui est devenu le peintre français vivant le plus connu dans le monde.

Sur le film, Philippe-Alain Michaud, éditions Macula, 464 p., 38 euro.
Philippe-Alain Michaud n'a pas écrit une nouvelle histoire du cinéma, mais s'est plutôt attaché à comprendre les tenants et les aboutissants de l'expression filmique. Cela dépasse largement le cadre du cinéma tel que nous l'entendons. Pour se faire mieux comprendre, il remonte à la fin de la Renaissance, puis au XVIIe et XVIIIe siècles pour expliquer les grandes transformations qui ont lieu dans le décor de théâtre, à partir de l'utilisation des règles de Vitruve (qui ne sont pas redécouvertes comme il l'avance, car elles ont été utilisées au Moyen Age) jusqu'à la notion de décor « naturel » avancée par Diderot. Il examine ensuite les projets de panoramas et l'idée de leur mouvement. En faisant des parallèle constants entre les origine du Septième Art et les créations les plus avant-gardistes les plus proches de notre temps, il parvient progressivement à nous faire comprendre son dessein : nous faire comprendre que toutes les recherches accomplies par les principaux créateurs d'une cinématographie qui n'est pas simplement un simulacre du réel, sont la traductions des formes de pensées les plus exigeantes et les plus modernes. Ainsi les théories de Merleau-Ponty se trouvent-elles en mesure d'expliquer la démarche de certains d'entre eux. Ce livre est absolument passionnant parce qu'il sort des conventions sur le sujet, mais aussi parce que la manière de l'aborder est d'une toute autre nature. Il ne faut pas le considérer comme une approche spéculative qui sous-tendrait une doctrine quelconque, mais comme un apprentissage de la pensée et du regard, un nouvel usage de l'oeil par rapport aux données reçues et emmagasinées. En somme, Ph.-A. Michaud nous enseigne à voir et à comprendre ce que peut être une conception radicalement nouvelle du film. Bien sûr, il est difficile d'adhérer à toutes ses conceptions, surtout en matière de vidéo, mais c'est un précieux travail permettant à autrui de ne pas se limiter à ce qui lui a été enseigné et à ce qu'il a pu connaître à travers les films dans les salles de cinéma. Immense travail, immense recherche, des idées à revendre, pas de théorie générale, mais des percées théoriques soutenues par les peintres, les écrivains, les philosophes, les savants. Son livre est en soi une expérience cinématographique puisqu'il faut voir pour entendre.
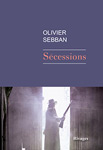
Sécessions, Olivier Sebban, Rivages, 350 p., 20 euro.
Ce beau roman commence en Géorgie, dans le Sud des Etats-Unis au milieu du XIXe siècle. Une famille d'origine juive, venue d'Espagne. Un drame épouvantable s'y produit : un frère a tué l'autre. Le meurtrier, Elijah, s'enfuit et son père, Amos, et les représentants de la loi se lancent à sa poursuite. Il parvient à leur échapper, mais se retrouve dans une situation difficile. Au fil du récit, on en apprend plus sur le père, qui a choisi l'un de ses enfants au détriment de l'autre, Elijah avait une relation avec la femme de son frère et il en a eu un enfant, Isaac, que leurs grands-parents élèvent avec amour. Le fugitif tente de se faire une vie à Chicago. Puis survient la guerre de sécession et ses terribles combats. Pour Elijah, plusieurs situations dramatiques se présentent, en particulier avec sa belle soeur. Mais il réussit à trouver un équilibre avec sa compagne, Molly. Isaac, quant à lui, a cherché celui qu'il croit être son oncle et quand il le retrouve il travaille dans la même société. Il finit par savoir qu'il est son fils et l'acceptera. A travers cette saga familiale, qui a quelque chose de la tragédie grecque, avec cette violence sourde et ces destins inéluctablement tracés, on découvre aussi l'Amérique de cette époque, un monde qui commence à devenir une Nation développée et industrieuse, mais au prix d'une sanglante guerre civile. Sécessions est une oeuvre bien écrite, bien élaborée, à la fois classique et curieuse, comme une perle baroque, avec toute l'étrangeté des paysages et des moeurs des Etats confédérés et l'impressionnant développement de grandes cités comme Chicago et New York. L'histoire est traitée avec une sorte de rigueur presque biblique ! Et pourtant, en dépit de ces gestes irréparables et de l'esprit de vengeance, la compassion et le pardon finissent par l'emporter, en dépit de toutes les souffrances endurées par tous les personnages.

Le Voyant, Jérôme Garcin, folio, 208 p., 7,10 euro.
Et la lumière fut, Jacques Lusseyran, Folio, 432 p., 7,10 euro.
Le Monde commence aujourd'hui, Jacques Lusseyran, Folio, 192 p., 6,50 euro.
Je dois reconnaître que je n'ai jamais lu un livre de Jérôme Garcin. Sans doute sa longue présence dans le microcosme de la critique littéraire parisienne a-t-il provoqué une sorte de prévention injustifiée ? Sans doute. Mais je le regrette, car cet ouvrage est assez beau et très bien écrit. Il s'agit ici d'une biographie, et celle d'un homme peu commun puisqu'il s'agit de Jacques Lusseyran, devenu aveugle à huit ans à cause d'un accident cérébral survenu à l'école et qui a su apprendre à tirer profit de sa brutale infirmité. Cela ne l'a pas empêché d'étudier au lycée Louis-le-Grand, puis d'entrer à l'université pour approfondir ses connaissances littéraires. Il a même participé à la Résistance, a été arrêté en 1943 et expédié au camp de Buchenwald. Après la guerre, il se met à écrire et puis a enseigné la littérature aux Etats-Unis. Il disparaît prématurément dans un accident d'automobile en 1971. Il a laissé derrière lui deux romans. Jérôme Garcin est parvenu à faire de cette biographie une oeuvre « romanesque » sans jamais pourtant s'écarter des règles indispensables pour relater la vie d'un personnage disparu. C'est architecturé avec beaucoup de subtilité et il sait raconter ce destin incroyable sans tomber dans l'adulation ou l'admiration béate. Il restitue l'existence de cet homme avec un véritable talent et avec une grande sensibilité. C'était une gageure. Et il a su relever ce défi.
Les deux ouvrages posthumes de jacques Lusseyran sont des autobiographies. La première couvre la plus grande partie de sa vie jusqu'à sa libération du camp de concentration. La partie la plus fascinante est sans nul doute celle où il décrit ce qu'il a pu éprouver et vivre après l'accident qui l'a rendu aveugle : c'est admirable, bien sûr, de courage et de volonté, mais c'est surtout passionnant de comprendre comment il a pu vivre cet état. On peut songer à la Lettre aux aveugles de Diderot (à laquelle il ne se réfère pas !), mais c'est surtout la création d'un univers intérieur tourné vers l'intérieur par la force des choses, mais qui n'exclut pas l'extérieur. Tout au contraire, il parvient à le maîtriser et à y exister malgré son handicap grave. Mais les deux livres sont admirables et doivent être lus. Le second revient sur les mois terribles passés à Buchenwald pour évoquer les individus qu'il y a connus et dont il a pu analyser les qualités et les défauts dans une épreuve surhumaine.

Le Géant enfoui, Kazuo Ishiguro, traduit de l'anglais par Anne Rabinovitch, Folio, 464 p., 8,20 euro.
Aucune période de l'histoire n'est aussi obscure que celle de l'Angleterre après la chute de l'empire romain. C'est d'ailleurs à cette époque qu'aime situer la geste du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. L'auteur de cette fiction a fait le même choix. Il peut donc laisser libre cours à son imagination. De quoi s'agit-il ? Axel et Beatrice vivent heureux dans leur région, qu'ils n'ont jamais quittée. Mais ils éprouvent une grande nostalgie en songeant à leur fils parti depuis longtemps et dont ils n'ont plus jamais eu de nouvelles. Ils décident de partir à sa recherche. Leur quête les mène dans des territoires inconnus et parfois dangereux et leur font faire les rencontres les plus extravagantes. Ce long périple est une sorte de voyage initiatique avec foule d'événements merveilleux. Ils surmontent de grandes difficultés et échappent à des dangers effroyables. Mais ils ne parviennent pas à leur but. Il faut admettre que c'est bien fait et qu'on se laisse prendre à ces pérégrinations fantastiques. Cela fait penser à beaucoup d'autres choses écrites dans la même veine, qui semble un sujet de prédilection de la littérature anglo-saxonne. Mais on ne réussit cependant pas à croire à cette histoire à dormir debout. Le trop plein d'enchantement et de magie se révèle lassant et l'imagerie est un peu usée. Sans doute est-ce un bon instrument pour passer un long voyage solitaire et très ennuyeux, mais cela ne peut pas constituer un ouvrage mémorable.

Par la fenêtre, Julian Barnes, traduit de l'anglais par Jean-Pierre Aoustin, Folio, 400 p., 8, 20 euro.
Je constate que pas mal des essais contenus dans ce recueil concernent la France. Même quand il parle d 'auteurs anglo-saxons, il le fait souvent par rapport à notre culture : Kipling et la France, Ford Madox Ford et la Provence. L'auteur du Perroquet de Flaubert ne pouvait manquer d'écrire sur l'auteur qui lui avait inspiré un de ses meilleurs livres : il étudie les différentes traductions en anglais de Madame Bovary. Il s'intéresse aussi à Félix Fénéon, l'auteur des Nouvelles en trois lignes et à son étrange tournure d'esprit. Il fait l'éloge de Chamfort, avec beaucoup de perspicacité et, enfin, a tenu à souligner le rôle éminent de Prosper Mérimée dans le sauvetage des monuments historiques de notre pays. Bien sût, on trouvez bien d'autres choses, comme cette défense et illustration d'Hemingway. Mais ce sont les essais qui concernent la culture française qui sont les plus attachants.

Gaz, plaidoyer d'une mère damnée, Tom Lanoye, traduit du néerlandais (Belgique) par Alain van Crugten, Editions de la Différence, 80 p., 10 euro.
Ce petit ouvrage a vu le jour pour les commémoration de la terrible bataille d'Ypres (1915), où les Allemands ont employé pour la première fois du gaz toxique (appelé par la suite ypérite) contre les forces alliées en faisant un nombre de victimes important. L'auteur a choisi de ne pas parler directement de ces faits hélas bien connus, mais a imaginé un drame contemporain. C'est une mère qui raconte, avec une certaine âpreté, sa relation compliquée avec un fils qui, comme beaucoup de fils, quitte un beau jour le foyer familial. Ce n'est pas pour se construire une vie qu'il le fait, mais pour aller combattre avec les fous de Dieu islamistes et pour finir par commettre un attentat abominable en jetant du gaz toxique dans une rame du métropolitain. Cette histoire est simple et narrée avec une certaine dureté, comme pour en souligner l'horreur pure. L'auteur ne cherche pas à comprendre les motivations, ne tente pas d'expliquer cette rapide dérive vers l'islamisme radical et criminel. IL raconte les faits que sa mère n'a pas le pouvoir de comprendre. C'est un livre prenant, car ici la question demeure en suspens : pourquoi ? Pourquoi tuer tant d'innocents et mourir soi-même ? Quel le sens de ce combat absurde ? Aucune réponse bien entendu ne vient ni de l'héroïne (la mère) qui est la seule à s'exprimer dans ce texte, ni de la part de l'auteur. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement, au-delà du religieux (cela va de soi) et au-delà de l'humain. Ce garçon était un garçon comme tant d'autres, sans qualités ou défauts particuliers. C'est la banalité absolue de ces tueurs en série qui bouleverse et étonne. Et c'est une page de l'histoire qui se tourne avec les attentats suicides. Nul ne peut prédire ce que l'avenir nous réserve. Bien des adolescents se suicident. Mais qu'il entrainent dans la mort des dizaines de personnes reste un mystère.

Les invécus, Andréas Becker, Editions de la Différence, 206 p., 18 euro.
Un accident grave de voiture : voilà le point de départ de ce roman peu banal. Le passager, un homme âgé meurt, et le conducteur est vivant mais sérieusement blessé. A partir de là les frontières entre la réalité et l'imaginaire se dissolvent. Le responsable de l'accident reconstruit laborieusement les événements de son existence par bribes et semble devoir n'exister que dans une zone où la conscience et l'inconscience ne font quasiment plus qu'un. Il est entouré de personnages dont on ne parvient jamais à savoir s'ils sont bien présents ou s'ils sont simplement le fruit de son imagination. « Savoir ni où ni comment. Pas chercher à savoir où ou quand ou comment. Laisser vagabonder l'esprit. » C'est donc un récit sans bride qui se déroule à mesure qu'on avance dans la lecture, qui dévoile des fragments disloqués de ce qu'a pu être l'enfance et le passé de héros, dont nous n'arrivons jamais à faire le portrait ou comprendre les actions. Malgré cette course décousue à la recherche d'un sens, d'une chronologie, d'une histoire familiale, on ne peut abandonner la lecture de cette fiction, car elle possède un charme satanique : ce qui semble si insensé et délirant même, se révèle être la révélation d'un univers mental corrompu mais d'une densité peu croyable. C'est entre Céline et W. S. Burroughs, mais c'est aussi très différent de ces deux grands écrivains qui sont allés au fond de l'impensable. Les tentatives désespérées de cet homme de « recoller les morceaux » se changent en une sorte d'Odyssée tragicomique, où foisonnent les images les plus saugrenues et folles tout en reconstruisant du sens. A la fin du livre, le héros dit : « J'avais considéré ma vie comme une oeuvre d'art. Mais il me restait une dernière pièce alors que le puzzle était terminé. » C'est le sentiment qu'on ressent en suivant ses pérégrinations dans un labyrinthe où tout se métamorphose et fait apparaître le monde tel qu'il est peut-être vraiment - délétère et abominable. Andréas Becker a écrit un ouvrage qui sort de l'ordinaire et qui vous prend du début jusqu'au point final alors qu'on n'est jamais très sûr d'avoir saisi le fond de l'affaire. Il faut le découvrir sans faute.

La Femme qui dit non, Gilles Martin-Chauffier, Folio, 400 p., 7, 70 euro.
Ce roman paru en 2004 raconte une partie de l'existence de Marge, une jeune anglaise, qui arrive un beau jour de 1938 en voilier sur l'Île-aux-Moines. Elle y épouse Blaise et tombe enceinte quand la guerre de 1940 arrive à son terme tragique en France. Blaise entend l'appel du général de Gaulle et décide d'aller à Londres. A cause de son état avantageux, elle ne peut pas le suivre. Elle doit rester sur l'île et voit arriver les Allemands et les administrateurs nommés par Vichy. Son meilleur ami, Matthias, va, lui, s'engager dans la collaboration. A travers les vicissitudes vécues par son héroïne, l'auteur a dépeint la France de la période de l'Occupation et renverse un tant soit peu le s valeurs. Les valeureux résistants ne sont pas sympathiques, alors que certains collaborateurs le sont. Tout le roman a cette tonalité, qui est franchement agaçante. C'est vrai, si l'on parle des Français de ces années difficiles, on aurait pu rencontrer ces cas de figures, c'est l'évidence même. Mais ce perpétuel renversement des conventions engendre un certain malaise : on sait bien que tout n'est pas noir ou blanc. Et puis ce savant dosage de roman sentimental et de roman historique repose sur une ambiguïté. Le sérieux et le grave sont associés aux plus banales amourettes. Cela aussi existe, c'est vrai. Mais là, l'auteur fait tout son possible pour que son lecteur puisse trouver la satisfaction de ses appétences fleur bleue et son intérêt pour l'histoire récente, car il nous fait traverser les guerres coloniales et ne nous abandonne qu'au moment des jeux olympiques de 1964. D'un côté, il faut saluer le savoir-faire du conteur, de l'autre, il faut déplorer les dérives d'un fabriquant très doué. Le début, très bien écrit, laissait espérer un ouvrage plus original.

Depuis que la samba est samba, Paulo Lins, traduit du portugais (Brésil) par Paul Sainot, Folio, 268 p., 7,70 euro.
L'auteur nous fait remonter le temps : nous voici dans la Roi de Janeiro dans les années vingt. C'est-là le triomphe du pittoresque avec les filles de joie et leurs souteneurs, les malfrats de toutes sortes, les marginaux les plus extravagants et des personnages dignes d'un film d'aventure. Le héros de cette histoire, Brancura, fait partie de cette faune exotique, qui fraie avec la pègre locale. C'est un bel homme, séduisant et plein de ressources. Il a un défaut plus fort que les autres : la jalousie. Il est proxénète et n'hésite pas à faire quelques mauvais coups. Mais il est fou amoureux de Valdirène, une belle prostituée pulpeuse, qui est soutenue jalousement par son meilleur ennemi Sodré. L'affrontement est inévitable. Cela se transforme en une sorte d'épopée picaresque et arthurienne dans les mauvais quartiers de la grande métropole. Mais sa véritable passion est la musique. Ses démêlés amoureux représentent une entrave pour l'exercice de la musique qu'il aime tant. Mais, malgré tout ce qui l'entraîne dans des mésaventures plus ou moins pitoyables, il parvient à participer à cette grande métamorphose de la musique brésilienne. Il faut reconnaître que ce roman est savoureux et que l'auteur sait dépasser le cadre du purement pittoresque pour nous faire découvrir le moment où les blocos (aujourd'hui, on parle d'« écoles») de samba se créent malgré les interdictions. Dans un monde turbulent et dangereux où Paulo Lins nous entraîne en nous en faisant découvrir tous les aspects, même les plus secrets, c'est l'essence d'une nation qui est en jeu. L'écriture baroque et rythmée de ce dernier est un atout maître pour aller bien au-delà des clichés et en savoir beaucoup plus long sur la naissance de cette danse et de cette musique qui s'imposent aujourd'hui comme les thèmes allégories de cette cité et son tempo.

La Rue chaude, Nelson Algren, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Roger Giroux, « L'imaginaire », Gallimard, 432 p., 14 euro.
De nos jours, les esprits curieux connaîtront mieux Nelson Algren parce qu'il a été pendant plus d'une décennie l'amant de Simone de Beauvoir (cette dernière parle de lui dans les Mandarins (1954). Nelson Agren (c'était le pseudonyme de Nelson Ahigren Abraham) a commencé à publié en 1933 dans une revue et puis a vu paraître son première livre inspiré par la Grand Dépression, Somebody in Booots (Un fils de l'Amérique) en 1935. Il s'impose comme l'un des auteurs les plus originaux de Chicago. Il commence à vraiment s'imposer après guerre avec, entre autres, The Neon Wilderness (Le Désert du néon), des nouvelles qui parlent des bas fonds de Chicago. Ce livre, A Walk on the Wild Side, est frappant par la modernité de son écriture. Soin réalisme est poussé à un tel point qu'il utilise l'argot de ces personnages qu'il va chercher dans les recoins les plus obscurs de sa ville, et qu'il est certainement plus ébouriffé dans sa conception que Sur la route de Jack Kerouac. Cette fois, il n'est plus question de crise économique, mais à l'inverse, d'un moment de rare prospérité qui favorisait le rêve américain. Ces figures presque fantomatiques sont les laissez pour compte du Welfare. L'Amérique devient la première puissance mondiale, mais ces pauvres diables survivent dans des conditions épouvantables. Et Nelson Algren a su raconter leur destin avec crudité, mais aussi avec humour et ce monde qu'il a dépeint demeure inoubliable. Ce grand livre est animé par un souffle puissant, mais sans rhétorique, sans transformation de ces pauvres hères en héros d'un univers invisible aux yeux de qui a de quoi vivre décemment. Ils ne sont ni plus mauvais ni meilleurs que ces dernières, même peut-être plus étranges et plus « sauvages ». La puissance de ce livre est rare. Aucun romantisme, mais une humanité profonde ; pas de mythologies, mais une reconnaissance de ces individus perdus, avec des centaines d'histoires qui se chevauchent et s'enchevêtrent pour qu'on ait une vision complète de ces « souterrains ». Algren est vraiment un grand de la littérature américaine. Qu'on se le dise.

Les Evénements, Jean Rolin, Folio, 192 p., 6,50 euro.
L'auteur a imaginé la guerre civile en France. Une guerre de notre temps (c'est vrai que c'est un sujet qui fait jaser pour des raisons un peu incompréhensibles depuis un certain temps). Soit. Les autorités détiennent encore Paris et pourtant le gouvernement s'est replié dans l'île de Noirmoutier. Les insurgés se sont installés en plein coeur de l'Auvergne, à Clermont-Ferrand. Notre héros décide de quitter la capitale pour se rendre dans le Midi. Il est bloqué par les forces commandées par Brennecke qui l'accueille néanmoins avec aménité. On comprend qu'il a plusieurs factions en lutte, de toutes les tendances politiques et de toutes les religions. L'ONU a envoyé des contingents pour tenter de calmer le jeu. L'épopée du personnage assez peu définissable créé par l'auteur s'achève bien dans le Sud de la France et tout se termine par une mystérieuse rencontre dans un complexe pétrochimique. On peut tout imaginer. Ou rien. Car l'histoire ne tient pas debout et manque totalement de nerf. Je conseillerai au lecteur de laisser tomber ce bouquin et de lire Terminus radieux de Volodine s'il ne l'a pas déjà fait.

Le Palais de glace, Tarjei Vesaas, traduit du norvégien par Jean-Baptiste Cousaud, Babel, 224 p., 7,70 euro.
Les plus belles fulgurances d 'André Malraux, réunies par Sylvie Howlett, illustré par Loïc Sécheresse, Folio, 160 p., 7,70 euro.
C'est une bonne idée et il en résulte un livre à la fois instructif sur la pensée d'André Malraux et aussi follement amusant car on se rend compte à quel point l'auteur de l'Espoir pouvait dire des choses qui n'avait pas toujours un sens des plus limpides, puisqu'il se laissait parfois emporté par le goût immodéré des phrases grandiloquentes ! Des citations sont d'une banalité consternante (comme ce qu'il peut dire de la fraternité), d'autres sont éblouissantes, comme ses idées sur le « surmonde de l'art » et sur ses métamorphoses. Là, il se montre brillant et capable d'intuitions foudroyantes. En fin de compte, avec ce florilège on apprendra pas mal de choses sur l'écrivain et ministre, qui avait un sens curieux de la littérature, entre le journalisme et la rhétorique d'un Bossuet ou d'un Chateaubriand ! Il n'en ressort pas diminué ou ridicule, mais peut-être moins emphatique et boursouflé qu'on se l'imagine...

Trois fois dès l'aube, Alessandro Baricco, traduit de l'italien par Lise Caillat, Folio, 128 p., 5,90 euro.
Alessandro Baricco a commencé sa carrière avec un livre extraordinaire, Château de la colère, qui a reçu le prix Médicis étranger en 1995. Puis il s'est mis à faire des livres d'une autres nature, ses grandes qualités techniques et narratives lui permettant de faire des livres courts et qui en imposent au public. Soie a marqué ce tournant irréversible. Les trois petits récits essentiellement dialogués de Trois fois dès l'aube sont très habillement agencé. Tout y est hautement improbable, comme cette femme qui rentre très tard à son hôtel et rencontre dans le hall un homme qui prétend vendre des balances et qui réussit bien dans ses affaires. Cette femme dans la chambre de l'homme, qui n'est d'ailleurs pas sa chambre et leur dialogue est comme une sorte de relation imaginaire. Cette rencontre se reproduit encore fois, mais à une époque différente. Rien n'est développé étant donné la forme -, tout est suggéré. Oui, c'est très habile, bigrement bien fichu. Mais c'est là, hélas, une littérature de supermarché faite avec un art supérieur.
|
