
« Ambulante », storie di fotografia in giro per il mondo, Renato Corsini, textes de Gianni Berengo Gardin, Liliano Lucas, Massimo Minini, Fondazione Mudima, Associazione Museo della Fotografia italiana, Milan, 30 euro.
Ce catalogue de l'exposition présentée à la Fondation Mudima de Milan est de toute beauté - bien que la beauté ne soit pas son objectif. Il n'est pas commun de nos jours qu'un photographe puisse nous surprendre et nous émerveiller à ce point. Renato Corsini travaille selon des principes simples et même archaïques : il fait poser ses sujets le plus souvent devant une tenture (toujours la même) et son matériel est réduit à sa plus simple expression. Il ne profite pas des avantages techniques des nouvelles technologies. Son intention est de nous procurer l'impression d'avoir devant les yeux des clichés d'un autre temps, alors qu'ils sont contemporains. Il ne dissimule d'ailleurs pas les signes de la modernité. Il a voyagé au Bengladesh, au Laos et en Birmanie.
Le monde indien demeure celui qu'il a été depuis longtemps avec ces sadhûs - moines du jainisme qui vivent nus ou presque et circulent au milieu de leurs semblables sans suscité la moindre curiosité de la part des passant, appartenant à leur quotidien même s'ils ont décidé de vivre comme des « saints » de cette religion -, tous ces membres d'une famille qui posent pour lui sans mise en scène, avec tous ces agriculteurs et ces travailleurs, en somme avec toutes ces personnes simples qui trouvent grâce à son regard d'une incroyable acuité une sorte de dignité et de force alors qu'ils représentent le niveau plus bas de la société et même s'ils sont en général dépourvus de beauté et de grâce. Il ne fait rien pour masquer qui ils sont en réalité, mais il n'accentue pas leur pauvreté et leur physique souvent dépourvu de charme. Ainsi nous propose-t-il un théâtre réel qui est l'inverse du nôtre. La misère n'inspire ici aucune compassion et pas la moindre révolte. Ces portraits individuels ou de groupe sont dépouillés de tout jugement : ils montrent les personnes qui y figurent telles qu'en elles-mêmes et sans le plus mince préjugé.
C'est assez fascinant. Qui a parcouru le sous-continent indien a pu voir des milliers et des milliers d'hommes et de femmes pareils à ceux-ci. Il nous fait aussi aller au Laos et en Birmanie et s'est particulièrement attaché à montrer des vieilles femmes, qui parfois fument la pipe. Il n'a jamais recherché le pittoresque, même s'il l'a rencontré au détour de ses pérégrinations. Ce que nous retenons de ces photographies, c'est la puissance d'évocation qu'elles recèlent. L'être humain se change alors en être merveilleux alors qu'il appartient à ceux qu'on ne remarque pas. C'est une recherche plastique, cela va sans dire, mais c'est aussi une recherche de la curiosité et de la singularité de l'existence, qui échappe aux critères de la beauté et de l'harmonie. Ces mondes, quasi disparus dans nos esprits, se mettent à posséder une véritable puissance.
Dans ce fort volume, Corsini a aussi traité des thèmes plus proches de notre monde. A commencer par celui du cirque, où les acrobates et les écuyères, les couples mal assortis d'artistes et cette bizarre Madame Loyal composent un univers imaginaire qui serait tombé en décrépitude.
Sans avoir l'aspect monstrueux des personnages du film Freaks, ils ont tous quelque chose qui échappe à l'ordinaire et se rapproche d'une irréalité gênante et pourtant captivante. D'autres séries retiennent notre attention : les costumes du carnaval de Venise, les tatouages, les barbus exubérants, en somme autant de mondes qui font partie intégrante de notre monde et qu'il a tenu à mettre en exergue. Si vous n'avez pas pu voir cette exposition d'une rare qualité, procurez-vous ce catalogue cat il contient les créations magnifiques et inoubliables d'un photographe qui s'impose comme l'un des meilleurs de sa génération.

The Immediate Gaze, Aquarelle, polaroid : Maurizio Coppolecchia - aquarelles : Pietro Spica, collectif, 52 p.
La Mongolie, si lointaine, dans l'espace et dans le temps, demeure bien ancrée dans notre imaginaire. Les empires des steppes, puis l'immense empire mongol au XVIIIe siècle qui s'est emparé de la Chine et a menacé l'Europe avec la figure emblématique de Gengis Khan, ne cesse de hanter la mémoire de l'Occident. La réalité mongole d'aujourd'hui, celle que l'on peut découvrir sur les photographies réunies pour cette exposition, semble appartenir à un passé lointain, à mille lieues de ce que nous sommes devenus. Cette existence itinérante avec ses youtres et ses troupeaux, ce culte du cheval qui coexiste toujours avec l'usage des engins motorisés dans ces étendues infinies, ce style de vie qui ne subsiste que dans de rares régions du globe, tout cela fait des Mongols des fantômes de l'histoire universelle.
Cela, Maurizio Coppolecchia l'a bien compris et a su le restituer dans ses polaroïds, qui ne sacrifient jamais rien au pittoresque. Même s'il ne cherche pas à donner à ses modèles contemporains une allure antique, rien n'y fait : ils ne font pas partie de notre modernité. Ils ont une beauté qui est révolue et qu'ils ont su transporter jusqu'à maintenant. Ils sont demeurés égaux à eux-mêmes, et n'ont rien renier de leurs traditions et de leur manière d'être en ce monde. Pourtant tout a changé autour d'eux, même dans leur capitale et leurs dirigeants se sont évertués à les arracher à la vie nomade qui est pourtant leur essence. On est encore stupéfait qu'un art de vivre si rude et si fruste a pu avoir donné naissance à une civilisation si puissante et si riche. Ces clichés sont fascinants car ils ne font qu'immortaliser ce qui constitue le socle de leur quotidienneté. Il n'y a rien de spectaculaire ou de mythique dans ces prises de vue et pourtant, on discerne en palimpseste leurs ancêtre qui ont dominé une grande partie du monde. Les petits tableaux à l'aquarelle de Pietro Spica, quant à eux, donnent une traduction à la fois naïve et un peu naïve de ces habitants du désert de Gobi, ce qui est un mode paradoxal de les sacraliser et de les désacraliser. Il les inscrit souvent dans une composition où la fantaisie est primordiale. Et pourtant, il ne fait rien pour s'éloigner de leur physionomie et de leurs vêtements traditionnels tels qu'ils les portent aujourd'hui.
Il ne les écarte pas de leur histoire prestigieuse et presque fantasmagorique. L'alliance de ces deux façons de les représenter tels qu'en eux-mêmes, mais aussi comme autant de figures ayant eu un lignage avec ces farouches conquérants qui se sont révélés tout autres que des barbares cruels et sanguinaires. Ils ont été les véhicules d'une métamorphose de la culture de l'Asie centrale à la Chine et à l'Europe. Cette expérience menée par deux artistes démontre une curieuse connivence malgré des techniques très diverses. Même leur état d'esprit assez libre et distinct finit par se rejoindre. Le décalage entre le premier et le second permet d'engendrer un décalage sensible qui ne fait que renforcer leur complicité dans leur traduction plastique de ce que ce peuple leur a inspiré. Comme quoi il est encore possible de trouver dans ce peuple du désert l'empreinte indélébile d'une incroyable faculté de changer le cours des choses et d'avancer dans la connaissance. « The Immediate Gaze » est une réussite sur le plan plastique, mais aussi dans l'ordre de l'interprétation de ce qui est et qui demeure le reflet de ce qui a été.

Mon corps est un texte impossible, Edith Azam, Atelier de l'agneau, 106 p., 18 euro.
L'auteur de ce recueil a donné à son titre une valeur programmatique. En effet, tous les textes rassemblés dans ce volume ont trait à la question du corps, comme si l'écriture et la corporalité ne constituaient qu'une seule et même entité. Edith Azam a puisé toutes les ressources de la poésie expérimentale depuis l'Album zutique où a collaboré Arthur Rimbaud, jusqu'à nos jours, en passant par le futurisme, Dada, la poésie visuelle et la poésie concrète. Elle n'a ailleurs pas voulu de toute évidence choisir une stratégie spécifique, mais a plutôt souhaité tirer profit de différentes méthodes, sans jamais s'engager dans une voie bien précise. Chaque technique employée lui permet d'exprimer un rapport de son corps avec le monde ou avec elle-même. L'extrême fantaisie de la mise en page est une sorte de ponctuation mentale, qui n'est pas à proprement parler poétique : c'est comme une partition imaginaire pour divulguer une pensée ou une autre.
Au fond, elle n'a pas souhaité faire montre d'une profonde dextérité en matière de poésie, mais plutôt de faire vivre ses considérations comme autant de réclames avec leur mise en page et leurs caractères d'imprimerie spécifiques. Tout se traduit dans ce recueil sous une forme ludique et aussi plastique : nous sommes à mi-chemin entre le tableau et le panonceau. C'est ce qui rend son aventure à la fois prégnante et fantasque et, plus que tout, ludique. Ludique ne signifie pas ici purement divertissant : des idées fortes sont véhiculées par ces caractères en capitale disposés dans la page pour rendre les choses plus attrayantes sans pourtant éliminer le sens - au contraire, cela le renforce. La diversité très large de ses propositions formelles et de ses compositions fait que le livre peut être considéré comme une sorte de partition de lettres et de mots, de liens entre les uns et les autres qui font apparaître des configurations de réflexions qui donne à la corporéité une résonance puissante. Donc il convient laisser de côté l'acrobatie poétique moderne, ses modalités complexes et sa radicalité parfois forcée, et oublier quelque rapport avec les calligrammes de Guillaume Apollinaire : nous sommes ici dans la mise en scène où l'écriture demeure le lien tendu et brûlant entre ce qui fait de nous des êtres de chair et de sang et des êtres pensants - qui pensent d'abord ce qui fait d'être à la fois des anges et des bêtes.

Le Goût de la France, Antoine Gavory, « Le Petit Mercure », Mercure de France, 128 p., 8, 50 euro.
La question, si vaste, si complexe, n'est pas des plus simples à traiter ! Antoine Gavory s'est est bien sorti car il a su éviter et les clichés et les banalités. Sa première partie est même assez originale car il a choisi de prendre pour la construire des dames de lettres étrangères, comme Edith Warthon, dont le livre intitulé Des moeurs françaises et comment les comprendre a eu un certain écho dans son pays quand elle l'a publié, mais aussi des auteurs plutôt surprenants comme Mark Twain, qui n'est pas franchement un très fervent amateur du
Grand Tour dans la perspective de Goethe. Rivarol voisine avec Kiki de Montparnasse : on se rend vite compte que l'auteur de cette petite anthologie ne s'est pas mis en tête d'élaborer un système ou une quelconque classification. Il a même recherché le contraire : des visions contrastantes. Ne vous échinez pas à vouloir trouver dans ces pages un tableau plus ou moins homogène de la France, mais plutôt différentes façons de l'aborder au fil du temps. Et aussi de comprendre ses principaux composants : a langue (Rivarol), le peuple (George Sand) sa gastronomie (Grimod de la Reynière), sa mode (Montesquieu), la littérature qui s'y rattache (Marcel Rouet) ...
Ainsi, Antoine Gavory est parvenu à donner une idée de ce qui forme ses principales distinctions. Il passe ensuite à la question du terroir met en relief les mille aspects de ce qui constitue sa spécificité rurale, ce que représente la terre pour les paysans selon Jules Michelet et ce qu'est la sensibilité française selon Colette qui n'a jamais perdu son accent bourguignon. Il est allé chercher le secours de Marcel Pagnol et aussi, ce qui est plus surprenant, celui de Jim Harisson pour évoquer Saint-Malo. Il est aussi aller chercher une chanson de Frédéric Mistral et un écrit de Jean Giono pour traiter du « bon sens paysan » - ces deux derniers textes ayant une tonalité un peu maréchaliste !
Bien sûr, il est tombé dans quelques-uns des pièges difficiles à éviter dans ce type d'exercice, comme, par exemple, la naissance du drapeau français raconté par Raphaël Delpard. Cette dernière partie est sans doute la moins réussie, même si on y retrouve Alphonse Allais et Théophile Gautier. Mais la France est un curieux mélange de valeurs contraires et de paradoxaux moments historiques - de Clovis à Charles De Gaulle (ici présent) en passant par Jeanne d'Arc et Louis XIV... Le résultat réserve néanmoins de bonnes surprises et se révèle un bon moyen pour comprendre notre pays même si tout n'est pas parfaitement restitué.
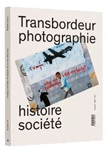
Transbordeur photographie, histoire société, n° 6, « L'image verticale », dirigée par Marie Sandoz & Anne-Katrin Weber, 204 p., 29 euro.
Ce numéro conçu par Marie Sandoz et Anne-Katrin Weber s'avère être une véritable histoire de la photographie aérienne écrite à plusieurs mains. Le premier article, de la main d'Adrien Zakar, après la préface des auteurs de ce numéro, qui évoquent la photographie aérienne de 1918 à 1940 dans les colonies françaises, qui concerne la cartographie en Syrie pendant cette même période.
Lars Nowak nous parle ensuite de la télédétection militaire pendant la dernière guerre. Les sujets les plus divers, du repérage des objectifs pendant la guerre du Vietnam jusqu'à l'exploration visuelle de la planète Mars permettent de comprendre par l'exemple quelles sont les multiples applications de la photographie « verticale ». Suit une histoire détaillée des appareils photographiques effectuant des vues aériennes. Christoph Borbak nous fait découvrir les salles d'opération de la défense antiaérienne durant la Seconde guerre mondiale. Une étude nous dévoile de quelle façon Daguerre photographiait les fossiles et les coquillages en 1839. Puis nous passons à l'évocation des photographies de classe d'autrefois - un sujet des plus nostalgiques !
Claire Ducresson-Boët nous révèle ce qu'est la monumentalisation des photographies de la guerre de Corée et ce qu'elle peut signifier à nos yeux. Un curieux mais pertinent essai nous parle de la question des chefs-d'oeuvre à partir d'une exposition au Jeu de Paume. Le volume s'achève par une série de lectures savantes. En somme, le spécialiste sera enchanté par l'incroyable masse d'informations et par les richesses thématiques et iconographiques renfermées ici, mais le néophite, comme moi, fera lui aussi des trouvailles passionnantes et aura la faculté de se faire une solide culture en la matière, même si certains articles sont relativement techniques. Je ne saurais trop recommander ce numéro de Transbordeur photographie histoire société à tous et à toutes.

Le Goût de la poésie française, Francis Médiani, « Le Petit Mercure », Mercure de France, 208 p., 10 euro.
Cet ouvrage est assez différent de l'esprit de cette collection. En effet, d'ordinaire, c'est un lieu particulier, un pays, ou encore un sujet qui est traité à travers une série de textes d'auteurs anciens ou modernes. Cette fois-ci, l'auteur a réalisé une anthologie dans le sens le plus classique, avec une courte présentation de l'auteur. Si elle n'est pas d'une originalité exceptionnelle, elle est des plus soignées. La partie moderne contient des poèmes d'Arthur Rimbaud, de Louis Aragon (Les Yeux d'Elsa), de Jacques Prévert, Edmond Jabés, René Char, Henri Michaux, André Breton, Pierre Reverdy, Ghérasim Luca et cette longue liste d'auteurs célèbres se termine curieusement avec Claude Pélieu...). Quant à la section contemporaine, elle débute assez malencontreusement par Yves Bonnefoy, qui plaît tellement au monde universitaire : il a été l'homme-lige de la poésie académique.
La suite est constituée de hauts et de bas. Contentons-nous du plus intéressant : Zeno Bianu, Jacques Roubaud, Bernard Noël, Frank Venaille, Philippe Jaccottet, en passant par Jean-Pierre Verheggen et Mathieu Bénézet. La poésie expérimentale (Bernard Heidsieck, Henri Chopin, Jean-François Bory, Julien Blaine, etc.) est totalement exclue. Et il y a pas mal d'auteurs d'un intérêt très modeste. En conclusion, ce volume n'est pas à la hauteur des ambitions de cette belle collection. Sans doute cela pourrait être l'occasion d'un cadeau pour des adolescents afin qu'ils commencent à approfondir leurs connaissances de notre littérature en dehors des ornières scolaires. Ce serait déjà quelque chose de plutôt positif.
|
