
Une avant-garde polonaise : Katarzyna Kobro, Wladyslaw Strzeminski, Centre Pompidou, 200 p., 35 euros
Voilà une exposition comme on aimerait en voir plus souvent au Centre Pompidou. Pour la plupart d'entre nous, c'est une complète découverte. Nous connaissons encore assez mal les avant-gardes historiques des pays de l'Europe centrale et de l'Europe orientale. Cette fois, les commissaires ont soulevé un voile sur une partie de ce qui s'est déroulé en Pologne entre les deux guerres en présentant ces deux figures majeures de l'art abstrait. Ce qui frappe à première vue, c'est que leurs recherches ne sont pas très proches du suprématisme ou du constructivisme russes, encore plus qu'on a pu voir fleurir en Hongrie ou en Tchécoslovaquie et encore plus loin de ce qui se passe en France.. D'après ce qu'on comprend en visitant l'exposition, ces deux artistes auraient eu plus d'affinités avec le néoplasticisme néerlandais. Mais cela ne se traduit pas dans l'organisation formelle de leurs compositions. Bien sûr, il y a des récurrences théoriques qui viennent d'un peu tous les horizons, en particulier la volonté très marquée de mettre en avant le collectif sur l'individuel (sans toutefois le sacrifier totalement) et aussi le désir de penser des oeuvres pouvant s'inscrire dans une cité de caractère plutôt utopique. Leurs propositions formelles sont originales, mais leurs bases spéculatives rejoignent les théoriciens soviétiques et leurs homologues dans d'autres points de l'Europe. Ce qui veut dire que les artiste polonais ne pensaient pas et ne créaient pas dans une sorte de bulle spécifiquement polonaise, d'autant plus que Kobro est elle originaire de Russie. Je commencerai par parler de Wladyslaw Stzreminski (1893 à Minsk- 1952) qui a été l'un le fondateur et le théoricien de l'Unisme. Il a d'abord poursuivi une forme d'art qui excluait toute forme d'iconographie, mais aussi toute forme de sentiment extérieur à la pure picturalité -, ou mieux à la pure plasticité. Il a exécuté des toiles singulières, qui reposaient sur des agencements de formes eux-mêmes liés à une seule couleur placées sur un fond uni. Ce travail a été développé être 1923 et 1929. Par la suite, il a choisi la stricte monochromie, mais sur des toiles présentant des reliefs réguliers, comme une trame fine ; cela donne à ses compositions une étrange vibration et une matérialité toujours plus ludique et plus accentuée : la plus grande rigueur s'accompagne ici d'une tendance ludique, comme on peut le voir dans Composition uniste 12 de 1932.Le peintre va aussi se révéler un merveilleux graphiste et il réalise des couvertures et des mise en pages d'ouvrages qui restent mémorables. Il a aussi travaillé dans le volume et dans ce cas, il se rapproche de Van Doesburg, de Vantongerloo et des architectes liés à la revue De Stijl. Il utilise des plans monochromes où dominent le rouge, le jaune, le bleu et le noir. Ensuite, il est passé à des éléments biomorphiques avec l'introduction d'éléments non géométriques, qu'il a tendance, au fil des années, à épurer et à porter vers une abstraction où il n'emploie que peu de coloris. Après la guerre, il développe des compostions plus complexes et plus colorées en introduisant parfois des formes réalistes. Il faut enfin souligner le livre bouleversant de dessins et de photomontages qu'il a intitulé A mes amis les Juifs (1945). Quant à elle, Katarzyna Kobro (1893-1958) , elle s'intéresse plus à la sculpture, et imagine des oeuvres abstraits faites de l'assemblages de différents matériaux et aussi de différentes formes ; elle valorise d'abord les courbes, qui rompent la dure structure des droites. Elle pense ses oeuvres dans l'espace, et cet espace est habité ; ses sculptures ne sont donc pas isolées, comme pour les statues commémoratives, mais appartiennent à un ensemble urbain nouveau. Elle n'utilise que peu de couleurs, comme l'ont fait les néoplasticiens des Pays-Bas. Sa grande originalité réside dans le dessin sinueux de ses travaux, dans son amour des courbes et des lignes sinusoïdales. On peut la situer entre Tatline et Moholy Nagy, sans jamais pouvoir l'identifier pleinement à leurs recherches. Tour ce qu'on découvre dans les salles est passionnant et permet d'élargir le champ de notre connaissance encore lacunaire des avant-gardes des années vingt et trente.
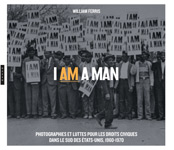
I Am a Man, William Ferris, Hazan, 144 p., 24, 95 euros
Cet album est remarquable. Il nous raconte l'histoire de la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis depuis les années soixante. C'est d'ailleurs d'une certaine façon l'autobiographie de l'auteur, originaire du Mississsippi et fervent militant pour l'émancipation des Noirs. Il a choisi de raconter cette histoire douloureuse par l'image, plus que par le texte, qui sert simplement situer les événements évoqués par l'image. Il est difficile aujourd'hui de s'imaginer, après la présidence de Barak Obama, qu'il y avait encore pendant les années soixante des salles d'attente, des places dans l'autobus ou dans le train, réservées aux Noirs. Pourtant, la longue et sanglante Guerre de Sécession avait été justifiée par l'abolition de l'esclavage -, ce qui a été fait de manière formelle. Mais les Noirs faisaient toujours l'objet d'une discrimination, même dans les Etats du Nord. Ce livre retrace toutes les étapes d'une lutte qui a été très dure et violente. On y voit le premier étudiant de couleur admis dans une université, George Meredith, les multiples manifestations, la grande marche sur Washington, l'assassinat de Martin Luther King en 1968, la répression terrible par les forces de l'ordre, et puis les démonstrations de force spectaculaire du Ku Klux Klan, les lynchages publics et impunis. En somme, même si j'ai été surpris de ne pas voir de documents concernant le Black Panther Party, pourtant créé en 1966 en Californie, qui a été suivi par la création de la Black Liberation Army ce livre permet de comprendre l'évolution de cette lutte qui a abouti des lois égalitaires et aussi un changement radical de situation, même si le racisme n'a pas disparu, loin s'en faut, aux Etats-Unis. Les images sont frappantes et résument parfaitement ces cinquante années de combats, d'émeutes, de violences policières. C'est un vrai livre d'histoire mais en images, et ces images sont très éloquentes.

Les Trente-six vue du Monr Fuji, Hokusai, Hazan, 186 p., 29, 95 euros
Ce livre d'estampes polychromes est considéré comme le chef-d'oeuvre de Katsishika Hokusai (1760 ? - 1849), l'un des plus grands maîtres de la xylographie ayant vécu entre l'ère Hôrekei et l'ère Kaei. Il n'a pu graver ces planches qu'à la fin de sa vie (sans doute entre 1831 et 1833) ; le Gakôjin (« fou de dessin », l'un de ses multiples pseudonymes) en a ajouté dix antres à la demande de son éditeur. Parmi elles se trouve La Grande vague de Kanagawa. A partir de 1834, il réalise les Cent vues du Mont Fuji. Cela devrait suggéré que le sujet et que sa mise en scène a eu du succès à l'époque ; il est vrai que le mont Fuji est un lieu de pèlerinage important, et que les paysages que découvrent les pèlerins sont très beaux, mais aussi enveloppés d'une certaine sacralité. Il faut indiqué, pour comprendre la particularité de ces oeuvrées, qu'Hokusai connaissait l'art occidental et qu'il a su en tirer certaines leçons, sans pour autant renier la tradition esthétique dans laquelle il se plaçait. Par exemple, il a utilisé le bleu de Prusse, introduit depuis peu au Japon (vers 1829). C'est alors qu'il a pris le surnom d'Iisu, pour souligner son changement de style. Il commence à s'éloigner de la forme de l'ukiyo-e que ses maîtres avaient imposée. Cet ouvrage a donc plusieurs clefs qui montre d'abord qu'il n'imite plus ses précurseurs (chose qui n'était pas du tout méprise, tout au contraire) et qu'il s'oriente vars la fondation de sa propre manière de dessiner et de peindre. Il a aussi la manière de représenter la montagne : il l'a montre à partir de différents points de vues significatifs, de la mer ou de la plaine, mais aussi d'une manufacture à Honjo ou d'une rue d'Edo (Tokyo). C'est là une façon de considérer le sujet de manière tout à fait originale en son temps. Et puis il y a ce mélange de réalisme et d'abstraction des formes, qui n'est pas nouvelles dans cet art, mais qu'il pousse à un degré encore inconnu. C'est une pure merveille.

Les Saisons par les grands maîtres de l'estampe japonaise, Amélie Balcou, 226 p., 19,95 euros
Dans ce superbe album où ont été réunis les plus grands artistes japonais de la fin du XVIIIe siècle et début du XIXe ont traité chacune des quatre saisons. Bien sûr, on y trouve les magnifiques vues d'Hokusai, mais aussi d'Utagawa Hiroshige, de Kitagawa Utamaro, d'Utagawa Kunisada, de Keisei Eisen, pour citer les principaux artistes de cette période féconde (le premier étant bien plus représenté que ses contemporains). C'est un éblouissement permanent, car ces créateurs ont su restituer, avec des ressources souvent bien différentes l'essence des quatre saisons. Ils ont pu procéder en plaçant une fleur ou un arbre au tout premier plan, ou, à l'inverse, en embrassant un large champ, comme l'a fait Hiroshige dans Averse soudaine sur le pont Shin-Ohaki à Atake (1837). Parfois les lieux pullulent de figures, parfois il n'y en a aucune. S'il existe beaucoup de similitude de caractère entre toutes ces planches, on se rend vite compte qu'elles diffèrent autant dans leur style que dans leur mode de composition, ou même dans le choix des harmonies et des contrastes chromatiques. Il n'y a eu aucune volonté d'ordre historique dans le choix de ces oeuvres, mais plutôt de désir de faire connaître quelques unes des pièces les plus significatives dans ce registre. On peut comprendre pourquoi les peintres européens ont pu se passionner à partir de l'impressionnisme pour ce qu'on a dénommé le japonisme. L'audace de la mise en place de leurs sujets était une invitation à employer des formules assez comparables, ce qui a pu se faire des années 186o au début de XXe siècle. Mais personne en Occident n'a pu les égaler dans le domaine de la xylographie en dix couleurs. Leur art exigeait un apprentissage très long et une maîtrise sans faille, qui allait jusqu'aux confins du possible ! Ces Saisons peuvent constituer un charmant cadeau pour les fêtes ou alors une initiation délicieuse à la période Meiji, qui a vu la réalisation la plus sophistiquée des techniques de la gravure et l'émergence d'artistes incomparables.

Cinéma absolu, avant-garde 1920-1930, Patrick de Haas, Mettray éditions, 812 p., 35 euros
L'auteur s'explique dans sa préface de la période qu'il a choisie de traiter, même si des expériences cinématographiques avaientt été faites auparavant. Le sujet est déjà considérable (plus qu'on ne le croit) et peut largement satisfaire la curiosité de ceux qui s'intéresse à cette relation complexe et intense entre les arts plastiques et le septième art. Le problème en effet est qu'il n'y a pas eu que les petits films réalisés par des créateurs comme, par exemple Le Ballet mécanique de Fernand Léger. Il y a eu aussi de nombreuses collaborations entre cinéastes et artistes, ces derniers réalisant des décors, comme par exemple L'Inhumaine de Marcel l'herbier (1924) avec des décors de Léger, pour parler du même peintre. Et puis il y a aussi les musiciens, comme, dans ce cas, Darius Milhaud. Un peu partout en Europe, les créateurs les plus audacieux voient dans le cinéma un art jeune et plein de promesses. Beaucoup d'artistes sont d'ores et déjà convaincus de l'utilité de l'industrialisation et ils font en faire usage en utilisant la photographie et le cinéma. Les futuristes sont les plus élogieux pour l'âge de la machine et cela se traduit dans leurs oeuvres ; en revanche, ils n'ont fait que très peu de films. Le culte du moderne s'est traduit de bien des façons différentes et les constructivistes l'ont envisagé autrement que les surréalistes, c'est évident. Mais tous, souligne l'auteur ont eu recours à cet art en mouvement. Cette sacrosainte modernité implique des techniques nouvelles et aussi une perception nouvelle du monde. La mécanisation permet à l'art un essor (théorique) considérable. Des débats sans fin sont apparus pour savoir si l'art allait servir ses propres desseins ou servir une cause (par exemple, la révolution prolétarienne). En fin de compte, les anciens dilemmes entre réalisme et autres formes de peinture ou de sculpture se proposent à nouveau sous d'autres aspects. L'auteur doit donner un nombre considérable d'indications sur ce point au début du livre car on doit comprendre les buts recherchés et les fondements théoriques avant même d'aborder la question spécifique du cinéma dans l'art. Une fois franchi ce cap, on put entrer dans le vif du sujet et là, nous découvrons toutes des expériences cinématographiques menées par des artistes de Viking Eggeling & Hans Richter au rigoureux Lazlo Moholy-Nagyen passant par Entr'acte de René Clair et Francis Picabia, pour arriver au Chien andalou de Luis Bunel et Salvador Dalì. Cinéma absolu n'est pas seulement une vaste encyclopédie concernant ce sujet, mais aussi un instrument très utile et très bien fait pour comprendre les motivations des artistes quand ils abordent ce domaine. En ce qui me concerne, j'aurais eu une autre approche : je crois que le cinéma a eu une dimension artistique presque depuis le début, après avoir passé le temps des documentaires des frères Lumières. A mes yeux Méliès est un artiste. Philippe Soupault comme les poétistes tchèques ont vue ne Charlie Chaplin un immense artistes ; certains films, sont des oeuvres d'art à l'époque du cinéma muet, du Cabinet du docteur Caligari au Golem, en passant par L'Atalante (parmi tant d'autres ouvrages merveilleux). L'industrie cinématographique a peu à peu fait disparaître ces velléités. Mais elles existent et sont même assez nombreuses ; Le Bonaparte d'Abel Gance en est la manifestation. En somme, ce livre est remarquable et aucun amateur d'art et aucun cinéphile digne de ce nom ne pourra s'en passer. Mais il pose le problème des cinéastes qui n'ont pas eu nécessairement des rapports avec les artistes plasticiens.

Le Temps de l'art, anthropologie de la création des Modernes, Michel Guérin, Actes Sud, 448 p., 25 euros
Le terme d' « anthropologie » appliqué à l'art n'est pas sans me poser de sérieux problèmes. Mes collègues de l'Accademia di Belle Arti de Brera à Milan enseignaient surtout cette matière et je n'ai jamais compris quel était leur champ d'investigation ! Et je ressens ici le même malaise : de quoi parle l'auteur, au début, il digresse sur la question du temps et cite abondamment Marcel Proust ; puis il en vient à André Malraux, où l'art est à la fois religieux et intemporel -, Religieux, au sens propre, il l'a été longtemps, des civilisation antiques jusqu'à une date récente, même si le monde profane est devenu de plus en plus prégnant. Mais Malraux a changé le sens de religieux : pour lui, l'art est religieux par essence, même s'il ne se réfère pas à une quelconque religion. Le musée n'est pas pour lui un dépôt d'oeuvres anciennes, mais un temple. En fait, l'erreur de l'auteur est d'affronter tout de go des problématiques aussi vastes que complexes. Il fait d'ailleurs des remarques sur le dessin à la fin de la Renaissance et sur la finestra d'Alberi qui ne s'ouvre pas sur le réel mais sur l'istoria (l'imaginaire pour parler vite). La querelle souvent évoqué entre les académiciens (type Bouguereau) et les artistes modernistes d'alors (type Manet) n'est pas un combat entre l'imitation et l'invention : les académiciens transfiguraient eux aussi le réel et l'idéalisaient plus ou moins. Dont acte ! Il comprend fort bien que le sens de l'art est le noeud de l'affaire. Il se trompe en revanche en prenant pour mètre la pensée de Malraux, qui a discerné une fin de l'art possible. J'éviterais de discuter la seconde grande partie qui est celle qui concerne la postmodernité ; ce terme qui a apparu à la fin des années 1970. On a tellement abusé de ce terme dans des contextes tellement divers qu'on ne sait même plus à quoi il correspond ; en architecture, il a voulu exprimer le désir d'aucuns d'échapper à la « tradition du moderne» ; soit ; mais après cela est devenu un concept fourre-tout. Après quoi l'auteur s'interroge sur la création ; là encore, cela pourrait faire l'objet d'un livre autonome (et énorme !). Et il est suivi d'une réflexion sur l'absence de la beauté. Là, je jette l'éponge. Il y convoque Kant (qu'il résume assez bien, en oubliant la notion de « formidable «, puis Hegel (il analyse pas mal les principes de son esthétique, mais en oublie plusieurs aspects) et puis encore Schopenhauer. Si Michel Guérin énonce de-ci et de-là des notions justes et bien pensées, tout cela est noyé dans un discours dont on ne parvient jamais à attraper le fil rouge du tout. Voici donc ce que je recommande : lisez ce livre si bon vous chante, mais faites-le en picorant ce qui peut vous être utile en oubliant le dessein de l'auteur (on trouve néanmoins des pépites qui sont fort utiles). Je me méfie des personnes qui entreprennent de parler de l'art du « Quattrocento à nos jours », et je crains d'avoir raison ; chaque époque a eu ses débats spéculatifs et ce sont eux que l'on doit examinés. Et surtout ne pas aller se perdre dans notre époque où l'art est devenu une entité insaisissable en dehors de sa valeur monétaire.
Bram Van Velde, lithographie, musée de l'hospice, Issoudun, 112 p., 19 euros
Le musée de l'Hospice à Issoudun n'est pas l'un de ces grands musées de province qui peuvent se permettre de réaliser de grandes et coûteuses expositions temporaires ; mais il parvient tout de même à faire des expositions de qualités (je me souviens de celle de Josef Sima et d'Antonio Segui, entre autres). Pour cette fin d'année, son conservateur a choisi de présenter l'ensemble de ses lithographies présentes dans la collection de cette institution, dont la plupart ont été édités par les éditions Jacques Putman (on peut aussi y découvrir celle qui ont été faites pour le magasin Prisunic, réalisées en 1973 à l'initiative d'Andrée Putman). L'histoire de ces oeuvres remonte avant la guerre : on peut voir reproduite dans le catalogue un tirage de 1939, qui préfigure ce qui va suive après la guerre. Abstrait, Bram Van Velde se distingue de la plupart des artistes de l'Ecole de paris par l'architecture de ses compostions, qui, bien qu'elles aient changé de pièce en pièce, demeurent sa manière de concevoir l'espace. Il aimait la couleur et la plupart de ses créations allaient de quatre à sept teintes. Curieusement, il a réalisé de temps à autre des lithographies en noir, blanc et gris, comme s'il avait désiré marquer une pause dans sa recherche chromatique. Mais ce qui frappe le plus dans sa démarche c'est sa façon de jouer sur un registre formel très étroit refermé sur lui-même, et, aussi, de concevoir ses estampes comme des tableaux (il a d'ailleurs expliqué que c'était là un moyen de sortir de la solitude impérieuse du tableau). Cet ensemble, très riche, est tout à fait intéressant car on peut y découvrir l'essentiel de son parcours, qui a su intéresser Samuel Beckett, qui a su écrire de belles pages sur lui. Il y a chez lui une sorte d'enfermement qui s'est traduit par ces oeuvres qui sont comme des signatures chaque identiques et pourtant chaque fois différentes, comme une sorte de labyrinthe hiéroglyphique où il dissimulait ses pensées les plus secrètes. Ces pensées étaient mises à nu, tout en dissimulant leur réalité. Il nous communiquait les sentiments et les élans qui les accompagnaient. Dans ce catalogue on peut contempler la très étrange déambulation mentale d'un artiste qui vivait caché et qui en même temps disait tout de lui, dans un langage qui ne pouvait pas laisser prise à l'interprétation, à l'envahissement de son univers privé ou à la conjoncture. Il se voulait impénétrable et malgré ouvert décidé à s'ouvrir aux autres par la seule voie de l'expression plastique. Un paradoxe ? Non, une vraie ambition de dire sans mot dire.

Jean Fournier, un galeriste amoureux de la couleur, Catherine Francblin, Hermann, 148 p., 23 euros
Même si sa vocation de galeriste a vu le jour bien avant (en 1954 précisément), Jean fournier a été l'un des marchands d'art parisiens les plus influents des années 1970 et 1980. Catherine Francblin nous raconte son histoire. Il a commencé comme vendeur dans la célèbre librairie Calignani, où il a travaillé jusqu'en 1952. Il y a révélé des dons de vendeur, mais y a aussi pu développer une grande culture littéraire et artistique. Il est remarqué par un homme, Achille Weber, il a alors travaillé dans sa galerie, devenant peu à peu son homme de confiance. Weber meurt en 1974 et le jeune homme se retrouve à la tête de la galerie Kléber. Le premier artiste qu'il y a présenté est le peintre d'origine tchèque Josef Sima, par nature inclassable, qui travaillait dans une optique asse proche du surréalisme, mais tout e même en marge du mouvement. Jean Fournier s'intéressa assez vite aux nouveaux peintres américains, et il choisit dans un premier temps Judith Reigl. Il s'intéressa de près à des artistes proches d'André Breton à l'époque, Simon Hantai et Jean Degottex, qui a eu sa première exposition personnelle en 1956. D'Outre-Atlantique, il a jeté son dévolu sur Joan Mitchell, Sam Francis, James Bishop et du coté français, Claude Viallat, Pierre Buraglio, Loubchansky. En 1964, il a déménagé rue du Bac, où il est resté jusqu'en 1978 ; c'est la grande période de son affirmation. Il a constitué une « écurie », qu'il continua à étoffer. Mais son heure de gloire arriva quand il se déplaça rue Quincampoix, non loin du Centre Pompidou. La prédilection très marquée qu'il avait pour Hantai a suscité pas mal de dissensions et Jean Degottex a fini par le quitter en 1979 ; en ne cessant jamais d'alterner les expositions d'artistes américains réputés et d'artistes français, il a contribué à établir un équilibre entre les deux pôles supposés de l'art contemporain de cette époque, New York et Paris. J'ai bien connu Jean Fournier et c'était un homme avec qui il était vraiment agréable de bavarder : il avait une vaste culture, une grande curiosité et une profonde bienveillance, sans oublier une pointe d'humour. Catherine Francblin lui rend hommage, sans pour autant forger une image mythologique ; elle relate avec justesse et discernement le parcours d'un homme qui a été plus qu'un grand marchand d'art ; C'est un livre incontournable pour comprendre le monde l'art parisien de la fin du siècle dernier.

Orsay par Julian Schnabel, Donatien Grau, Louise Kugelberg, Flammarion / musée d'Orsay, 96 p., 25 euros
C'est entré dans les moeurs et presque une obligation : tout musée d'art ancien français doit organiser une exposition d'art contemporain dans ses salles. Aucune institution n'y échappe. Le musée d'Orsay est coutumier du fait. On y a montré des confrontations entre art du XIXe siècle et art actuel, avec des résultats assez en défaveur du dernier. L'art contemporain, dans sa grande majorité, ne parvient pas à se mesurer à ses épisodes passés. En ce qui concerne Schnabel (né en 1951), il a eu sa première exposition dans un musée en 1976 et a exposition à la galerie Mary Boone à New York en 1979 ; il a obtenu un énorme succès deux ans plus tard avec l'exposition présentée simultanément dans cette même galerie et à la galerie Leo Castelli (j'étais présent au vernissage et je peux en témoigner). Mais si le jeune atriste a séduit à ses début, mais il a fallu vite déchanter. Son exposition au centre Pompidou en 1987 a été une profonde déception ; le turbulent iconoclaste de la peinture avait déjà transformé son oeuvre en une série de poncifs où il se parodiait lui-même. L'élan créateur s'était tari. Il s'est employé ensuite à faire du cinéma en commençant en 1996 par un film sur Jean ...Michel Basquiat. Plus récemment, il a tourné un autre film sur les derniers mois de la vie de Vincent Van Gogh. En ce qui concerne ce qui nous intéresse aujourd'hui, sa présence à Orsay, il n'a rien fait de particulier. Il y montre des tableaux qui n'ont pas grand chose à faire avec les ouvrages renfermés par cette institution, comme Exile (1980), où il a utilisé une figure du Caravage, le seul qui pourrait avoir un quelconque rapport Portrait of Tatania Lisovskaia as the Duquesa de Alba (2014) où la relation avec Francisco Goya est manifeste. Tina in a Matador Hat (1987) est mis en regard d'un tableau de Van Gogh. Pourquoi ? On ne le saura jamais. On ne peut pas tout reprocher à l'artiste. Ici la faute est à imputer aux conservateurs, qui joue ce petit jeu stérile depuis longtemps dans l'espoir d'attirer un certain public (lequel ? On ne le sait pas). Mais regardez avec soin ce catalogue : il vous en apprendra beaucoup sur la culture actuelle qui semble une sorte de radeau de la Méduse !

100 courts chefs-d'oeuvre, Montal & Napias, « La Petite Vermillon », La Table Ronde, 224 p., 9,60 euros
Les deux auteurs de ce livre peu commun nous propose la lecture de cent ouvrages ; pour ce faire, ils ne nous racontent pas la trame de l'histoire, mais apportent des éléments essentiels pour nous pousser à nous plonger dans tel roman ou tel nouvelle. Et il faut admettre que 'est fait avec énormément de finesse et d'intelligence car il est vrai qu'on est intrigué par les arguments avancés et par la manière de présenter les choses avec concision, habilité et subtilité. Il y a beaucoup d'ouvrages classiques, c'est évident, mais pas seulement : la littérature contemporaine y aussi sa place. Les choix sont judicieux et font preuve d'une grande culture. Ils sont parfois originaux et inattendus. En fait je n'ai relevé qu'une seule petite maladresse : le choix du texte de Franz Kafka (La Métamorphose - j'aurais pris, par exemple, Un médecin de campagne). En effet, j'aurais conseillé aux lecteurs une oeuvre qui ne soit pas étudiée au lycée depuis des lustres. Pour le reste, tout peut bien entendu se discuter, mais je crois qu'il est nécessaire de reconnaître que cette invitation au voyage littéraire est d'une excellente facture et qu'elle se révélera très utile pour ceux qui n'appartiennent pas au monde des lettrés professionnels. C'est astucieux et intriguant.
|
