
Terre natale, exercice de piété, Jean Clair, Gallimard, 418 p., 22 euro.
Jean Clair, personne ne l'ignore, a une très belle plume. Il l'a démontré aussi bien dans ses essais sur l'art que dans ses oeuvres en prose. Ce livre a quelque chose de testamentaire. C'est un recueil de pensées qui s'organisent autour de thèmes autour desquels il fait tourner des sujets très divers. Les premières pages sont saisissantes, quand il affirme qu'il a été chassé de son apparence charnelle et peut-être même de sa conscience de soi. Il y insinue ce que peut être la douleur du corps et le fait que ce dernier ne souhaite plus l'héberger. La suite est toujours passionnante et belle aussi, malgré ses zones d'ombres et même de ténèbres. Sa pensée est sagace, pertinente (et donc, par définition, dans un semblant de contradiction, qui n'et pas) impertinente. Il revient sur son enfance et sur ce qu'elle a pu représenté, comment se sont formulés alors des comportements et des manières de réagir au monde. Il revient aussi sur les musées, qui ont été plus pour lui qu'un souci professionnel. Il constate avec regret le déclin de l'art actuel. Ce sont là des sujets qu'il a traités dans des ouvrages précédents et qui ont marqué, soulevant parfois de vives polémiques. Chemin faisant, il montre de quelle façon il a fréquenté Goethe ou encore Marcel Proust, cette culture lui sert de levier pour donner corps à ses méditations. Dans chacun de ses chapitres, il part d'une expérience existentielle (le rêve par exemple) pour aborder des questions plus vastes. En sorte que ces pages se révèlent une sorte d'autobiographie qui ne cesse de pousser ses ramifications dans la sphère de la culture ou de l'histoire. Il tire des fils et ceux-ci l'entraînent de plus en plus loin de son point de départ. C'est une alternance de longues digressions, comme sur le monde rural de ses origines familiales en Mayenne et la rapide transformation du pays avec l'émergence des grandes banlieues ou encore sur le « musée imaginaire » comme l'a voulu André Malraux, ou encore le rire que Baudelaire savait démoniaque par essence, ou enfin sur l'Académie française. C'est bien une succession ininterrompue de passages courts sur un sujet précis et de bien plus longues réminiscences. On est fasciné par cet « exercice » qui complète plusieurs livres de caractère autobiographique. Il y a plusieurs livres dans ce livre, mais ils se fondent pour souligner que l'existence d'un homme est constitué de ses antécédents, de ses jeunes années, de ce qui peut y avoir d'irrationnel en lui, mais aussi de ce qu'il a pu construire dans les actes et de manière intellectuelle. Jean Clair, malgré toutes ces révélations, demeure un homme assez mystérieux et toute son oeuvre le prouve. Il a une dimension labyrinthique. Et elle est comme un aimant pout qui veut savoir qui est Gérard Régnier, le conservateur, et qui est son double Jean Clair, l'ennemi des musées modernes.

La Ressemblance informe, Georges Didi-Hiberman, Editions Macula, 504 p., 32 euro.
Dans ce livre d'une dimension considérable, Georges Didi-Huberman a souhaité décrypter la pensée de Georges Bataille pendant la période la revue qu'il a créée, Documents. Cette dernière paraît pour la première fois en avril 1929. Elle a eu en tout quinze numéros et a dû cesser ses activités en mai 1931. Financée par le marchand d'art Georges Wildenstein, direction de la Gazette des beaux-arts, elle a une rédaction composée de Jean Babelon et Pierre d'Espezel, conservateur des cabinets des médailles et des monnaies de la Bibliothèque nationale, de Carl Einstein, le grand historien d'art allemand, de membres du musée d'Ethnologie comme Georges-Henri Rivière, Paul Rivet et Marcel Graule, Roger Vitrac, Roger Gilbert-Lecomte, Michel Leiris. Jacques Prévert, Jacques Baron et Robert Desnos y ont aussi collaboré. On comprend bien le projet de Bataille : associer des transfuges du surréalisme (écrivains, peintres, comme André Masson, photographes) et des ethnologues ou des historiens. Le projet de Bataille est la fondation d'une « communauté négative » ou, mieux comme l'a déclaré Maurice Blanchot, d'une communauté inavouable ». Ce que Didi-Huberman souligne ici, c'est de formuler les vases d'une philosophie antithomiste et aussi d'y inclure des concepts qui peuvent adopter des aspects théoriques de prime abord contradictoires. La citation mise en exerce au début de saint Augustin, qui définit l'informe comme n'étant pas la non-forme. La pensée de Bataille est assez difficile à déchiffrer car elle échappe aux grands systèmes, se veut multidisciplinaire et chargée de dérision iconoclaste. Didi-Huberman n'est pas toujours clair dans ses commentaires qui ont été formulés en 1995. Mais dans son interprétation de ce que Bataille veut discerner dans la figure humaine, il montre bien de quelle façon il a entendu utiliser les ressources de la photographie. Même si son cheminement est assez labyrinthique, il est néanmoins parvenu à exposer dans quelle perspective l'auteur du Bleu du ciel est parvenu à reconstituer une tentative de rechercher un mode de pensée qui puisse inclure la discorde et le disparate. C'est là une aventure audacieuse et complexe. La seule question de l'anthropomorphisme est des plus complexe et l'intérêt que l'on porte alors aux arts non Occidentaux (dits « primitifs ») vient alimenter cette réflexion. Plus l'on tend à la reproduction du réel, plus on en vient à la distordre et même à la renverser. Ce livre est indispensable pour qui veut comprendre quel a été le dessein de Georges Bataille et de ses amis de la fin des années vingt. Mais c'est aussi un outil pour pénétrer les questionnements qui se sont croisés à cette époque, en créant des tensions de toutes sortes. La Ressemblance informe est un ouvrage de référence incontournable de ce point de vue.
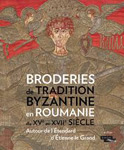
Broderies et tradition byzantine en Roumanie du XVe au XVIIe siècle, Louvre éditions / Editions in fine, 80 p. , 19 euro.
Le titre de cette exposition du musée du Louvre n'est peut-être pas très attractif car il ressemble à celui d'une thèse universitaire. Mais c'est pourtant un choix d'objets remarquables, à commencer par l'étendard d'Etienne le Grand, qui avait présenté en grande pompe à la Sorbonne en 1917. La bannière liturgique d’Etienne III de Moldavie (il a régné entre 1457 et 1503) sur fond rouge et brodé avec des fil d'argent, où on le voit assis sur son trône écrasant des deux pieds un dragon, est une merveille. Il a été canonisé peu après sa mort et a donc rejoint la légion des saints orthodoxes. Et l'on découvre aussi des splendeurs de l'art de cette région du monde surtout au XVIe siècle, comme le portrait en pied de saint Démétrius, un saint Nicolas prêchant, un portrait en pied de Denys l'Aréopagite, revêtu d'habit sacerdotaux magnifiques blancs avec des croix et des décorations noires. Ces oeuvres pourraient suffire au bonheur du visiteur. Mais il faut aussi contempler les vêtements liturgiques, l'un plus somptueux que l'autre, tous ces orarions et épitrachgelions qui sont la marque d'une culture d'une richesse insoupçonnée. Le voile d'iconostase offert en 1484 par le grand saint moldave (aussi brodé sur fond rouge) est un chef-d'oeuvre. Toutes ces pièces liturgie sont un enchantement et la révélation d'un grand art qui doit beaucoup à Byzance de toute évidence, mais qui a su en interpréter les thèmes et les formes en fonction de la technique utilisée. Si vous avez manqué cette belle exposition, procurez-vous le catalogue qui, en dehors de l'enseignement qu'il dispense, est un enchantement.

A rebrousse-temps, Snoeck / Musée Camille Claudel, 118 p., 25 euro.
Une étrange maladie s'est abattue sur les musées français : l'obsédante manie de confronter l'art ancien et l'art contemporain. Le musée Camille Claudel n'a hélas pas échappé à cette contagion. Pourtant, l'exposition inaugurale avait été passionnante car elle donnait à comprendre qu'elles avaient les relations de l'auteur du Partage de Midi avec sa soeur, avec des documents du plus haut intérêt, qui nous obligèrent à abandonner bien des idées reçues. Cette fois, on a mis en regard des oeuvres récentes avec celles de la malheureuse artiste et de certains de ses collègues. Damian Hirst est présent avec Anatomie d'un ange (2008) qui est mis en relation avec une petite oeuvre d'Alfred Boucher ; l'inénarrable Orlan, avec trois grandes sculptures monochromes intitulées Robes de plis sans corps (2008) serait apparentée avec La Valse de Claudel, alors qu'elle se réfèrent à la Sainte Thérèse du Bernin ; Claude Lalanne est choisi pour son Grand torse d'enfant (1983). Je me dispenserai de les citer tous, car la situation se répète sans cesse : il n'existe absolument aucune affinité entre les sculptures de Camille Claudel et toutes ces oeuvres qui n'ont de toute façon pas été crée pour cette occasion. Comme toujours, les créations récentes paraissent bien faibles par rapport aux oeuvres plus anciennes. Je souligne néanmoins une bizarrerie : le choix d'une oeuvre de Germaine Richier, Le Berger des Landes (1957) qui me surprend encore ! Au fond on pourrait à la limite accepter le rapprochement de la Conversation (2001) de Juan Muños et des Causeuses. Mais que cela ne vous décourage pas d'aller à Nogent-sur-Seine découvrir ce tout nouveau musée, qui vaut le déplacement. Il est loisible de découvrir les ouvrages de cette jeune femme qui a été emportée tôt par la folie et n'a plus rien fait entre son internement et sa mort.

Voilées/dévoilées, In fine/ monastère royal de Brou, 136 p., 22 euro.
Le thème est vaste et embrasse plusieurs grands domaines : de la religion aux usages vestimentaires. Pour nous, le voile est essentiellement associé à la vie monastique des femmes, qui portent toujours un voile qui complète l'uniforme spécifique de leur ordre. Le célèbre ex-voto reproduit dans ce livre, représentant mère Catherine-Agnès Arnauld et soeur Catherine de Sainte-Suzanne Champaigne en est la parfaite illustration. Mais les costumes folkloriques féminins sont toujours accompagnés de coiffes comme on le voit dans le tableau de Julien Dupré, La Porteuse de lait. Il faut ajouter à cela quelques traditions liées au voile : le deuil en premier lieu (et cela vaut aussi pour les juifs) et aussi le mariage, le voile noir du premier dans notre culture contrastant avec le voile blanc du second (le voile est également associé à la première communion pour les jeunes filles). Le voile a aussi des fonctions symboliques : il est par exemple associé à la représentation du secret, du silence, comme on le vois dans la sculpture en marbre de Giovanni Razza ou dans celle d'Auguste Préault. L'accent est mis sur le monde musulman, où le port du voile est imposé aux femmes avec plus ou moins de sévérité selon les régions et les croyances plus ou moins orthodoxes. Mais le voile est aussi présent dans la mode -, la voilette en ayant été la plus sensuelle manifestation, voilant et dévoilant tout à la fois le visage. Cette exposition montre de nombreux aspects de ce qui demeure l'un des attributs vestimentaires de la femme dans une optique profane ou sacrée (ou souvent, un mélange des deux). Des vestales antiques jusqu'aux coquettes des années vingt, de Paris à Alger, le sens voile est dans cette intéressante exposition décliné avec beaucoup de discernement.

Le Lance-pierre, Ernst Jünger, traduit de l'allemand par Henri Plard, « L'Imaginaire », Gallimard, 336 p., 11 euro.
Ernst Jünger (1895-1998) est connu pour ses récits de la Première guerre mondiale, dont son chef-d'oeuvre Orages d'acier, et aussi pour ses journaux (dont le Journal de l'Occupation). Mais son oeuvre est immense et touche à de nombreux domaines, dont la politique sociale ou l'entomologie, qui était une de ses passions. Die Zwille date de 1973. C'est un roman d'initiation où un jeune campagnard devenu orphelin, Clamor, doit aller faire ses études en ville. S'il se sent déraciné, il n'en est pas moins fasciné par ce nouvel univers. Dans ce collège à la discipline terrible, il a plus de mal que les autres à s'adapter. Mais si le destin du jeune garçon et sa découverte d'un nouveau monde, semble être le sujet principal, Jünger fait de ce livre un traité d'esthétique où il déploie toutes les formes de sa relation aux arts et aux artefacts. Il s'interroge sur la création et, en particulier, à la peinture, qui est à la fois vérité et mensonge. Ils soulignent que l'interaction des cultures n'est pas toujours une bonne chose pour la quête artistique. Ainsi le livre est à la fois une expérience douloureuse de l'entrée dans la société par le biais d'une éducation sévère et obtuse, mais aussi le cheminement d'un être en quête de son identité et aussi de ce qui lui permet de s'ouvrir sur ce qu'il découvre. C'est une sorte de cahier où l'auteur, par l'intermédiaire de son jeune héros, qui ne se sent pas d'affinités avec les autres collégiens, d'une meilleure extraction, mais aussi avec tout ce qui l'entoure. Ce n'est pas un rebelle, mais il devient marginal malgré lui. Bien difficile de savoir ce qui est vraiment propre à 'auteur et propre à son personnage dans ce livre ! Mais c'est un grand livre, qui est capable d'embrasser la culture de son temps et de l'interroger, avec ses préjugés sans doute, mais aussi avec un réel désir ce comprendre son temps. Qui aime profondément la littérature ne peut manquer de lire cette oeuvre remarquable.

Mémoires du comte de Gramont, Anthony Hamilton, édition de Michel Déon, Folio « classique », 416 p., 9 euro.
Publié pour la première fois en 1713, cet ouvrage a connu un très grand succès : il a été maintes fois réédité jusqu'au début du XIXe siècle. Voltaire l'a loué pour son goût de la conversation. Anthony Hamilton (1646-1720). Bien que né en Irlande, il était d'origine écossaise. Il a choisi d'écrire en français. Il a passé sa jeunesse en Angleterre et a fait la connaissance du comte de Gramont qui a épousé sa soeur Elizabeth. Il devient ensuite gouverneur de Limerick et commande un régiment au service du roi Jacques II. La montée sur le trône de Guillaume d'Orange le contraint à l'exil et rejoint à Saint-Germain-en-Laye la cour du roi déchu en 1695 puis s'installe à Versailles. Il se fait remarquer par ses poèmes et écrit une biographie inspirée par la vie de son beau-frère. Il y dépeint non sans ironie les valeurs de la jeuna aristocratie française et le fait d'une manière très originale puisqu'il a recours à différentes formes du passé, du fabliau au récit épique en passant par les contes de fées. C'est aussi une chronique un tant soit peu ironique de la vie de cour à la fin du règne de Louis XIV. Tous les personnages mis en scène reflète à merveille les moeurs de l'époque, ses engouements, ses travers mais aussi ses vertus. L'existence du libertin Philibert de Gramont est un révélateur de la manière de vivre du grand monde et de la cour de Charles II à celle du Roi-Soleil, et Sainte-Beuve lui accorde cette qualité rare. Hamilton n'est ni la marquise de Sévigné, ni Sainte-Beuve : il ne cherche pas à déchiffrer l'univers des véritables courtisans, mais plutôt à mettre en scène un art de vivre qui a ses versants somptueux et ses versants moins glorieux. Il a pris part aux grands jeux d'échecs pour le pouvoir, mais ce n'est pas ce qui le passionne le plus. C'est plus une étude d'une classe qui domine la société d'alors. Ce livre n'a pas vieilli d'un iota et se parcourt toujours avec délectation.

Voyous, truands et autres voleurs, Hans Fallada, traduit de l'allemand par Laurence Courtois, Folio, 112 p., 2 euro.
Hans Fallada (1893-1957), pseudonyme de Rudolf Wilhelm Adolf Ditzen, bien qu'il ait été un représentant d'un réalisme qui n'a plus cours à son époque sauf dans le cas de Maxime Gorki et d'Anna Seghers, n'en a pas moins été un écrivain hors pair. Il suffit de songer à un livre merveilleux, Seul dans Berlin, qui a paru posthume, et qui est sans doute le seul grand témoignage de langue allemande de la vie dans la capitale allemande sous le IIIe Reich - un véritable monument à mes yeux - pour comprendre qu'il tient une place de choix dans la littérature germanique du siècle passé. Les brèves nouvelles réunies dans ce recueils ont été choisies pour leur thème : le monde des mauvais garçons. Si elles ont en commun de parler de petites frappes et de malfaiteurs de bas étage, elles n'en révèlent pas moins d'étranges développements. La première, « De la longueur de la passion », est d'abord une singulière histoire d'amour plus que le récit de l'existence d'un mauvais garçon et de sa relation avec une jeune campagnarde nommée Ria. Et il y a dans toutes ces histoires un même sens du récit, un même rythme et surtout une manière de présenter les mésaventures de ses malheureux héros qui donnent à ces textes un je ne sais quoi de surprenant et même d'un curieuse étrangeté. Hans Fallada a été un artiste de la prose qui, malgré son choix esthétique, est parvenu à dépasser le caractère un peu suranné de son engagement : il rend ses nouvelles captivantes et d'une certaine manière émouvantes.

Aux cinq rues, Lima, Mario Vargas Llosa, Folio, 320 p., 7, 90 euro.
Né en 1936 à Arequipa, le marquis de Vargas Llosa a choisi d'adopter la nationalité espagnole après avoir échoué aux élections présidentielles de 1990. Son chef-d'oeuvre est sans nul doute possible Conversaciòn en La Catedral, publié en 1969. Aux Cinq Rues, Lima est son dernier roman traduit en français en 20127. C'est un livre qui fait un état des lieux de son Pérou natale. Pour ce faire, il a choisi un des quartiers du centre de la capitale, les Cinq Rues, Il met en scène une affaire de chantage (il s'agit de photographies compromettantes)pendant les années 1990, dont la victime est Enrique Càrdenas, un ingénieur qui est aussi un homme qui compte dans les milieux financiers, sa femme, Marisa, qui a une histoire d'amour avec sa meilleure amie, Chabela, par accident (mais leur relation se poursuit en secret), une journaliste qui travaille pour un journal de la presse à scandale qu'on surnomme La Riquiqui. Son directeur, Roland Garro est l'acteur du chantage, qui tourne au tragique, car ce dernier est assassiné. La façon dont l'auteur traite la question est à la fois très sérieuse et teintée d'ironie. L'enquête nous révèle les dessous de la société péruvienne, où la corruption est dissimulée sous un vernis de respectabilité. L'affaire sert en réalité à pénétrer dans les méandres d'un monde qui a perdu le sens profond de toute morale et qui est dévoré par un mal endémique. Dans ce roman, tout finit par s'imbriquer, politique, économie, déviance sexuelle, amitiés suspectes, le bon et le mauvais genre. Mario Vargas Llosa a voulu dépeindre une société de l'Amérique du Sud qui a perdu les valeurs fondamentales et sa tragi-comédie est un appel à l'éthique et une dénonciation du gouvernement de Fujimori, qui a chassé du pouvoir justement pour des raisons de corruption.

Aventures d'un jeune homme, John Dos Passos, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Mathilde Cambi, « L'Imaginaire », Gallimard, 448 p., 12, 80 euro.
John Dos Passos (1896-1970) est sans le moindre doute l'un des grands romanciers américains du XXe siècle. Manhattan Transfer (1925) représente l'une des plus belles créations expérimentales de son époque. A la différence de James Joyce avec son Finnegan's Wake ou de la plupart des oeuvres de Gertrude Stein, il demeure toujours lisible et désireux de dépeindre l'Amérique moderne avec des moyens encore jamais employés dans cette sphère. La trilogie baptisée USA, écrite entre 1930 et 1936 ne fait que le conforter dans cette voie. En revanche, cet ouvrage paru en 1939, Adventures of a Young Man, premier volume de son cycle, « District of Columbia », revient à une facture plus naturaliste. Il faut savoir que c'est une sorte d'autobiographie masquée : son héros, Glenn Spotswood, en pleine dépression, prend conscience de la condition terrible des classes laborieuses et décide de s'engager politiquement. Il rejoint les rangs du parti communiste. Mais sa désillusion va croissante et il s'éloigne du communisme qui a été son idéal. Dans son existence, Dos Passos a suivi un chemin assez similaire. Il s'est même rendu en Union soviétique en 1928 et il participe en 1935 au First American Writers Congress. Il déchante alors et décide de soutenir l'American Commitee for the Defense of Léon Trotski. Son séjour en Espagne, où il retrouve Ernest Hemingway ne fait que le conforter dans cette idée et il tourne définitivement le dos au communisme. Les Aventure d'un jeune homme est l'expression de ce désamour, mais aussi toute l'histoire d'un engagement face aux injustices sociales, renforcées par la grande crise commençant en 1929. Et malgré sa tonalité réalisme et son déroulement linéaire, sa longueur, Dos Passos a assez de qualités littéraires pour rendre ce livre attractif. Il est encore plein d'enseignements à notre époque et se révèle aller bien au-delà du simple témoignage d'une époque et de ses illusions aux Etats-Unis. Hautement recommandable !

Les dimanches de Jean Dézert, Jean de La Ville de Mirmont, « La Petite Vermillon », La Table Ronde, 240 p., 7, 30 euro.
La remarquable préface de François Mauriac nous présente cette figure étonnante, cet écrivain dont il a été l'ami intime, et qui n'a laissé qu'une oeuvre fort courte car il est mort sur le champ d'honneur en novembre 1914. Il n'avait que vingt-huit ans. Ses Dimanches de Jean Dézert est un bref pièce romanesque, mais qui se distingue par sa singularité. Le premier paragraphe donne le la : d'une observation des plus banales sur la pluie qui tombe, notre écrivain a su faire l'ouverture de son histoire et en a donné le ton. L'existence de son héros (héros n'est peut-être pas le terme le mieux adapté !), Jean Dézert est d'une redoutable banalité. Mais il n'en est pas moins un être original et qui, au fil de ses pensées, déroule le bobineau d'un destin peu ordinaire en dépit des apparences. C'est une sorte d'excentrique, qui ne s'extériorise guère. L'écrivain sait nous le rendre attache même s'il est cocasse et, somme toute un peu ridicule. Son histoire d'amour, après une rencontre impromptue au Jardin des Plantes avec une jeune fille, se termine par la rupture des fiançailles après des péripéties des plus triviales. L'histoire n'a rien que de très banale, mais elle permet de montrer de quelle manière ce petit homme, fonctionnaire sans éclat, sans guère de qualités (en tout cas à première vue -, mais le récit le métamorphose), apparaît à nos yeux comme une figure des plus attrayantes. C'est un livre plein de charme et d'ironie, assez peu dans le goût de l'époque où il a été écrit, paru peu avant le déclenchement de la guerre. Dans le même volume, on découvre aussi son oeuvre poétique, qui elle aussi doit retenir l'attention car elle est loin et du Parnasse et du symbolisme, s'attachant aux menus faits du quotidien, rédigé dans un style sans le moindre apprêt, mais avec une grâce qui n'appartient qu'à lui. Ce recueil baptisé L'Horizon chimérique n'a paru qu'un 1920. Il a séduit Gabriel Fauré qui a choisi quelques textes pour en faire des lieder. Enfin, nous pouvons aussi découvrir quelques petites proses qui sont des plus charmantes. Voilà un auteur qui peut demeurer quelque temps sur votre table de chevet car il ne pourra que vous enchanter.

Les Poètes maudits, Jean-François François Frackowiak, Folio + collège, 160 p., 4,20 euro.
Il est curieux que l'expression « poètes maudits » ait traversé le temps ! Les grands courants de la poésie française de la seconde moitié du XIXe siècle, le symbolisme, le Parnasse, ont été remplacés par cette qualification qui embrasse des auteurs assez différents et pas toujours maudits, comme Théophile Gautier qui figure dans cette anthologie. On y retrouve des poèmes de Charles Baudelaire, de Gérard de Nerval, de Germain Nouveau, de Stéphane Mallarmé et, bien sûr, de Paul Verlaine et d'Arthur Rimbaud. Mais on trouve au début des auteurs comme Ovide (certes envoyé en exil), Rutebeuf, François Villon, puis André Chénier (mort sur l'échafaud, mais prisé pour sa poésie) pour sauter au XIXe siècle. romantique avec Marceline Desbordes-Valmore. Tout cela peut sembler pas très cohérent, mais l'important n'est pas là : c'est le dossier pédagogique qui compte. Et il faut reconnaître qu'il est plutôt bien fait et donc utile.

La Mort n'est jamais comme, Claude Ber, Editions Bruno Doucey, 160 p., 16 euro.
Ce recueil, publié pour la première fois en 2003, a déjà été réédité. Les infortunes de l'auteur avec ses éditeurs prouvent néanmoins que son oeuvre résiste à bien des avanies. Claude Ber - je l'ai déjà écrit dans ces pages il y a quelque temps - est une des rares poétesses français qui n'est ni expérimentale ni académique et qui pourtant a su formuler un art poétique original et captivant. Le premier des poèmes réunis dans cet ouvrage, « Ce qui reste », se révèle d'une force de pensée remarquable. C'est une méditation sur la mémoire, sur la poésie et la mort est ici considérée comme la frontière entre ce qui est et ce qui subsiste une fois franchie cette frontière. C'est d'une grande densité et d'une indéniable pénétration. Tout aussi remarque le plus texte qui a donné son titre au recueil, qui se divise en deux catégories formelles, la première étant celle de forme habituelle de l'écriture de l'auteur, la seconde étant une série de textes en prose baptisés « Découpes ». Ici l'auteur met en scène une sorte d'effondrement ou de déroute de la langue qu'on pourrait regarder comme un commentaire de ce qu'elle écrit en termes poétiques. Là encore on est impressionné par la richesse de sa réflexion et la pertinence de ses propos. Si elle philosophe, Claude Ber n'est jamais didactique ou sentencieuse. Elle fait cheminer le lecteur dans l'écheveau de ses raisonnements intimes et de ses rêveries éveillées et des conclusions qu'elle peut en tirer. C'est pour nous un voyage labyrinthique et même temps d'une grande clarté, ce qui est un peu un paradoxe. Et la beauté de l'enchaînement de ses vers et même les curieux fragments fictionnels qui accompagne « La Mort n'est jamais comme » sont fascinants. Je recommande donc aux amoureux de la poésie authentique de se procurer ce petit livre qui est d'un enseignement précieux.

L'esplosione, Nanni Balestrini, postface de Paolo Fabbri, Cecilia Bello Minchiachi & Milli Graffi, Il verri edizioni, 70 p., 22 euro.
Nanni Balestrini nous a quitté voici quelques mois. Avec lui disparaît une figure importante de l'intelligentsia italienne, qui a été l'un des majeurs protagonistes de la néo avant-garde littéraire italienne, mais aussi un homme engagé, qui a participé aux mouvements d'extrême gauche de l'époque (Potere operai, Autonomia). Il a laissé une oeuvre conséquente, compissée de nombreux recueils de poésie, comme Il ritono della signora Richmond (1987) ou Estremi rimedi (1995) et des romans, tels Vogliamo tutto (1964) ou encore La violenza illustrata (1976). Il a été au centre du groupe des Novissimi et du Gruppo'63, et a aussi été le codirecteur de la célèbre revue Alfabeta. En outre, il a développé une oeuvre plastique où les mots tiennent une place essentielle dans leur composition. La Fondation Mudima de Milan a présenté plusieurs expositions de ces travaux plastiques. Il est encore trop tôt pour tirer la somme de ses recherches qui associent étroitement une volonté de subversion de l'art poétique avec une pensée politique radicale. Il néanmoins certain qu'il a laissé une trace profonde car il a été l'expression de cette volonté de transformation de l'art poétique et de la société, les deux tendances ne faisant plus qu'une dans son esprit. Ce recueil nous fait découvrir ses dernières poésies. Elles se révèlent être une sorte de journal de ses réflexions et de ses luttes, sous une forme narrative, mais qui possède néanmoins une force d'attraction qui ne peut être niée. Nanni Balestrini a représenté le grand paradoxe de cette période qui débute avec les années soixante pour s'éteindre peu avant la fin du siècle. Il veut que la littérature soit la pure manifestation d'une révolution politique, mais a néanmoins conservé le goût pour l'art poétique et les arts plastiques -, il n'a pu se défaire d'une quête esthétique qui aurait dû complètement subordonnée à ses théories sur le monde contemporain. Le poète en lui n'a jamais rendu les armes devant une idéologie. Et cela fait de lui un créateur singulier qui a su dépasser ses propres contradictions, comme le montre ces derniers poèmes publiés.

Bianco Nero Pianoforte, Lelli & Masotti, Mudima, 102 p., 30 euro.
Ces métamorphoses, aventures et mésaventures d'un piano à queue rappellent aussitôt le piano emballé dans des bandes de feutre de Josef Beuys. Il y a aussi des pianos dans les tableaux de Salvador Dalì (Le Piano de Lénine, 1932) et de René Magritte. Et de bien autres artistes qui ont pris le chemin de l'onirisme. Ici, dans cette suite de photographies, le piano voyage, parfois dans des termes normaux (le transports, la main de l'interprète, l'intervention de l'accordeur, etc.), mais le plus souvent dans des termes imaginaires (sous formes de collages, de situations incongrues, de confrontations irréelles (avec, par exemple, des bottes de foin et une fourche, de lieux incongrus comme dans le cliché où l'on voit l'instrument devant un petit autel). Bref, l'icône « piano » résonne dans cette série magique de représentations qui vont de la photographie prise de dessus jusqu'au piano rempli d'animaux en peluche. Tout cela est accompagné de poèmes de la main de Mara Cantoni dont certains sont des dialogues comme dans « Rêves », qui font office dans ces dimensions connexes de contrepoint. Cet ensemble artistique et littéraire a été présenté pour la première fois à Ravenne en 2005. Cette « installation » est également accompagnée d'une musique de Luigi Ceccarelli, que le lecteur pourra trouver sur un site sur la toile. Le tout ne constitue pas une harmonie. Au contraire. De la disjonction des différents éléments conceptuels que le composent, on peut éprouver la vérité contenue dans l'image du piano et dans le sens même du mot, qui pèse très lourd dans notre culture. Somme, c'est une expérience totale des sens et de la représentation que ce catalogue rend mémorable.

Valse-hésitation, Angela Huth, traduit de l'anglais par Anouk Neuhoff, Folio, 304 p., 7, 90 euro.
A croire que la nouvelle génération de romanciers marque un retour en arrière. Pourquoi pas ? Les goûts et les modes changent. Mais cette fois on remonte dans le temps avant Virginia Woolf, et Henry James peut paraître en comparaison un avant-gardiste ! Nous avons affaire ici à un petit drame sentimentale des plus banals. L'héroïne, Clare, s'est remarié avec un homme prévenant, trop même, et sans aucun doute jaloux, au point de lui rendre la vie infernale. Elle trouve refuge auprès de Joshua. Quoi de plus banal ? Mais, au fond, l'intrigue pourrait être sans beaucoup de relief, mais rendu avec art. Hélas, trois fois hélas, on se retrouve avec une construction bien faite, mais une écriture bien pauvre, mais si le tout est tiré au cordeau. Qu'on en juge avec ces quelques lignes qui apparaissent à la fin de ce livre à la page 287 : « Au bout d'un moment, je me rendis dans la cuisine et ouvris le robinet d'eau froide. L'eau tambourina au fond de l'évier en zinc. Le bruit s'accentua quand j'augmentai le débit. » Le reste à l'avenant. Le roman est entièrement fait sur cette tonalité fascinante. Que puis-je dire de plus à ce sujet ?

La Tempête de neige / Une aventure, Marina Tsvétaïeva, traduit du russe par Hélène Henry, Folio, 128 p., 2 euro.
La poésie de Marina Tsvétaïeva n'a été découverte qu'au cours des années 1960, bien après sa mort survenue en 1941. Cette Moscovite, fille d'un professeur d'histoire de l'art, fondateur du musée Alexandre III, devenu ensuite musée Pouchkine, et d'une mère musicienne. Malgré ce contexte familial, on n'a pas approuvé son penchant pour la poésie. Elle est envoyée dans un pensionnat en Suisse, où elle a appris plusieurs langues étrangères. Elle suit des études de littérature à la Sorbonne en 1909 et est très admirative de l'oeuvre d'Alexandre Blok et d'Andreï Biély. Elle publie son premier recueil de poésie, Album du soir. Maximilien Volochine la remarque et devient son mentor. Elle se marie en 1912 avec un jeune officier. Elle est témoin de la Révolution d'octobre alors que son mari rejoint l'armée blanche. Elle fréquente alors les milieux du théâtre. Elle écrit alors ces deux pièces qui sont à contre-courant de tout ce que les avant-gardistes soviétiques peuvent produire Elle apprend grâce à Boris Pasternak que son mari s'est réfugié à Prague et va le rejoindre en 1922. Elle devient alors une exilée, vivant ensuite à Berlin et à Paris. Elle retourne en Russie en 1939 et est envoyé en Tartarie où elle se pend en août 1941. Ces deux petites pièces ne sont pas à la hauteur de sa poésie, et représentent plutôt un témoignage de son oeuvre de jeunesse.
|
