
Chorégraphie estivale, une vie d'aventures avec le peintre Jacques Doucet, Andrée Doucet, Somogy, 168 p., 23 euro.
Ce n'est pas un livre de mémoires des plus communs. Andrée Doucet ne nous narre pas sa vie d'épouse ou ne nous rappelle pas la carrière de son mari devenu l'un des membres du groupe Cobra n'étant pas du Nord de l'Europe. Elle relate leurs périples (elle commence par ceux qu'elle effectuées sans lui quand elle était étudiante aux Arts décoratifs). Bien sûr, d'autres figures d'artiste apparaissent au fil du récit, comme Corneille et Atlan, au début de leur histoire commune. Si elle a décidé de ne parler que de leur amour de l'aventure, du voyage et de la découverte (d'abord Florence et la Tchécoslovaquie, seule, la Hongrie, leur premier périple ensemble, l'Italie, souvent, la Yougoslavie, l'Espagne, le Proche-Orient aussi, etc.). Bien sûr, au fil de son récit elle parle de l'oeuvre de son mari, de ses expositions, de sa relation aux autres, aux choses, à la culture, populaire ou non, de sa pensée. Mais, contrairement aux biographes qui ont tendance a sublimé (et donc à momifier) leur modèle, elle ne se met jamais en retrait (mais pas non plus sur le devant de la scène). C'est ce qui rend cet ouvrage si agréable à lire, si différent, si riche, alors qu'il est écrit (et bien écrit) avec une grande simplicité qui a pour objectif principal de restituer les joies partagées par cette femme avec son peintre de mari. Si l'on veut approfondir la connaissance de l'oeuvre de Jacques Doucet (1924-1994), ce livre est inestimable, car il expose ses goûts, ses choix, ses plaisirs, tout ce qui constitue la nature profonde de sa création. En plus, il dévoile un pan de sa vie qui sort des clichés habituels et de la pure et simple monographie. Pour une fois que nous n'avons pas affaire à une veuve éplorée qui n'a pas un fond d'atelier à nous vendre ! C'est vraiment-là une merveilleuse exception.

Les Aventures de Nick Adams, Ernest Hemingway, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marcel Duhamel, Victor Liona, Herin Robillot, Ott de Weymer & Céline Zine, Folio, 368 p., 7,70 euro.
Ce livre est sans nul doute le plus singulier qu'ait écrit Ernst Hemingway. Il s'agit de nouvelles, entre 1920 et la fin des années 1930, qu'il a tenu à publier isolément au fil du temps. Mais, à elles toutes, elles forment une autobiographie du célèbre écrivain américain. Cette forme l'a amené à ne se concentrer que sur des moments forts de son existence, ou des moments révélateurs, comme, par exemple, ses souvenirs d'enfance dans le Michigan. Il parle aussi de son expérience matrimoniale et de la guerre, de la première, en Italie, qu'il a narrée dans son roman l'Adieu aux armes (1932) et de la seconde, quand il est arrivé à Paris en libérateur. Ce n'est pas toute sa vie et le caractère volontairement déguisé et décousu de ces mémoires, où il parle de lui comme d'un héros récurrent de ces récits plus ou moins longs, écrits avec vivacité et beaucoup de dialogues pour en rendre la lecture plus aisée et prenante. Justement, Hemingway ne se vit pas comme un héros et est ici, couché sur le papier, un être beaucoup moins exubérant et avide de séduite et d'être salué comme le plus grand homme de lettres de son pays. Il a aussi écrit d'autre Ouvres à caractère autobiographique comme Death in the Afternoon, Green Hills of Africa et A Moveable Feast (paru posthume en 1964). Mais aucunes d'elles ne possèdent cette intimité et cette subtilité narrative. Paris est une fête est un exercice d'autocélébration ans un contexte, celui du Paris de l'entre-deux-guerres où le monde semblait être condensé en un seul lieu, et où la fameuse Génération perdue s'est constituée. Cette édition est la première à être complète et à remettre entièrement dans l'ordre ces récits.

Compléter les blancs, Keiichirô Hirano, traduit du japonais par Corinne Atlan, Actes Sud, 448 p., 23 euro.
La littérature japonaise, ancienne ou moderne, a toujours eu un penchant pour le fantastique. De très grands auteurs en ont fait leur sujet de prédilection. Pour Keiichirô Hirano, c'est une manière de créer une situation absolument improbable et qui devient, dans son histoire, une réalité. Voilà un jeune couple, avec un enfant d'un an, qui mène une vie plutôt heureuse, dans sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Soudain, le mari, Testuo Tsuchiya, meurt : on songe à un suicide. Trois années passent. Il réapparaît, semblant ressurgi du royaume des morts. Sa femme, Chika, est profondément bouleversée. Notre étrange héros veut découvrir qu'il s'est réellement passé : sa première visite, il la réserve au médecin légiste auquel on avait confié son cadavre après le drame ! Il ne se rappelle de rien de précis, mais il est persuadé qu'il ne s'est pas donné la mort, mais qu'il a été assassiné. Il a même une idée sur l'identité du coupable. Tout en donnant l'impression de vivre une vie normale, comme si rien ne s'était passé, il mène une enquête approfondie. Il se rend dans son usine, remonte sur le toit de la conserverie, parle avec quelques uns de ses anciens collègues. Il rend visite à sa mère et veut avoir des nouvelles de ses grands-parents. Il interroge aussi son épouse et écarte le doute qui le tiraillait : elle n'a pas aimé un autre homme. Dans ce labyrinthe inextricable, Testuo se fait de nouvelles relations, commence presque une nouvelle existence. Il ne parvient pas à savoir la vérité. Assassinat ? Accident ? Suicide ? Si toutes les autres pièces du puzzle se recomposent peu à peu, ce point crucial reste un mystère. Notre héros avance dans ses recherches et en retire une sorte de satisfaction. Mais, un beau jours, il a le sentiment que les Ressuscités retournent d'où il sont venus et que ce sera bientôt son tour. Le roman s'achève sur la possible disparition de ce homme, mais sans qu'on sachez quel est le véritable dénouement. Keiichirò Hirano a fait de ce magnifique ouvrage une sorte de fable philosophique, qui repose sur l'idée d'une longue séparation que l'on croit définitive. Il mérite avec cette oeuvre de figurer dans le superbe panthéon de la littérature japonaise.

Aux Cinq Rues, Lima, Mario Vargas Llossa, traduit de l'espagnol (Pérou) par Albert Bensoussan & Daniel Lefort, Gallimard, 302 p., 22 euro.
Le Héros discret, Mario Vargas Llosa, traduit de l'espagnol (Pérou) par Albert Bensoussan & Anne-Marie Cassès, Folio, 496 p., 8,20 euro.
Mario Vargas Llosa demeure l'auteur mémorable de ce chef-d'oeuvre qu'est Meurtre en la Cathedral - ce roman à lui seul méritait le prix Nobel qu'il a reçu en 2010. Le reste de son oeuvre abondante est discutable, car il ya de grands livres et des livres moins grands. Le Héros discret, publié en 2013, fait partie de cette seconde catégorie. Car cet auteur a tout de même un péché mignon : la politique. Il a échoué aux élections présidentielles en 1990 face à Fujimori. Il s'agit pour lui de dénoncer la corruption qui règne dans son pays, sous toutes ses formes. Il veut y faire l'apologie de ces chefs d'entreprises qui, avec un très grand courage, font front au crime organisé et au chantage. Il a choisi un chef de compagnie d'assurances à Lima, et le directeur d'une compagnie transports routiers à Piura. Pour lui, ces deux individus sont de véritables héros, qui contribuent à rendre le Pérou moins corrompu. Même s'ils ne résolvent pas le problème dans son ensemble, s'ils ne figurent que pour montrer qu'il est possible de résister, ils donnent envie à d'autres de les imiter et de prendre des risques pour ne pas céder à ces pressions qui peuvent venir autant des véritables criminels que d'un groupe politique. Cela dit, c'est loin d'être un mauvais livre, mais on attend plus d'un écrivain de cette taille, qui ici ne fait que s'adresser à ses compatriotes. En revanche, Aux Cinq Rues, Lima est un superbe roman. Il est foisonnant et intense, un peu baroque, faisant s'enchevêtrer des situations et des personnages avec une grande science et une belle science de la narration. La notion de carrefour est donc ici de la plus grande importance, car on voit dans ces récits qui s'entrecroisent une image polyphonique la société péruvienne moderne. Des liens secrets se tissent, comme l'amitié saphique qui lie deux femmes mariées et heureuses en ménage, Marisa et Chabella. Que ces amours insolites ouvrent le livre n'est pas indifférent ; l'écrivain a souhaité révéler ce qu'on ne tient pas à voir ou à savoir. Il y aussi la figure aussi trouble du journaliste Rolando Garro, qui a franchi le pas du chantage à l'encontre des personnalités connues qu'il a approchées. Il y a un sentiment de malaise profond qui s'instaure progressivement dans cette histoire, dans cette capitale moderne, loin de tous les clichés qu'on en a, et qui est au fond le moteur du roman : les pratiques proches de la criminalité, ou franchement criminelles dans toutes les sphères imaginables : les affaires, la politique, la presse, même le spectacle, avec l'ingénieur Enrique Càrdenas surnommé Quique, etc. Le foisonnement et l'enchevêtrement de ces récits donnent à ce roman un incroyable densité et une intensité, non exempte d'humour, malgré la tonalité morale de la fable. Le grotesque ne fait que renforcer le caractère pathétique de ce que nous raconte Vargas Llosa avec tant de verve, qui est un réquisitoire contre les moeurs qui se sont installés dans son pays, la pathologie sociale finissant par l'emporter sur la justice et sur ce que les Latin appelaient la « vertu ».

Le Grand siècle déshabillé, anthologie érotique du XVIIe siècle, édition établie et présentée par Jean-Paul Goujon, « Bouquins », Robert Laffont, 1024 p., 30 euro.
Jean-Paul Goujon a eu l'ambition de nous présenter un XVIIe siècle assez différent de celui que nous connaissons. Il veut nous convaincre que ce siècle connu pour ses grands écrivains, architectes, musiciens et artistes. Pour ce faire, il nous introduit à la connaissance d'un vaste océan littéraire : celui des libertins. Il pense d'abord au libertinage, sous toutes ses formes. Mais, on le sait, ce terme a alors deux sens, et nous n'avons retenu que le premier qui est liée à la galanterie. Le second est d'une autre nature : il s'agit du libertin, celui qui est l'athée, le mécréant, l'ennemi juré de l'Eglise. Bien entendu, l'un peut se confondre avec l'autre, mais pas nécessairement. Le libertin peut fort bien être un philosophe qui se contente d'exposer ses thèses contre la religion. Nombre des écrits réunis dans ce volumes sont anonymes car après la régence de Marie de Médicis, Louis XIII a voulu endiguer ce déferlement de textes salaces, obscènes, parfois à la limite vraiment vulgaires. Mais ces dispositions n'ont qu'une efficacité relative. Un nombre assez conséquent d'ouvrages licencieux paraissent. Commençons par ceux qui ont une tonalité politique très nette ou qui sont insultants à l'encontre du souverain ou de ses proches collaborateurs. Je découvre dans ces pages un texte sans aucun nom d'auteur à propos du mariage de Louis XIII et d'Anne d'Autriche en janvier 1619. Ici, l'auteur se veut un chroniqueur précis de l'événement. Et Tallemant des Réaux explique une recette de virilité appliquée par le très jeune roi. Quant au nonce Guido Bentivoglio, il relate quelque aventure galante du roi avec Mlle de Montignon. Dans ce chapitre, ne nous voyons rien que de très innocent au fond, si ce n'est la curiosité de rigueur sur tous les faits et gestes du souverain, même dans sa vie la plus intime. La poésie satyrique fleurit à cette époque et à côté de grand maîtres comme François de Malherbe, on trouve une armée de petits poètes facétieux et égrillards dont une partie n'osent pas signer leurs sonnets plus ou moins luxurieux. Des livres recueillant ces vers paraissent, comme le Cabinet satyrique (1620). Les histoires de sodomie et de saphisme pullulent (il y a même dans l'anthologie des rapports de police), comme les « histoires tragiques », c'est-à-dire les faits divers liés à des relations amoureuses. Et bien sûr, ne sont pas rares les récits de débauches diverses dans les couvents ! Ce merveilleux ouvrages fait découvrir au lecteur une littérature qu'il ignore, mais, surtout, fait comprendre que cette époque est bien loin de ce qu'on nous enseigne à l'école. Jean de la Fontaine a écrit des contes libertins, et était choyé par le Roi Soleil. Les explications apportées par Jean-Paul Goujon sont précieuses car elles font bien comprendre non seulement l'esprit de ce temps, mais aussi les limites de la transgression, qui ne peuvent être comparées aux nôtres.

Chants de Bretagne, choix et traduction par André Markowicz & Françoise Morvan, préface de F. Morvan, « Orphée », La Différence, 192 p., 10 euro.
C'est là une idée originale et pleine d'enseignements, car que sait-on de la véritable tradition poétique de la Bretagne du temps jadis ? En tout cas, pour ma part, rien et je ne pense être le seul. Bien sûr, ces textes ont dû beaucoup évoluer au fil du temps car la transmission est un jeu où chacun met son grain de sel. La préfacière indique d'ailleurs qu'André Markowicz a lui-même adapté certaines de ces ballades. Quoi qu'il en soit, on ne peut que resté émerveillé devant ces poèmes (ou chansons, comme on voudra). Il y a une dose de naïveté ici, comme on peut le constater avec « La Grande Passion » et la « Petite Passion », mais il y aussi une grande dose de beauté, comme le prouve, entre autres, « La Fontenelle » et il y a parfois un peu d'humour et de folklore. Ce recueil est délicieux à lire car, malgré l'usure des ans, ces chants on conservé leur fraicheur, leur beauté et justement cette dimension populaire. L'esprit d'un peuple réside dans sa langue et cette langue est assujettie aux coups fastes ou néfastes de l'histoire. Pour nous, hommes et femmes d'un nouveau millénaire, ce passé-là vaut de l'or, même si cette tradition n'est pas directement la nôtre. Elle enrichit et élargit la culture de cette France si centralisée et maintenant le véhicule d'une langue dominante. L'expansion du pays a conquis des territoires où l'on parlait le catalan, le basque, la langue d'oc (sous toutes ses formes), l'italien, le flamand, l'alsacien et j'en oublie sans doute. La Bretagne n'a pas été prise par la force, mais par alliance. Mais sa langue a subi le même sort. Un mauvais sort. Mais lisez donc ces chansons, elles sont là pour nous apportez encore plus de richesse dans notre culture.
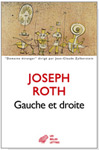
Gauche et droite, Joseph Roth, traduit de l'allemand par Jean Ruffet, « domaine étranger », Les Belles Lettres, 224 p., 14,50 euro.
Joseph Roth (1894-1939) a laissé des oeuvres inoubliables sur le déclin de l'Empire austro-hongrois, comme la Marche de Radetzky et la Crypte des capucins. Mais on a moins prêté attention à ses premiers livres, en particulier à la Toile d'araignée (1924), où il dépeint les relations troubles d'un membre du parti national-socialiste et d'un Juif. Il est sans doute le premier écrivain à prendre conscience du danger que pouvait représenter l'idéologie nazie à l'époque du coup d'état manqué de Munich. Il ne s'agissait alors que d'un groupuscule extrémiste qui semblait bien peu dangereux. Rechts und links (1929) fait partie de cette catégorie de livres où il se montre non seulement un observateur sagace du monde germanique, mais aussi un homme doué d'une vision presque prophétique de ce qui allait advenir. Joseph Roth nous raconte l'histoire d'une famille de banquiers à Berlin. Ce dernier s'est enrichi très rapidement et presque de façon mystérieuse. Il est marié à une femme qui le méprise malgré sa réussite. Il a deux fils. Le premier s'appelle Paul et aime les arts. Son père l'envoie étudier à Oxford alors qu'il rêvait d'aller à Paris Quand il rentre, il renonce aux études artistiques qu'il envisageait pour se lancer dans l'économie. Puis il est appelé sous les drapeaux. Il finit dans l'infanterie alors que sa mère rêvait de le voir dans la cavalerie. Il s'entend très mal avec son frère Théodore. Celui-ci fait partie d'une énigmatique confrérie étudiante, « Dieu et Fer » et est un être violent. En fait il a des opinions politiques extrémistes. Mais il joue dans le roman un rôle en demi-teinte. Paul est venu un homme en vue et aisé à une époque où la misère se généralisait. Dans la seconde partie, apparaît un nouveau personnage, un Juif russe, Nicolas Bandeis, qui avait adhéré à la Révolution, puis avait eu des doutes et avait jeté son uniforme aux orties. Il est parti, a voyagé et s'est retrouvé un beau jour dans la capitale allemande. Les chemins de Paul et de ce Russe s'étaient déjà croisés : Paul lui devait les derniers $ 2.000 qui lui restaient. Sur ces entrefaites, Paul fait la connaissance d'Imrgard Enders, qui est l'héritière d'un magnat de la chimie. Il finir par l'épouser, mais sans amour. Il est désormais à l'abri des ennuis financiers, mais pas de l'ennui. Quant à Bandeis, il est reparti car cet homme ne pouvait pas tenir en place. Ce roman n'est pas du même tonneau que Stendhal ou même que de Thomas Mann, comme l'avait déclaré l'ami de Joseph Roth, Herman Kesten, sans doute pour vanter ses mérites en le comparant à un grand écrivain d'autrefois et un célèbre écrivain moderne. Mais il a su suggérer une pente fatale qui était celui de la société allemande toute entière, du haut en bas, celle du grand capitaliste et, en pointillé, celui de la misère du peuple, que d'habiles propagandistes ont su convertir en un nationalisme exacerbé doublé d'un antisémitisme féroce. Gauche et droite n'est pas un livre politique à proprement parler, mais la radiographie d'une Allemagne en difficulté économique et morale après la défaite, que le personnage de Paul Bernheim représente à la perfection.

Début de roman, Julien Blaine, Editions des Vanneaux, s. p., 19 euro.
Je ne crois pas avoir besoin de vous présenter Julien Blaine, dont j'ai parlé à maintes reprises dans cette chronique. Avec ce nouveau livre, il nous surprend, non seulement par la forme qu'il a choisit (une forme poétique, mais qui est en réalité un récit en 85 parties). Nous n'avons plus l'émule endiablé de Dada et de Fluxus, mais un écrivain qui médite devant la question de la mort. Cette histoire évoque le décès de son père, advenu en un mois de septembre 2015. Rétrospectivement, quand on a achevé de lire ce livre, on a l'impression angoissante d'un compte à rebours. Chaque « chapitre » condense en quelques lignes (jamais plus d'une page, sauf à la fin) des souvenirs, qui s'égrènent, qui recomposent une existence, mais sans jamais offrir une solution de continuité ou un point de vue d'ensemble. Mais il ne s'agit pas simplement de se remémorer des événements de l'enfance, des circonstances qui ont laissé des traces profondes, mais aussi d'une méditation qui, souvent, reste en suspend : la phrase ne s'achève pas et laisse le lecteur volontairement dans l'expectative. C'est souvent drôle, parfois inquiétant, passant sans cesse du doux à l'amer, du genre James Ensor à la vanité des maîtres du siècle d'or hollandais, mais dans le genre Art Brut et débridé. C'est inclassable (et c'est très bien ainsi) et c'est un singulier chemin de croix intérieur, un questionnement face au temps qui passe inexorablement, une danse bouffonne de mort, des mémoires morcelées qui ne dissimule ni la peur, ni la douleur, ni des obsessions, ni rien d'ailleurs, sans jamais faire une faute de pudeur. En revanche, Julien Blaine ne perd jamais l'occasion de faire des fautes de goût, en bon rabelaisien qu'il est. Il ne veut pas se prendre trop au sérieux ni qu'on le prenne au sérieux - en dépit de la gravité de ces pages. Mais il n'en ai pas moins vrai que s'il n 'hésite jamais à faire de l'esprit (je veux dire : du mauvais esprit) et de jouer sur les mots (on ne se refait pas), c'est un ouvrage grave et touchant qu'il a composé et qui présente un autre aspect de son art poétique.

La Plage, Marie Nimier, Folio, 160 p., 5,90 euro.
Je n'avais jamais lu Marie Nimier. Et je crois que je ne vais pas renouveler l'expérience. Bien sûr, elle a un beau brin de plume et elle sait y faire. Mais ça, c'est de la technique, pas de l'art. Et de très loin. C'est de la fabrication, pas trop mal ficelée, mais pas plus. Le titre, en fait, dit tout de l'histoire : c'est une jeune femme, certainement belle et séduisante, qui décide de se baigner nue dans les eaux de l'océan. Elle croit être dans un recoin de l'île qui paraît absolument désert. Après son bain, elle découvre une grotte et, dedans un homme disons mûr et d'une stature imposante et une toute jeune fille. Elle n'ose tout d'abord pas les aborder. Elle se contente de leur voler une orange (tout un symbole !). Puis un dialogue s'instaure et elle apprend qu'il s'agit d'un père et de sa fille, qui a des problèmes psychologiques sérieux. Elle parle mal, mais notre héroïne (que l'auteur appelle « l'inconnue ») ne sait pas quelle opinion se faire car, parfois, elle ne semble souffrir de rien. Elle sait qu'elle attire cet homme robuste et finit par lui céder. L'acte consommé, père et fille ont disparu. Toute cette affaire se termine comme elle a commencée, en suspens. Elle ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Elle a beaucoup parlé de son père : il paraît que c'est ce que font les jeunes femmes dans ces circonstances. A vous de voir la pertinence de cette histoire qui n'en est une qu'à moitié. Oui, un petit roman de plage, vite lu et vite oublié.

Golem, Pierre Assouline, Folio, 272 p., 7,20 euro.
Le titre ce roman aurait pu faire croire que l'auteur avait décidé de prendre le relais de cette tradition de la littérature juive moderne de réécrire le célèbre histoire du Golem : I. B. Singer et Elie Wiesel en ont été les expressions les plus célèbres. Mais que nenni ! Il s'est emparé de ce nom qui est devenu universel grâce au roman de Gustav Meyrink pour appâter le lecteur. Il s'agit en réalité de l'histoire d'un célèbre joueur d'échecs, un grand maître international, qui a disparu tout d'un coup. Il aurait subi une opération esthétique qui l'aurait métamorphosé du tout au tout. L'auteur dit « golémisé ». Je n'aime pas beaucoup ce qualificatif qui ne retient de cette figure légendaire qu'un aspect extérieur -, une sorte de « waltdisneysisation » à la petite semaine. Le début du livre est trop lent, on s'y ennuie ferme. Et pourquoi avoir donné à son héros le nom de Gustave Meyer, ce linguiste allemand, qui a écrit des traités qui passent pour être remarquables sur la langue albanaise ? A moins qu'il ne s'agisse de l'autre nom adopté par Gustav Meyrink, Meier ? Cette quête aurait pu être passionnante si elle avait été écrite autrement. Ce n'est pas remarquablement écrit et c'est surtout fastidieux. Assouline a su nous captiver avec la plupart des biographies, presque toutes fort bien faites (Gallimard, Kahnweiler, Albert Londres, Camondo, Cartier-Bresson, etc.) et même ses Vies de Job, un roman, mais aussi une méditation théologique, n'étaient pas mal réussi. Il a un certain talent, mais il le galvaude parfois, pour les mauvaises raisons que l'on sait, un époque on l'on se contente de peu en littérature à condition de faire du bizarre. Alors la « golomisation », ça c'est franchement bizarre !

Le Secret de l'empereur, Amélie de Bourbon Parme, Folio, 368 p., 7,70 euro.
Il y a roman historique et roman historique ! Les uns sont de pures fantaisies, et servent de grands personnages du passé et d'un décor, d'une atmosphère, d'une situation (le meilleur exemple est Alexandre Dumas, avec les Trois mousquetaires, la Tulipe noire et tant d'autres). Les autres se veulent une sorte de reportage, rendu sous une forme romanesque (je pense à l'Adieu aux armes d'Hemingway, aux Réprouvés d'Ernst Von Salomon, à Orages d'acier d'Ernst Jünger, à L'Espoir de Malraux, maïs aussi une grande partie de l'oeuvre tragique de Shakespeare). Il y a enfin ceux qui remontent le cours du temps pour montrer une épopée prodigieuse ou une décadente inéluctable (Quatre-vingt-treize de Victor Hugo, la Marche de Radetzky ou la Crypte des capucins de Joseph Roth), qui sont avant tout une réflexion sur l'histoire et ses aléas tragiques. Et puis il y a ces romans qui tentent de reconstituer une période précise et de mettre en scène une grande figure pour tenter de la restituer dans ce qu'elle a de moins connue. C'est le cas ici de ce livre d'Amélie de bourbon Parme. Cela se situe entre le réel et l'imaginaire, mais l'imaginaire sert à déchiffrer le réel. Dans le Secret de l'empereur, elle part d'un événement qui demeure toujours mystérieux : la démission de Charles-Quint, qui a été l'homme le plus puissant de son époque, empereur du Saint empire romain germanique, mais aussi roi d'Espagne et de seize autres royaumes. Il cède l'Espagne et les Flandres à son fils Philippe II, même avant son renoncement, qui lieu en 1555, année de la mort de sa mère, Jeanne de Castille (cette disparition l'a beaucoup affecté, mais est-ce la cause de son geste, qu'on a attribué à certains revers ou à des maladies sérieuses ?), de et donne en héritage le reste à son frère Ferdinand. En 1656, Il se retire dans un monastère hiéronymite en Estrémadure, où il a passé les trois dernières années de sa vie. C'est-là, pendant ce laps de temps qui ne nous est quasiment pas connu, que l'auteur cherche de percer le mystère de cet homme. Elle le montre aux prises avec une passion qui est celle des instruments de mesure et tout particulièrement des horloges, et s'attache alors à forger le mécanisme très complexe d'une horloge noire, supposée résumer l'univers dans son mouvement d'araignée. En arrière-plan, se déroulent les conflits et les intrigues liés à sa succession. C'est très bien fait et plaisant à lire. Et cela donne envie de connaître le destin de cet empereur qui a renoncé à son trône après être arrivé au sommet de la puissance.

Vices chez les femmes, préface de Christophe Bier, « lectures amoureuses, La Musardine, 10,95 euro.
Cette anthologie réunit trois romans érotiques d'un genre bien particulier parus dans les années vingt et trente. La préface de Christophe Bier est vraiment intéressante car elle nous explique comment la littérature sado-masochiste s'est développée depuis la fin du XIXe siècle avec sept cents à huit titres jusqu'au début de la dernière guerre. Il nous apprend comment un homme entreprenant dans le commerce de l'érotisme, Victor Vidal, a mis sur pied une maison d'édition et une chaine de magasins pour distribuer ces ouvrages et divers accessoires. Il nous rappelle aussi que de grands écrivains comme Hughes Rebell, Pierre Mac Orlan, Gustave Le Rouge, ont publié sous leur nom des ouvrages salaces. Il a choisi de nous faire découvrir trois romans, qui ont sans aucun doute été publiés sous des pseudonymes. Ils sont tous les trois écrits de manière correcte et sans doute les oeuvres d'un auteur désargenté (ce qui se passera plus tard avec Olympia Press à Paris). Le premier s'intitule Les Egarements d'un asservi signé par Lady Olympia ( !), qui raconte les expériences et les mésaventures d'un homme fortuné et de très bonne condition, M. Brot-Gillières, qui ne trouve plus de plaisir que dans une relation sado-masochiste. Le second est plus exotique : il a pour titre Vice secret chez les femmes, que l'on doit à un énigmatique Xavier d'Estranges. Il nous narre la vie cachée d'une comtesse russe qui aurait participé à la Révolution de 1917, Maria Stevenoff, qui ne sort jamais de son château où elle mène un train licencieux. Enfin, les Caresses infernales, dues à J. Van Styk est l'histoire d'une princesse orientale qui se livre sans retenue à ses fantasmes sans bornes. Le tout constitue un document sur cette littérature du second rayon qui, dans ce cas, se montre beaucoup plus « technique « que franchement érotique : les situations doivent être décrites par le menue et ne peuvent donc pas laissé une place si libre que cela à la pure imagination.
|
