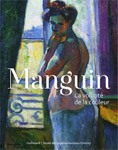
Manguin, la volupté de la couleur, sous la direction de Marina Feretti Bocquuillon, musée des impressionnismes, Giverny / Gallimard, 160 p., 29 euro.
Henri Manguin (1874-1949) fait partie de ces fauves qui ont été maltraités par la postérité. Ce n'est pas tant que l'ombre de Matisse leur a nui, mais plutôt une conception de l'histoire de l'art qui ne reconnaît que des écoles et leurs chefs de file. Les autres sont traités avec mépris, dépréciés ou sont tout bonnement ignorés. Manguin a fréquenté Matisse et Marquet très tôt, à l'Ecole des Arts décoratifs en 1892. Puis comme lui, mais aussi comme Marquet. Comme eux, il entre au sein de l'atelier de Gustave Moreau à l'Ecole des Beaux-arts en 1894. C'est aussi à cette époque qu'il se lie avec Valtat et Charles Camoin. Par la suite il reste proche de Matisse et c'est tout naturellement qu'il va lui emboîter le pas dans l'aventure du fauvisme. Très vite, Manguin avait fait preuve de belles dispositions, s'inspirant de Fantin-Latour pour ses natures mortes, de Boudin et des Nabis pour scènes de plage. Il ne passe par l'expérience du postimpressionnisme comme son aîné. Mais il évolue très vite dans le sens de la couleur la plus libre comme le prouvent ses oeuvres des années de 1902 à 1905 (il suffit par exemple de s'arrêter devant Jeanne en chemise, 1905). Il est de ceux que Louis Vauxcelles qualifie de fauves en cage du Salon d'Automne de 1905 que le critique qualifie « d'orgie de tons purs ». Manguin est lancé par ce scandale, d'autant plus qu'il avait pu présenter sept toiles. . Il est présent dans les expositions de groupe de la galerie Berthe Weill et est invité en 1907 à l'exposition itinérante en Allemagne organisée par Rudolf Meyer, « Französicher Künstler ». Leo Stein lui achète des toiles et Ambroise Vollard d'intéresse à lui et le défend à partir de 1906. Morozov lui achète un tableau en 1907. Il est toujours très proche de Matisse, qu'il voit souvent et continue à exposer au Salon d'Automne et au Salon des Indépendants. Il est invité à La Libre Esthétique à Bruxelles en 1909 et Gaston Gallimard achète plusieurs oeuvres pour les offrir à son père en 19110. Il a une grande exposition personnelle chez Druet au printemps de cette année-là. Le grand critique anglais Roger Fry l'a remarqué et l'a invité à sa grande exposition aux Grafton Galleries de Londres (« Manet and the Post-Impressionists »). Une seconde exposition personnelle à la galerie Druet a lieu en 1913. Le déclin de Manguin commence en 1914 à cause de la maladie puis du décès de sa mère, puis de la mobilisation générale. Son étoile pâlit peu à peu. Il a toujours les mêmes relations amicales avec ses vieux camarades du fauvisme (il reste très ami de Marquet), s'en est fait d'autres, comme Félix Vallotton, mais il s'écarte des courants à la mode, de l'esprit de l'Ecole de Paris et demeure désormais un vieux fauve assagi, mais non dépourvu de talent. Ce catalogue ne présente que la première partie de son oeuvre (jusqu'à la Grande Guerre). Mais cela est déjà beaucoup pour redécouvrir les vertus de cet artiste tombé dans les oubliettes depuis longtemps.

André Masson, la sculpture retrouvée, Musée de l'Hospice de Saint Roch, Issoudin, Patrice Lepage, 96 p., 25 euro.
C'est là une exposition qui s'imposait. D'autant plus que l'édition de la plupart e ces sculptures en bronze avait fait l'objet de polémiques absurdes. Ces oeuvres avaient été dessinées par l'artiste au milieu des années 1940 (seul Saturne a été conçu au milieu des années 1960 et il faut ne pas oublier la page de dessins de sculptures réalisée en 1938), à New York. Mais il ne s'en est rien fait. Et de retour en France, ou il l'oublia, ou personne ne s'est présenté pour les fondre. Finalement, c'est un marchand d'art italien, qui avait sa galerie à Rome, qui a pris l'initiative de les faire couler. Masson était très âgé alors, mais encore conscient ! Il avait décidé de relancer Masson, non seulement en Italie, mais dans toute l'Europe, ce qui d'ailleurs a eu de l'effet. Mais en dehors du fait qu'on peut contempler l'ensemble de ses créations sculpturales, on peut voir à l'Hospice de nombreux dessins et tableaux où figure une sculpture. C'est fait avec intelligence, car on se rend compte que son monde n'est certes pas comme celui de Giorgio De Chirico, mais présente quelque chose de commun avec ce dernier de ce point de vue. Il y a des sculptures au sens propre et aussi des constructions en volume qui aurait pu être transformée en sculptures. Enfin, il ya des motifs qu'il a repris dans ses bronzes. Je remarque aussi, surtout dans ses dessins de la fin des années 194, mais parfois plus tard, des liens avec Dalì. Ils ne sont pas étroits, mais tout de même, ils existent. En dehors de l'aspect spécifique de cette manifestation et de son beau catalogue, tout un chacun est amené revoir l'entreprise esthétique de Masson avec un autre regard -, et moi le premier. Ce serait une bonne chose si cette exposition pouvait circuler car c'est vraiment une réussite. Sinon, le livre fera le travail, mais ce n'est pas la même chose !

Tour du monde en tondo, Musée de l'Hospice de Saint-Roch, 128 p., 20 euro.
Cela ne fait aucun doute possible : c'est une belle idée d'exposition. Je ne parlerai pas des contemporains car c'est le choix du commissaire et je n'ai pas à en discuter n'ayant pas vu l'exposition, n'ayant en main que le catalogue). En revanche, il y a beaucoup d'exemples qui sont vraiment intéressants, comme le Bain turc d'Ingres : comme cela est identique dans la notice, le tableau, sur lequel le peintre a travaillé près de cinquante ans, était rectangulaire. Il l'est toujours. Mais comme le sujet paru scabreux en 1863, on lui imposa un cadre rond, cause des poses lascives et des caresses jugées osées des hétaïres , qui est resté tel quel au Louvre. Ce genre de tableau circulaire a existé Rome (tondo severiano) et donc sans doute en Grèce. C'est pendant la Renaissance italienne qu'il a retrouvé ses lettres de noblesse avec Fra Angelico (ou Lippi), Sandro Botticelli, Jacopo Pontormo e le tondo Donati de Michel-Ange. Mais son usage est par la suite lié à des situations architectoniques, et pas nécessairement à la volonté de l'artiste. Ici, on a un très bel (et rare) exemple d'un tondo peint par Claude Monet. Il existe deux petits tondi de la main de Paul Gauguin et j'en ai découvert la raison : Vincent Van Gogh était très ami de la propriétaire du café du Tambourin, sur le boulevard des Batignolles, une Italienne, qui avait décoré la salle de tambourins. Un beau jour, elle a demandé à l'artiste d'organiser pour elle une exposition avec des oeuvres de lui et de ses amis. On sait qu'Anquetin et que Gauguin ont participé cette modeste manifestation. C'est une curiosité que vous retrouverez dans mon livre sur les Cafés littéraires, mais repérée par aucun spécialiste de cet artiste ! Quant à la belle Tête byzantine d'Alfons Mucha, elle est inspiré par les culs de lampe car Mucha, l'époque de cette lithographie (1897) se consacrait plus à la décoration et l'illustration qu'à la peinture. C'est en fait au début du siècle dernier que les peintres se mettent utiliser le tondo comme le montre l'oeuvre de Braque, celle de Delaunay ou encore celle de Kandinsky. On voit aussi une Madone (1937) de Tamara de Lempicka. Le plafond de l'Opéra Garnier de Marc Chagall n'est pas un tondo à proprement parler. Mais cela rappelle que beaucoup d'artistes du passé ont fait de grandes compositions ovales ou rondes pour les plafonds. Voilà par conséquent un beau motif de méditation sur une forme picturale qui est devenu désormais un thème !

A propos de Nice, 1947-1977, MAMAC / Les Ponchettes / Le 109 / Somogy Editions d'Art, 200 p., 25 euro.
Ce riche catalogue constitue une somme sur tout ce qui s'est fait à Nice dans l'après-guerre (trois décennies). Cela aurait dû être fait depuis longtemps. Hélène Guénin et Rébecca François se sont interrogées dans leur essai sur le terme d' « Ecole de Nice et elle ont eu raison. Et cela pose d'ailleurs le problème du terme « école » pour l'art : l'école de Paris, avant la guerre, a rassemblé des artistes hétérogènes, qui faisaient des choses bien différentes les uns des autres ; leur point commun était d'être en majorité des étrangers travaillant dans une optique figurative venus travailler à Paris (Soutine, Modigliani, Pascin, Orloff, Zadkine, Pascin, etc.). Celle de l'après-guerre a mis dans un même sac des artistes abstraits ; mais quel rapport entre Wols, Schneider, Bitran, Soulages, Michaux, Matthieu et Marfaing, pour ne citer qu'eux) ? C'est une façon de situer une certaine situation esthétique. Le plus amusant est qu'il y a eu dès 1967 des expositions, à Nice et à Vence qui se sont intitulées « Ecole de Nice ? » ou sinon les mots étaient imprimés à l'envers. Tous les artistes de cette période ont fini par accepter cette terminologie, qui ne recouvre au fond que des réalités très différentes. Il n'y a que le bouffon de Ben qui finit par prendre la chose au sérieux et qui a affirmé : « Le créateur de l'école de Nice, c'est moi. » Il y a joué un rôle qui est important, avec l'introduction de l'esprit Fluxus, la réalisation de nombreuses performances, sa boutique de disques, la publication de la revue Tout, et j'en passe. On pourrait remonter dans le temps et dire que c'est Matisse qui l'a fondée (il y a longtemps travaillé et y est mort en 1954). On pourrait dure que ce fut la rencontre de Yves Klein et d'Arman en 1954. Mais ce serait histoire de marquer un point de départ symbolique car cette prétendue école recouvre plusieurs réalités. Celle du Nouveau Réalisme (qui, déjà, sous la houlette de Pierre Restany, recouvre plusieurs pratiques peu compatibles !), celle de Ben, qui a adapté des pratiques déjà existantes aux Etats-Unis et en Allemagne et les a importés, et à la fin des années soixante, le groupe Supports/surfaces (voir l'article d'Anna Dezeuze) est composé exclusivement alors de méridionaux (Dolla, Pagès, Viallat, Saytour, Valensi, Dezeuze) entre autres). Tout cela nous permet de comprendre que Paris a engendré alors un grand lieu alternatif où se sont joué des moments conséquents de l'art contemporain, déjà passé à l'histoire, sans point d'interrogation.

La Guerre de Jugurtha, Salluste, traduit du latin par Nicolas Guillon, Allia, 142 p., 10 euro.
Je connais peu de monde qui se dit un bon matin : tien, je viens de finir un bon roman, que vais-je lire ? Je vais prendre un ouvrage de Salluste. Et pourtant, je découvre (sur le tard) le merveilleux écrivain qu'il a été en plus du grand historien latin. Salluste (85 - vers 35 avant notre ère), d'origine sans doute sabine, il a été questeur, puis tribun de la plèbe, soutien du parti des populares contre l'oligarchie des optimates. Il a été l'ennemi juré de Cicéron (il aurait écrit un pamphlet contre lui, hélas disparu) et était l'ami de César. Il combat contre les troupes de pompée en Illyrie est vaincu en 49 avant notre ère. Prêteur, il accompagne César en Afrique qui le nomme gouverneur de la province de Numidie (46-44). L'assassinat de César le fait renoncer à la politique, se consacrant à la rédaction d'une monumentale Histoire romaine en grande partie perdue. Cette Guerre de Jugurtha est l'un des deux seuls ouvrages qui nous soient parvenus complets de sa main. Cet épisode à affaire avec la Numidie. Jugurtha était le roi de ce pays. Il avait combattu avec les Romains à Numance, en Espagne. Il y relate la guerre qu'il a menée contre Rome entre 112 et 105 et sa défaite après bien des revirements de la fortune des armes. Salluste se montre très pointilleux sur les détails historiques, explique le contexte, rappelle quelle a été l'histoire de cette partie de l'Afrique après la dernière guerre punique, parfois même sa géographie, son climat, ses ressources, ses richesses, ses populations, un peu à la manière d'Hérodote, mais avec plus de concision. Il se rapproche d'une relative objectivité, bien qu'on comprend qu'il a des sentiments républicains tout en critiquant le système oligarchique. Avec lui, on comprend comment le Sénat romain se penchait sur les problèmes et avait de virulentes discussions. Il montre aussi que beaucoup de sénateurs étaient corruptibles ; d'ailleurs, Jugurtha a tenté de soudoyer un certain nombre d'entre eux pour qu'ils plaident sa cause. Les épisodes complexes, les causes et les implications de cette guerre sont aussi le reflet de la politique romaine d'alors. Tout cela est narré avec un style limpide et un esprit agile et passionnant. Cette longue reconstitution historique se lit comme un roman palpitant. D'autres historiens romains, de Suétone à Dion Cassius, ont retenu la leçon de Salluste, en dehors du fait qu'ils semblent avoir pris beaucoup plus de liberté avec la réalité des faits ! Vous ne connaissez pas la guerre de Numidie ? Moi non plus. Mais telle que l'auteur la remémore, c'est un roman palpitant et qui nous apprend mille choses sur ces événements, mais aussi sur les moeurs et la politique de l'époque cette expédition, et aussi de cette phase cruciale de la Rome républicaine vivant ses dernières années quand Salluste a pris la plume.

Soleil Couchant, Ozamu Dasai, traduit du japonais par Didier Chiche, Les Belles Lettres, 170 p., 23 euro.
Lorsque que j'ai lu ce roman il y a bien longtemps, j'avais été frappé par son étrangeté, car il a été conçu dans une optique assez peu conforme à l'idée qu'on pouvait se faire d'un roman à l'époque où il a été écrit (1947). Ce fut la dernière oeuvre de cet écrivain lui-même étrange. Ozamu Dasai (1909-1948), de son vrai nom Tsushima Shuji, a eu une existence extravagante. . Dans sa jeunesse, il s'est déclaré disciple d'Akutawa Ryûnosuke. Quand ce dernier a tenté de se suicider en 1927, cela a bouleversé sa vie et s'est adonné à l'alcool et à la débauche. Deux ans plus tard, il a tenté de se suicider en se noyant avec une femme presque inconnue. Il en a réchappé. En 1929, il épouse une geisha et ce qui lui a valu d'être renié par sa famille (son père siégeait à la chambre des pairs). Il s'est depuis consacré à la littérature et a choisi son nom de plume. Il a commencé à publier en 1933, des nouvelles et puis des romans, dont les Dernières années en 1935. IL tenta alors de nouveau de donner la mort après une succession d'échecs et échoua de nouveau. Il se mit à consommer de la morphine et a dû se désintoxiquer. Pendant sa cure, sa femme l'a trompé, ce qui le conduisit une fois encore à se suicider avec sa femme. Ils finirent par divorcer. Il a beaucoup écrit pendant les années 1930 et a commencé à être reconnu. Pendant la guerre, il écrit beaucoup de contes et, après la capitulation, il décrit les métamorphoses du Japon vaincu. Il avait baptisé sa demeure « La maison du soleil couchant ». Dans ce superbe livre, il dépeint la vie d'une famille de la bonne société, qui doit quitté Tokyo après sa destruction presque totale. C'est une femme encore jeune, mais toujours pas mariée, Kazuko, qui raconte la vie qu'elle mène à Tokyo avec sa mère. Elle fait une description des manières de table de sa mère, qui est une merveille, puisqu'elle dit tout de leur statut social. Les deux femmes vont déménager et aller en dehors de la capitale. Sa mère a été souffrante et elle est affligée par la disparition de son fils, Naoji, porté disparu au combat. Kazuko est tourmentée par son avenir. Elle finit par avoir une relation étrange avec un peintre, Uehara, dissolu et alcoolique. Sur ces entrefaites Naoji revient. Il est dépendant de la morphine et ne sait trop que faire de sa vie. A la fin, il rédige une longue lettre où il explique les raisons pour lesquelles il met fin ses jours. C'est le livre qui a été » l'expression de la décadence du Japon, dans le sens de Spengler. Mais aussi dans celui d'un effondrement des valeurs et d'un existentialisme noir. C'est écrit de manière magnifique.

Le Sourire du Tao, Lawrence Durrell, traduit de l'anglais par Paule Guivarch, « L'Imaginaire », Gallimard, 136 p., 6,50 euro.
Les pensées traditionnelles de l'Orient donnent souvent lieu, en Occident, à des interprétations mielleuses et d'une déconcertante naïveté. Avec ce court essai, l'auteur du Quatuor d'Alexandrie, ne cherche pas à nous administrer une leçon de sagesse ou d'introspection fondée sur d'incompréhensibles formules rédigées par les grands maîtres du passé. Il s'est efforcé de montrer comment ces idéaux divulgués par le taoïsme peuvent se traduire dans nos termes et selon notre sensibilité. Il n'en vulgarise pas les orientations, mais cherche à rendre les tangibles avec nos mots et notre manière de réfléchir le monde et l'être humain. On est émerveillé par la simplicité de ses exposés, par leur limpidité, leur intelligence, et aussi par leur saveur particulière. Au bout du compte, l'écrivain a trouvé dans le taoïsme la meilleure illustration e ses propres méditations, désirs et aspirations. C'est d'abord une critique de nos philosophies et de nos crédos religieux, et un plaidoyer en faveur d'un univers poétique (une utopie qu'il croit réalisable, au moins à l'échelle de l'individu). C'est le premier livre qui ne soit pas l'oeuvre d'un savant sur cette question que j'ai trouvé passionnant. Lawrence Durrell n'enjolive rien, n'extrapole rien et expose avec intelligence de quelle façon il peut s'approprier une conception du monde si lointaine et la faire sienne sans jamais tomber dans les traquenards de l'angélisme béat.

Méditation sur la technique, José Ortega y Gasset, traduit de l'espagnol par David Uzal, Allia, 128 p., 10 euro.
Les essais d'Ortega y Gasset sont toujours passionnants. Celui-ci de manière toute particulière car il concerne une question qui ne lui est pas familière. La technique, dans les conférences y réunies, est d'abord examinée de deux points de vue opposés : celui de la nécessité primaire du genre humain, et puis celle de notre civilisation, qui a élevé la technologie à un degré superlatif. Il se retourne vers le passé et déclare que la technique ne concernait pas les universités du Moyen Age. Ce qui n'est pas tout à fait exact, si les métiers n'étaient pas enseignés, cela va sans dire, l'architecture et les textes anciens, comme les traités de Vitruve l'étaient. Mais peu importe. Il se rapproche du coeur du problème par cercle concentrique : il constate d'abord que la résolution des problèmes naturels se résout par des procédés qui ne le sont pas. Il constate ensuite que cette recherche de l'homme englobe très vite le nécessaire et le superflu. Cette méditation se prolonge par un autre constat : l'idée que ces satisfactions résultent d'un moindre effort. En fait, les techniques ont progressé dans ces deux sens. Ce qui le fait regarder l'homme comme été un cas programmatique il est en tout cas en décalage avec la nature, et le besoin est associé au désir. L'auteur considère qu'il y a en son temps (1933 pour ce texte) une crise de la technique par rapport à son désir. Et il prend plusieurs exemples d'attitudes humaines, comme l'homme transcendantal (le Tibétain), le gentleman, l'Hidalgo. Il conclue son étude par une tentative de définition et par de possibles perspectives. Il est loin d'épuiser le sujet. Et ce n'a pas été son but. Mais il a eu le mérite d'offrir des moyens efficaces (des techniques intellectuelles !) pour mieux comprendre comment aborder le rapport de l'homme et de la technique.

Histoire artistique des ordres mendiants, Louis Gillet, préface de , « Les Mondes de l'art », Klincsieck, 272 p., 25 euro.
On a bien oublié qui était Louis Gillet (1876-1943), historien et critique de la littérature et des arts, influencé grandement par Emile Mâle, disciple de Bernard Berenson, auteurs de monographies sur Raphaël, Watteau et Monet, qui a publié une Stèle pour James Joyce en 1941. Il existait encore comme référence quand je faisais mes études universitaires, puis il est tombé dans l'oubli. C'est donc une excellente idée que de rééditer une de ses oeuvres maîtresses, parue en 1912. Cette Histoire artistique des ordres mendiants est fondamentale pour comprendre la mutation qui s'est produite dans l'art religieux à partir du XIIIe siècle. Cette étude est le fruit d'un esprit à la fois passionné par l'art (il vouait à L'Italie et à sa patrimoine un amour sans borne) et par la religion (c'était un fervent catholique).Il raconte d'abord l'histoire de saint François et de son ordre mendiant. Il résume cette histoire avec sagacité, mais n'insiste pas assez sur le fait que l'avènement de cet ordre a correspondu à une mutation fondamentale de l'âge médiéval : les villes l'emportent sur le monde rural et la vie monastique, tout comme l'art roman, était lié à cette existence campagnarde. Les ordres mendiants qui sont apparus avec François et Dominique sont plus spécifiquement urbains. Il explique fort bien que la mendicité n'était pas pour eux une valeur, mais une nécessité car ils n'avaient pas de terres à faire fructifier. Leur expansion est étroitement associée à l'introduction dans toute l'Europe de l'art gothique. La basilique d'Assise, qui n'est pas l'oeuvre d'un énigmatique Jacques l'Allemand (sans doute à cause du terme gothique dérivé de Goth), mais d'un architecte italien. Et elle est aussi accompagnée d'une grande transformation dans les arts plastiques. Giotto en est l'expression la plus spectaculaire. L'ordre cistercien, par exemple, n'acceptait que des peintures décoratives, souvent sobres et géométriques, sans la moindre figuration. En général, la sculpture l'emportait sur la peinture, même dans des ordres moins rigoristes, comme celui de Suger de Saint-Denis, qui semble avoir été le premier à avoir eu recours à l'architecture gothique. Quoi qu'il en soit, les Franciscains et les Dominicains ont beaucoup contribué, jusqu'au XVIIe siècle, à l'épanouissement de l'art religieux . Bien sûr, la thèse de l'auteur mériterait bien des corrections. Elle ne prend pas assez en ligne de compte que la fin du Moyen Age et la Renaissance ont été marquées par la volonté des communes autant que par celle de l'Eglise. Mais elle reste toujours utile pour comprendre ce développement extraordinaire de l'art occidental.
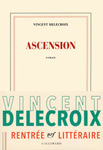
Ascension, Vincent Delecroix, Gallimard, 634 p., 24,50 euro.
En lisant ce livre sans fin, on a l'impression qu'une génération entière de romanciers français veulent à tout prix égaler Léon Tolstoï ou James Joyce. Vincent Delecroix semble avoir désiré accomplir un record marathonien. Six cents pages, tout de même ! De quoi s'agit-il ? D'une énième mission fans l'espace pour rejoindre la navette internationale. L'un des membres de cette nouvelle équipe est juif. L'intéressé, Chaïm (ou Beth) s'en étonne grandement car l'officier supérieur qui dirige cette opération, le commandant Harold Pointdexter, est un antisémite enragé. Cette interrogation traverse une bonne partie de l'ouvrage, avec des hypothèses de réponses plus ou moins hasardeuses. Au début (pendant plus de cinquante pages !), il ne se passe pas grand chose en dehors des préparatifs du départ. Peu à peu, à part quelques dialogues plus explicites qui éclairent le personnage principal et la situation dans laquelle il se retrouve, on est confronté à un récit qui est un monologue intérieur des plus picaresques. Il y a quelques moments heureux et intéressants, mais, à mon grand dam, trop d'excursus, de parenthèses et de divagations qui font tourner la tête et qui n'apportent pas vraiment d'éléments assez intéressants pour soutenir l'attention. C'est verbeux à en mourir. A croire que l'art romanesque se juge désormais au poids ! Gallimard est pourtant le principal éditeur de Patrick Modiano, qui est un auteur concis mais qui ouvre mille portes narratives enchanteresses. Ici, c'est la lassitude et l'épuisement qui prennent le dessus. Dommage car Vincent Delecroix n'est pas dépourvu de talent et d'esprit. Il faut absolument qu'il change de registre et qu'il nous épargne cet amoncellement effrayant de mots.

Jeune homme, Karl Ove Knausgaard, traduit du norvégien par Marie-Pierre Piquet, Folio, 8,20 euro.
Ce n'est pas un mauvais roman et loin. Sans doute la pente psychologique choisit par l'auteur n'est pas celle que je privilégie. Mais il a su relater avec assez de délicatesse et de subtilité pour que cette histoire ne soit pas insipide ou simpliste. Il entretient une ambiguïté car le héros porte le même prénom que lui. Mais au fond, comme nous ne connaissons l'écrivain scandinave, cela n'a guère d'importance. Tout est fait avec maîtrise et un sens profond de la narration, avec des dialogues vifs et crédibles. Rien n'est forcé. Le seul défaut que je pourrais lui trouver est d'avoir trop recherché le réalisme. Ce volume fait d'ailleurs suite à deux premiers livres, où Knausgaard remonte dans le temps de la vie de ce jeune garçon. Autobiographique ou non, ce roman est assez remarquable dans ce genre que je goûte peu. Mais ce n'est Knut Hansum et encore moins August Strinberg ! Toute son énergie s'est concentrée sur la volonté de faire un portrait jusque dans les plus infimes détail de l'adolescent Karl Ove, au détriment de ce que devrait être une oeuvre d'imagination. On le lit comme un rapport détaillé, entre le médical et le judiciaire, d'une facture naturaliste, sur la vie publique et intime d'un garçon qui passe à l'adolescence et s'apprête à entrer dans le monde adulte. Mais il lui manque la fantaisie et l'invention, et aussi la création d'une facture originale de son ouvrage. Mais d'autres que moi, plus sensible à cette façon de considérer les choses, l'apprécieront car il a au moins le grand mérite d'être très bien façonné.

Abraham et fils, Martin Winckler, Folio, 544 p., 8,20 euro.
C'est là un roman très conventionnel, mais qui n'est pas mal échafaudé et assez intéressant. C'est l'histoire d'un père Abraham Farkas, un de ses nombreux Pieds noirs rentrés en France contrains et forcés au moment de l'indépendance de l'Algérie, et de son fils Franz. Ce dernier est amnésique. Abraham Farkas est médecin et parvient à trouver un cabinet qui s'est libéré dans une petite ville, Tilliers. Contrairement à ce à quoi il s'attendait, il a une clientèle nombreuse. Cela l'empêché de bien s'occuper de son fils. Il se met en chasse d'une assistante, qui aura aussi pour tâche de l'aider dans son travail, mais aussi de s'occuper du gamin. Il trouve la perle rare en la personne de personne de Claire Délisse. Mais l'essentiel de l'histoire tourne autour de la relation du père et du fils, et ensuite de la conquête par le jeune Franz d'une autre mémoire par la lecture des livres. Bien sûr, le tout s'étire un peu en longueur, il y a un peu trop d'angélisme et le petit monde autour du médecin est décrit avec trop de réalisme. Enfin, il y a beaucoup trop d'épisodes secondaires, qui n'apportent pas grand chose au récit. Malgré ces défauts, Abraham et fils est un roman qui a son charme et sa vérité. La manière dont Martin Winckler raconte cette histoire est intelligente et crédible. Pour ce qui me concerne, cet excès de réalisme là où l'un des centres de gravité est l'imaginaire, ne me plaît pas beaucoup. Mais je suis persuadé que d'autres sauront l'apprécier car il est d'une qualité irréfutable.

L'Homme-joie, Christian Bobin, Folio, 176 p., 6,80 euro.
D'aucuns portent aux nues la littérature de Christian Bobin, d'autres l'exècrent. Je ne fais partie ni de l'un ni de l'autre camp. Ce livre est assez particulier, car il y pose. On est même surpris qu'il n'ait pas envoyé un portrait dédicacé, comme cela se faisait encore au début du siècle dernier ! On a des pages de sa main reproduites. Autre coquetterie. Mais il ne dit pas des choses profondes comme Paul Valéry et n'a pas la plume vibrante de D'Annunzio. Les premières pages sur le thème du bleu sont assez plaisantes et même charmante, mais ce qu'il écrit sur la peinture de Soulages n'est pas d'une puissance telle à nous transporter. Il a un style, avec ses petites phrases bien tournées, ses petites notations astucieusement ficelées et sagaces. Il a quelque chose de particulier, mais il n'a pas le charme un peu illusoire de Jean Cocteau. C'est un peu une sorte de superbe meringue, très sobre dans sa forme, avec une belle consistance, mais un goût ni mer, ni acidulé. Et peu de corps. Je ne dis pas fade car il y a une belle tension dans son écriture. Quoi qu'il en soi, je n'arrive pas à formuler ce que j'en pense vraiment Et si j'aime vraiment. C'est plaisant, agréable et un peu aulique, un peu lyrique, un peu insipide, malgré ses efforts à jouer aux grand maître dont on recueille avec piété et admiration les autographes Oui, il y a du Cocteau là-dedans, pas dans le style, mais dans la manière de faire artiste et du Bonnefoy en recopiant ses phrases comme s'il s'agissait de pensées à gravées dans le marbre pour la postérité. Mais je dois reconnaître la dextérité, la bella mano, le ton, le caractère et surtout le fait qu'il est au-dessus de beaucoup de ses confrères. Mais est-ce suffisant pour me séduire. A voir. Et à méditer.
Montagne-Eau, Caroline Munheim, galerie Apero, Edition Villa Saint-Clair, s. p.
Après la neige, Caroline Munheim, tribew (livre numérique).
Caroline Munheim ne fait pas beaucoup parler d'elle. Par timidité ? Par goût du secret ? Je l'ignore. Ce que je sais en revanche c'est qu'elle mène une oeuvre tout à fait à la hauteur du meilleur de ce que l'art contemporain peut offrir. Elle utilise plusieurs médiums : le dessin, le collage (tout cela sur papier) et la photographie. Commençons par cette dernière technique très prisée par les créateurs de notre temps. En fait, elle compose des natures mortes, mais très éloignées de celles des peintres hollandais du XVIIe siècle. Et pourtant il y a un lien, qui n'est pas iconographique (des tréteaux qui servent de porte-serviettes n'ont pas d'immenses points communs avec les cuisines du Siècle d'or ou les grands trophées de chasses comme les peignaient les Van Loo ! Et pourtant, c'est un monde suspendu, qui prend une autre dimension que sa réalité triviale. Ces serviettes froissées et posées sur une table à côté d e pierres en forme d'oeuf, voilà une offre façon d'interroger le spectateur comme le faisaient les maîtres d'autrefois. Elle navigue très bien entre ces vestiges d'un passé glorieux et les hypothèses plastiques d'un présent hasardeux. Mais son univers n'est pas si statique qu'il le paraît : son texte intitulé Rebours, qui n'est un poème à proprement parler, mais une énumération de figures, d'événements, de faits, qui finissent par dessiner les contours d'une femme qui ne serait plus dans la peau qu'on souhaite lui voir porter. Ce livre est révélateur de sa façon de voir les choses ! (Editeur : [Ce que je vois, 2014)]. Sa démarche a un aspect un peu obsessionnel, mais à la manière des collectionneurs. On le remarque dans ses beaux collages, qui sont fabriqués à partir d'une seule et même élément, qui remplit l'espace d'une feuille selon un dispositif de son agrément. Quant à ses dessins, ils sont d'une grande finesse : Ce sont a priori de fines tiges placées en parallèle, mais elles deviennent abstraites, comme un sentiment exprimé par un peintre zen. Si vous voulez découvrir son univers intérieur, regarder son livre qui un e-book que vous pourrez trouver sur internet en joignant la maison d'édition www.tribewcom. C'est le résumé très bien mis en page de ses dernières spéculations plastiques. C'est un artiste à découvrir, et je ne me paie pas de mots. Sa toute dernière exposition au Jeune Théâtre National (rue des Lions-Saint-Paul à Paris) a permis à tout un chacun de prendre la mesure de sa valeur et de sa poésie énigmatique.

Le Massacre des Innocents, sous la direction de Pierre Rosenberg, Domaine de Chantilly / Flammarion, 192 p., 45 euro.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me demande (une fois de plus) pourquoi une exposition d'art ancien (il s'agit dans le cas présent de Nicolas Poussin), les conservateurs se croient obligé d'ajouter des compositions contemporaines, le meilleur voisinant avec le pire ! C'est devenu une sorte de maladie française, alors que nous avons des musées et des centres d'art à cet effet. Je referme la parenthèse. Tout tourne autour de la restauration du célèbre tableau de Poussin, Le Massacre des innocents (1665), qui est considéré comme une de ses oeuvres majeures. Notre mémoire nous joue des tours : quand on pense à Poussin, on a en tête des images pastorales tout à fait poétiques et paisibles. Or Poussin, on l'avait vu lors de la grande rétrospective du Grand Palais, a peint de grands tableaux religieux où, forcément, l'on peut découvrir des scènes très violentes, avec la vie des saints martyres ou même des scènes tirées de l'histoire romaine, comme la mort de Germanicus. Et ce sujet est souvent traité depuis la fin du Moyen Age, avec des compositions signées par Giusto Fiamingo, Brueghel l'ancien, Arcimboldo, Raphaël, Massimo Stazione, Marantonio Raimondi, Carolis Schut, Cornelis van Haarlem -, la liste est très longue, ce qui signifie que les commanditaires ecclésiastiques étaient très friand de cet épisode du Nouveau Testament. Cela a duré jusqu'au XVIIIe siècle, après quoi, ce sont d'autres massacres qui ont séduit les peintres, de plus en plus libres de leurs sujets. Puisqu'on a jugé bon de mettre en regard de Poussin Pablo Picasso et Francis Bacon, je tiens à souligner que Guernica a été une commandé par la République espagnole au grand artiste pour placer cette grande composition dans son pavillon à l'Exposition universelle de Paris. Le Charnier, qui est aussi une très belle oeuvre a été la contribution à la mémoire des victimes de la guerre mondiale, qui n'avait pas de destination précise. Quant à Bacon, le lien est assez mince, car il n'a jamais peint qu'une célèbre Crucifixion. Ses toiles sont hantées par l'idée de la chair sanglante et décomposée. Mais point de massacres et encore moins d'innocents. Quoi qu'il en soit, je pense que prendre un thème de la peinture profane ou religieuse est une excellente chose, car on peut ainsi comprendre comment il a pu avoir un moment de gloire et puis un déclin et quels ont été les artistes qui ont éprouvé de la passion à le traiter. Donc le lecteur pourra tirer un grand profit de ce catalogue.

La Cathédrale de Mende, commanditaires et bâtisseurs, collectif, Somogy Editions d'Art, 216 p., 30 euro.
Je ne connais pas Mende et donc je ne sais rien de sa cathédrale. Ce colloque, qui s'est transformé en beau livre d'art, permet de découvrir ce bâtiment superbe et son histoire. C'et le pape Urbain V, en plein déchirement de l'Eglise entre Rome et Avignon, qui décide de faire édifier ce bâtiment au milieu du XIVe siècle à la place d'une basilique funéraire du XIe siècle. On peut encore voir à l'intérieur les armes de ce grand seigneur de la région. Ce qui est vraiment intéressant dans ce livre, c'est que les auteurs ne se contentent pas de décrire ce lieu et d'y faire l'inventaire de ses trésors de sculptures ou d'objets religieux. On y apprend l'essentiel de ce qui a permis sa construction, comment les travaux se sont déroulés après la disparition de son fondateur, qui ont été les hommes qui l'ont élaboré comme architectes ou sculpteurs, de quelle façon elle s'est en partie transformée au cours des ans. On peut donc considérer ces pages comme un apprentissage en coupe réglée de ce qu'a pu être l'aventure qu'a représenté la mise en oeuvre de tels édifices, dont l'ampleur et l'audace nous surprennent encore aujourd'hui, en plus de leur beauté plastique. Il est rare de découvrir une cathédrale tout à fait homogène déjà dans sa façade et encore plus dans ses aménagements intérieurs. On n'avait pas le souci de conserver les monuments dans leur état initial comme on peut le faire aujourd'hui. De plus, les bâtisseurs et ceux qui les finançaient souhaitaient y apposer leur empreinte et leur « modernité ». Ainsi des partie importantes ont été rajoutées au XVIe siècle (c'est alors que se sont élevés les deux clochers, entre autres aménagements). Au fond, nous pourrions dire qu'une cathédrale est un long « work in progress » ! L'intention, bien sûr, n'était pas uniquement esthétique. C'était un moyen d'affirmer le pouvoir des autorités ecclésiastiques, des guildes, des responsables de la cité, et des aristocrates qui voulaient aussi affirmer leur pouvoir. Les édifices religieux ont servi à fédérer une communauté, et pas seulement sur le plan spirituel. En définitive, si ce volume nous donne envie de découvrir, Mende, c'est un instrument excellent pour comprendre tous les enjeux sous-tendant sa réalisation.

La Révolution électronique, William Seward Burroughs, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean Chopin, Allia, 64 p., 6,50 euro.
Cette oeuvre fondamentale de W. S. Burroughs, je l'ai eu en présent des mains d'Henri Chopin, qui l'avait publiée dans sa collection « OU » en 1971. Ce livre a été ensuite rééditée en France et c'est maintenant les éditions Allia qui ont eu la bonne idée de la réintroduire. Burroughs n'a jamais adopté une posture prophétique, mais il avait pourtant compris bien avant la majorité de ses contemporains que les nouveaux moyens de communication, diffusés largement par le biais de l'électronique, pourrait vite devenir une source d'intoxication et de contrôle des esprits. Il a aussi compris la nécessité absolue de trouver la parade à ces messages qui s'emparent de la conscience des êtres humains pour les placer dans une situation de dépendance absolue. Il expose des méthodes de débrouillage et les expérimente lui-même. C'est d'ailleurs une grande obsession qui traverse toute son oeuvre romanesque, car il était persuadé que le langage et une forme de logique pouvaient très bien obliger les individus à se soumettre à la puissance capable de les émettre. Sa connaissance profonde des drogues et de ses formes de dépendance qui voue celui qui en est la victime à la déchéance et à l'esclavage, lui a fourni un système d'interprétation générale de la société : « l'algèbre du besoin ». Nous sommes tous, à un degré plus ou moins élevé, non seulement dépendant de nos besoins vitaux, mais aussi d'autres besoins, générés par la politique, le pouvoir en général, et de perverses atteintes à l'intégrité de la personne. Burroughs n'avait rien d'un anarchiste, et pourtant ses constations brutales sur l'état des choses dans notre monde moderne. Plus la technologie progresse, plus il est indispensable de se prémunir de ce virus insidieux de l'information et de la télécommunication à outrance. C'est pour lui la traction d'une épidémie virale qui a été métamorphosée en une méthode infernale pour s'assurer la domination sur la majorité des habitants de la planète. Ce qui pouvait encore paraître utopique à la fin des années soixante est désormais une réalité bien ancrée et qui ne fait qu'aggraver la situation. Alors Eletronic Revolution a bel et bien été un livre prophétique. L'imagination fantasque et parfois bizarre de l'auteur du Festin nu s'est révélée féconde pour décrypter cette menace généralisée qui a pris des apparences somme toute banales. Cette révolution-là a surclassé les religions et les idéologies. Elle fait naître des hybrides, comme des religions qui ne sont que politiques et des politiques qui prennent une tournure religieuse. A lire avec soin et à méditer car ces pages n'ont pas pris une seule ride -, au contraire.

Le Siège et la Commune de Paris, 1870-1871, Bernard Tillier, Musée d'Art et d'Histoire, Saint Denis, 56 p., 9 euro.
On n'aime pas beaucoup se rappeler les événements tragiques qui ont mené la France à la défaite devant les troupes prussiennes, à la capitulation du général Bazaine qui avait tenté de négocier avec Bismark (ce qui lui a valu d'être jugé en 1873 pour trahison -, il avait déjà abandonné Maximilien d'Autriche au Mexique !), à la chute du Second Empire, à la poursuite courageuse mais malheureuse des combats à l'initiative des combats sous la férule de Léon Gambetta (on se rappelle que ses déplacements en ballon !) et le siège de Paris, la capitale ne voulant pas se rendre. Dommage que l'auteur ne parle pas de l'engagements des artistes dans un régiment commandé par le peintre militaire Ernest Meissonier et la mort tragique du jeune artiste montpelliérain Bazille lors d'une des sorties infructueuses pour tenter de briser le siège. Finalement, après un vote en province, Adolphe Thiers a pu créer un gouvernement légal à Versailles pour négocier. Finalement, les armées prussiennes entrent à Paris pour y défiler mais n'y restent pas. C'est alors qu'est née l'idée d'une « république de Paris », qui allait devenir la Commune. Les événements sanglants de mai et juin 1871 a laissé une trace profonde dans une partie de la population, alors que l'autre se tourne en adoration devant l'horrible Sacré-Coeur, édifice construction pour l'expiation des péchés des Parisiens ! Bernard Tiller résume parfaitement ces épisodes sanglants avec justesse et discernement. L'importante documentation que possède le musée de Saint-Denis, où l'on s'est aussi battu, est en partie reproduite dans ce petit ouvrage qui mérite que l'on s'y arrête, car il témoigne d'années noires de notre histoire et explique aussi ce qui va se dérouler par la suite : le patriotisme revanchard, la militarisation à outrance, une littérature nationaliste et le déclenchement de la Grande Guerre, dont les raisons profondes échappent toujours, car le jeu des alliances n'explique pas tout ! C'est un manuel d'histoire par le texte et l'image qui doit donner l'envie de visiter les salles rénovées de ce musée.

Ni bruit ni fureur, Lucien Suel, La Table Ronde, 176 p., 16 euro.
Lucien Suel est comme Calvin et moi, d'origine picarde. Cela peur sembler incongru, mais cela prend tout son sens quand on se plonge dans son dernier ouvrage qui porte un si joli titre, qui est une sorte de déclaration de principe -, un manifeste littéraire. Aussi singulière puisse-t-elle être, son oeuvre ne cherche pas à être « avant-gardiste », ou s'inscrire dans une quelconque école, avouée ou inavouée. Il est autant prosateur que poète et sa prose est résolument poétique, alors que sa poésie est elle narrative -, seul le rythme et une pus grande liberté fait la différence entre ces deux modes d'écriture. Dans les premières pages, il se remémore son enfance dans ces terres peu amènes, avec une pointe de nostalgie et un humour fin et une ironie très discrète. Puis il nous entrainer jusqu'à la Mer du Nord, nous place face à d'impressionnante falaises, nous conduit jusqu'à Roubaix par le canal (son père fait alors son apparition, comme un empreinte en palimpseste), toujours avec ce charme qui est le produit d'un curieux mélange de sentiments, les uns heureux, les autres moins. Tout est concis dans son récit, concis et plein de retenu. Il laisse sa faconde de kermesse se libérer quand il adopte la forme poétique. Une brouette devient un objet de méditation. Il nous fait découvrir les corons, mais aussi les modestes jardins qui recèlent pourtant des trésors. Toutes sortes de souvenirs se croisent dans une sorte de sarabande, celle de la Grande guerre, la Der des Ders, un ami qui lui écrit à Paris, les tombes de ses parents, la croix de la crucifixion, omniprésente à la fin de son périple. Ce livre possède une certaine beauté qui est rare, et une curieuse manière de dire les choses, mais une manière qui est aussi suave et grave, qui drôle et caustique. Mais, je le souligne encore, rien n'est du ressort du grotesque, de l'outré ou de l'outrageux. Lucien Suel n'est pas un James Ensor de la poésie. Il met tout en oeuvre pour que ce cheminement avec les mots, reste plaisant et d'une lecture apaisée. Il n'y a guère que deux poèmes qui font surgir des vaches (veaux, cochons !) et des tranches de porc de sa besace imaginaire pour engendrer un rire franc ! Tout le reste est baigné d'une tendre mélancolie.

Flore & bestiaire imaginaire, Daniel Habrekorn,illustré par Hélène Nué & V. Mavounia-Kouka et 5 dessins de l'auteur, L'Harmattan, 248 p., 20 euro.
Je suppose qu'un grand nombre d'entre vous a lu le merveilleux ouvrage de Jorge Luis Borges, écrit avec le concours de Margarita Guerrero, le Manuel de zoologie fantastique. Daniel Habrekorn a voulu prolongé cet ouvrage à sa façon et aussi il en élargi le champ d'exploration car il y a inclus la botanique à la classification des animaux. Ce n'est donc pas en imitateur qu'il a composé son oeuvre, mais plutôt en en soutirant l'envie d'écrire une sorte de dictionnaire fantasque(encore plus fantastique que son illustre prédécesseur) d'une faune et d'une flore sorties tout droit de son esprit. Et quel esprit ! On de se divertit beaucoup en le lisant. A l'inverse de Borges, il ne pastiche pas les ouvrages anciens (je pense, par exemple, à Bruno Latini) , mais imagine un univers qui puisse ses sources chez Rabelais ou les auteurs d'utopies, sans les imiter. C'est ainsi qu'on se plaît à lire la description du poireau constrictor et de la grue guillotine, de la guêpe franc-maçonne, de l'unipatte des marais et de l'arbre généalogique. L'invention de l'écrivain est absolument merveilleuse, absurde à souhait et drôle. Et belle toutefois. Il y a quelque chose de dadaïste dans son attitude, qui n'est pas volontaire, ou même de surréaliste. Mais son intention n'est certainement pas de reprendre à son compte des formules qui font désormais partie de notre histoire littéraire. Il a voulu nous proposer un jeu de lettré qui est un jeu à la portée du plus grand nombre, car les références aux auteurs d'autrefois ne sont pas utiles pour aborder ces pages. A la fin, Habrekorn a ajouré un petit catalogue de publicités s'adressant à des plantes et à des animaux. Il aime l'absurde, le rire, mais aussi, plus que tout, ce que Barthes appelait « le plaisir du texte ». Du plaisir, il nous en donne -, à revendre. Il nous faut l'en remercier !

Le Syndrome Indigo, Clemens J. Setz, traduit de l'allemand par Claire Stravaux, « Babel », 464 p., 8,90 euro.
Je n'avais jamais ouvert un roman de Clemens J. Selz. Bien mal m'en a pris ! Indigo est un livre formidable, avec un mélange sulfureux de science fiction et de littérature fantastique, de roman noir et de roman d'aventure, de roman d'histoire et de spéculations scientifiques, surtout médicales. L'auteur mélange aussi les modes d'écriture, il a recours à des vignettes, comme Sebald, et utilise plusieurs genres de typographies. Mais si la présentation de l'oeuvre est vraiment barrique au sens premier du terme, il n'en reste pas moins que le tout conserve sa cohérence et se lit avec passion. Tout débute par l'histoire d'une maladie étrange, celle des enfants indigo. Mais elle touche aussi tous les âges et toutes les populations. Le narrateur est un professeur. Mais son rôle exact dans l'histoire est vite dissout par le fait que le récit se dédouble, se démultiplie à l'infini. On comprend que cette maladie incurable a commencé à se répandre sérieusement en 1990. En réalité il y a l'auteur qui fait aussi de narrateur, mais aussi un homme indigo, Robert, qui cherche à survivre à tout prix malgré son handicap médical. Le premier rappelle les témoignages qu'il a pu recueillir dans le passé, ce qui engendre des appendices narratifs de toutes sortes et de toutes longueurs. Le second s'inscrit dans le présent et se projette aussi dans le futur. Tous ces fragments s'entrecroisent, s'enchevêtrent, se mélangent, et on perd au bout d'une bonne centaine de pages le fil de l'histoire. Mais ce n'est pas l'histoire qui est la plupart important et dont on ne saura jamais le fin mot, mais plutôt ces pérégrinations en tous sens, qui sont savoureuses, parfois inquiétantes, parfois drôles. C'est une littérature franchement atypique. Mais elle est si bien agencée qu'on se laisse d'emblée emporter par la fouge de cette écriture plurielle. Le monde inventé par C. J. Setz n'est pas une utopie : c'est un monde inquiétant, disloqué, dangereux, dissolu, fantasmé et quelques fois halluciné. On y perd véritablement son latin, mais c'est avec délectation, car l'auteur a eu l'heureuse faculté de faire sortir de son crâne un espace complexe de pure fiction et c'est un délice, mais si la peur nous prend de temps autre. J'espère que vous avez une poche assez grande pour l'y mettre !

Du cloître à la place publique, XIIe-XIIIe siècle, préface de Jacques Darras, « Poésie », Gallimard, 560 p., 9,90 euro.
Cette anthologie est remarquable. En premier lieu, elle nous fait découvrir un pan de la poésie médiévale dont on ne sait pas grand chose (il faut dire que nous avons avec notre Moyen Âge une relation compliquée car on ne peut pas lire ces textes : il faut les traduire en français moderne - il faut attendre les poètes de la Pléiade pour lire des oeuvres sans mal, même Rabelais est difficile à comprendre). Ensuite, c'est le genre de poèmes qui peuvent surprendre : l'amour, et tout ce qu'il comporte de beau, mais aussi de désagréable, est souvent le thème choisi par ces auteurs. Richard de Fournival, qui était dans les ordres, a composé un Bestiaire d'Amour plutôt savoureux, qui dépeint les moeurs des animaux, du loup à la licorne, en passant par le cygne. Il y a dans ces pages un esprit scientifique indéniable, mais aussi une bonne dose d'imagination. Mais le tout est absolument charmant. Le plus beau texte de tous, à mon gré, L'Art d'aimer, de Jacques d'Amiens (le second, car il y a eu un poète avant lui) inspiré de l'Ars amandi d'Ovide. C'est, grâce à la belle traduction de Jacques Darras, un bijou littéraire. On est surpris de la fluidité du style, de la pureté, et aussi de la légèreté de ton du poème et de la justesse de ses observations, de sa modération. Il est évident qu'il n'y a pas d'érotisme païen dans ces pages. Mais un respect du sentiment et aussi une vision de la femme, sans doute courtoise, mais pas purement fantasmatique comme dans les romans de l'époque. Dans un tout autre registre, Le Miserere du Reclus de Molliens, qui n'a été publié qu'à la fin du XIXe siècle est un prototype de texte religieux très austère mais écrit dans une langue merveilleuse. Et malgré le thème, qui n'est pas dans l'ordre du plaisant, l'auteur a été capable d'avoir assez d'esprit et d'invention pour produire des images saisissantes, mais jamais outrées ou stéréotypées. Encore une découverte à faire. Et qui, en plus de la surprise, apporte une vraie délectation.

Le Peuple de bois, Emanuele Trevi, traduit de l'italien par Marguerite Pozzoli, « un endroit où aller », Actes Sud, 288 p., 22 euro.
Quand on commence ce livre, on est perplexe. Les personnages n'ont ni noms ni prénoms, mais seulement des surnoms et l'on se retrouve dans de petites localités vraisemblablement du centre de l'Italie. Mais peu importe d'ailleurs où l'on se trouve : disons, quelque part dans la péninsule ! On ne voit pas trop où l'auteur veut aller. La trame est quasiment inexistence. Malgré tout, on se laisse prendre petit à petit au jeu et on le suit dans ses pérégrinations, ou du moins celle du Rat, qui a pour ami le Délinquant et rencontre la Belle et le Clochard. Ce n'est pas pourtant un gamin puisque son ami a la cinquantaine ! Mais il s'est imaginé un petit univers à soi, qui n'est ni topologique, ni très intellectuel, mais plutôt sentimental et vaguement rêveur. En fait, toute l'histoire narrée par Emmanuel Trevi est celle d'une adaptation du livre célèbre de Carlo Collodi, les Aventures de Pinocchio. Tous enfants des écoles y ont droit et elles les marquent profondément. L'idée d'un spectacle intitule Pinochio le Calabrais, alors que Collodi était constant, turlupine le Rat et même le Délinquant s'interroge. Es-ce le vrai sujet de ce roman. En grande partie oui, car c'est l'absurdité de la chose qui frappe. Dans cette optique, les Calabrais prennent une dimension mythique car ils sont ce peuple de bois, avec la tête dure et des agissements de sauvages. Ces méridionaux des brutes rustiques et sans doute dangereuses. Bien sûr, c'est un jeu qui part de ce livre merveilleux mais aussi bien pensant, avec le mensonge de l'enfant fabriqué par Geppetto, le brave menuisier, qui veut l'éduquer dans les règles. Mais ne nez de Pinocchio, on le sait, pousse quand il profère un mensonge. Bref, l'intrigue ici se joue dans le souvenir de ce livre que tout Itlaien porte en lui toute sa vie et demeure une sorte de charme, mais qui suscite aussi quelques inquiétudes. D'autres grands écrivains avant Trevi, ont écrit sur Pinocchio, comme Giorgio Manganelli. Mais il s'agit ici d'un instrument pour faire usiner l'imaginaire de ses lecteurs. Et même nous, Français, nous connaissons cette histoire sur le bout de s ongles. Il y a tant eu d'adaptation au cinéma, à la télévision, en livres illustrés, que sais-je ? On ne saura jamais qui est vrai le rat ou d'ailleurs qui sont au juste ses compagnons, mais on le suivra dans ses vagabondages mentaux non sans jubilation.

Essais sur le mythe, Walter F. Otto, postface de Karl Reinhardt, traduit de l'allemand par Pascal David, Allia, 110 p., 10 euro.
Sait-on encore qui est Walter F. Otto (1874-1958), ce grand philologue allemand qui s'est passionné sur le sens de la mythologie ? Personnellement, je me souviens avoir lu, il y a assez longtemps, Dionysos, le mythe et le culte, qui avait été publié par Gallimard en 1969. Il faut constater que de son oeuvre très importante et que très peu d'ouvrages ont été traduits dans notre langue à part les Dieux de la Grèce. Cette conférence a donné lieu à un petit livre paru en 1967 en Allemagne (il rassemble en fait divers écrits produits depuis 1934). Mais il faut l'envisager comme une sorte de compendium de sa pensée sur le sujet. Il rappelle en premier lieu ceux qui l'ont précédé dans cette recherche, surtout Schelling, avec sa Philosophie de la mythologie, qu'on âtres peu discutée, et qui est sans doute la meilleure approche qui ait jamais été faite de la question. Otto s'appuie beaucoup sur la poésie d'Hölderlin, qui lui fournit le meilleur point d'appui pour sa démonstration, car les poètes, depuis des lustres et des lustres, ont employé la mythologie pour produite leurs images, tout comme les artistes d'ailleurs, jusqu'au monde moderne, avec le mythe du Minotaure traduit par Pablo Picasso ou André Masson. S'il expose qu'il existe une antinomie entre langage et mythe, l'un ne peut se concevoir sans l'autre. Pour Otto, il n'y a pas une dichotomie qui serait celle de la frontière entre la raison et l'irrationnel (ou l'inconscient -, terme dont il n'use pas). Il va plus loin : les mythes sont la manifestation d'une connaissance rationnelle qui s'est traduite par des légendes plus ou moins fantasmagoriques. Le mythe est pour lui un élément constitutif de la langue (logos) et donc de la pensée. Ce serait comme un substratum qui a guidé la manière de concevoir le monde et de l'interpréter, non en termes oniriques, mais en des termes qui sous-tendent la connaissance. Il faut aussi comprendre que sa revalorisation de l'esprit du mythe est une critique implicite du christianisme, qui s'est en pourtant beaucoup inspiré (implicite ici, car le premier livre qu'il a écrit en 1924 s'intitulait Der Geist der Antike une die cristiliche Welt). Les réflexions de Karl Reinhardt fournissent un éclairage très limpide sur la fonction nécessaire du mythe. D'ailleurs, ne faisons pas la même chose de nos jours, dans une optique assez dégradée ?
|
