
Cézanne Portraits, sous la direction de John Elderfiled, Gallimard, 256 p., 39 euro.
C'est une exposition superbe et il faut la savourer car elle nous enseigne peut-être à mieux comprendre la démarche de Cézanne, qu'on ne considère plus qu'à travers les paysages et la célèbre montagne Sainte-Victoire. Comme il a exécuté de nombreux portraits et quelques autoportraits, on peut mieux juger du chemin parcouru car cette pratique va de ses premiers pas dans la peinture jusqu'à ses dernières années. Il commence par peindre un autoportrait très âpre, rendu avec des empâtements et surtout l'absence complète de complaisance, un les membres de sa famille, de Marie, sa soeur, de sa mère, puis d'un ami et d'un vieillard. Et il fait de nombreuses toiles représentant l'oncle Dominique qui va finir par entrer dans les ordres et qui lui sert à exprimer toute la rage et l'excès de l'art qu'il porte en lui, de plus en plus éloigné des réalistes du cercle de Courbet, qui avait préservé une dose de conformisme et de sens de la beauté. Ce qu'il fait n'est pas du ressort de la beauté, mais d'une vérité qu'il ressent profondément et qui le dirige vers une rupture avec la peinture de son temps. . On le voit un peu sur les traces de Courbet, mais aussi d'un réalisme assez rude. Le Meurtre, un tableau exécuté en 1870 rappelle Goya, alors qu'il est fort peu probable qu'il ait pu voir ce genre d'oeuvres de l'artiste aragonais à cette époque. Cézanne a d'ores déjà et déjà fait la connaissance de la plupart des artistes qui sont à l'origine du groupe impressionniste. Il participe, quand il vient à Paris, aux réunions du Café Guerbois organisées par Edouard Manet. Il retrouve aussi son ami Emile Zola, qui l'avait dissuadé de faire de la poésie. Il le représente en compagnie de Paul Alexis en 1869, dans une composition plus assagie, mais toujours en dehors des canons même les plus avant-gardistes de son temps. Les portraits qui sui vent, comme ceux d'Anthony Vallébrègue, en 1874 montre qu'il n'a pas renoncé avec cette sauvagerie intellectuelle, mais qu'il commence peu à peu à la maîtriser et à l'organise. Les théories de l'impressionnisme ne le touche guère ; mais elle l'aide à franchir un cap décisif : approfondir son art pictural. Par exemple, il inscrit maintenant ses portraits dans un espace plastique plus élaboré, avec des fonds décoratifs (à sa manière !). Ses autoportraits de 1875 le montrent parfaitement. Mais pas question pour lui de renoncer à ce qui l'anime. Les portraits du critique Victor Choquet, entre 1875 et 1877, montre sa volonté de faire des exercices de style plus savants et par conséquent plus sophistiqués. Mais ce sont les portraits de son épouse, à partir de 1877, qui monte qu'il éprouve le besoin de se discipliner sans entre dans le rang. Il y a un fauteuil, du papier peint, une porte et beaucoup plus de souplesse dans le rendu des détails. Mais sa gamme est toujours sombre, volontairement sans éclat, même s'il emploie plus de couleurs et donc de contrastes, qu'il a tendance à minimiser. Les autoportraits qu'il imagine en 1880 sont ingrats par définition. Au fond, il a appris, il a su rendre sa peinture plus dense et plus maîtrisée, mais il en est resté à son idée initiale : se montrer sans concession et surtout de façon peu plaisante. Les impressionnistes voulaient charmer et ont charmé. Lui, non, c'est tout le contraire. Il se présentait de manière assez déplaisante pour l'oeil, mais parfois avec un soupçon d'ironie. Il y a avait dans cette série d'autoportraits de composer le tableau qui était très dépouillée mais avec des raffinements qui n'appartenaient qu'à lui et qui développaient une amorce de géométrisation des formes. Il a compris que ces figurations de sa personne lui servaient à élaborer une peinture nouvelle qui commence à se définir au terme d'une longue et harassante réflexion. Ses deux Portraits de l'artiste au chapeau melon de 1885 prouvent qu'il affranchi ce cap et qu'il est en mesure de réaliser son projet. Les portraits de sa femme qui suivent sont déroutants : il la montre triste, grimaçante, peu séduisante, pour ne pas dire peu gracieuse. Quand il prend pour sujet son fils entre 1886 et 1887, il met en pratique ses propres conceptions, non sans réussite. Son Autoportrait à la palette des mêmes années montrent la même chose, mais avec un désir manifeste de « déconstruire » son art. Les portraits de sa femme à la fin des années 1880, où elle pose en robe rouge, montre là encore que sa recherche se poursuit, avec rigueur, mais un peu moins de rigidité. Elle ne la rend toujours pas très agréable à regarder, mais avec une charge humaine plus intense. Les différentes toiles du Garçon au gilet rouge de cette période lui servent alors à faire pivoter son sujet dans l'espace. Par la suite, il prend des modèles dans le petit monde des cafés et peint une série d'hommes à la pipe, qui aboutit au célèbre tableau des Joueurs de cartes (1891-1896) où il géométrise passablement la scène. Le portrait du critique Georges Geoffroy est le point culminant de cette recherche qui lui permet de faire un portrait en bonne et due forme tout en y insinuant ses pensées révolutionnaires. Les oeuvres qui suivent vont insister de plus en plus sur le volume, qu'il avait considéré presque comme étant secondaire. Il n'est que de voir La Jeune fille à la poupée (circa 1895). Sans s'assagir, il parvient à rénover l'art d portait, ce qui se traduit dans, par exemple, l'Homme assis (1898-1900) et Cézanne au chapeau (1894). Mais ses vieux démons ne le lâchent pas : les toiles figurant le Jardinier Vallier lui permet de maltraiter son apparence en blanc ou en noir. En somme, Cézanne est-il allé au bout de son raisonnement ? Peut-être pas comme dans le paysage. Mais cette autobiographie obscure qu'il traduit dans ces nombreux portraits est un guide sûr pour comprendre le cheminement de ses idées sur l'art de peindre. Donc cette exposition au musée d'Orsay et le catalogue chez Gallimard un événement exceptionnel.

Auguste Rodin, dessins et aquarelles, Antoinette Le Norman-Romain & Christina Buley Uribe, Hazan, 460 p., 27 euro.
On célèbre la mort de Rodin, qui a pourtant été tragique. Il épouse le 29 janvier 1917 sa compagne, après cinquante-trois ans de vie commune, mais celle-ci décède à peine trois semaines plus tard. Rodin meurt d'une pneumonie et sans doute d'un refus de se nourrir en novembre. Mais les commémorations, en France, sont inexorables. Alors fêtons joyeusement cette mort terrible. Cela étant établi, ce gros ouvrage rassemble l'essentiel de son oeuvre graphique. Et celle-ci est d'une importance capitale. Ce n'est pas simplement des projets de sculptures ou d'ensembles monumentaux, mais bel et bien un dévoilement de son sentiment le plus intime. Ce n'est pas un peintre qui se cache derrière le grand sculpteur, mais plutôt un dessinateur qui a tenu ainsi son journal intime car il n'a jamais publié des oeuvres sérieuses sur l'art et l'architecture (L'Art, 1899 et Les Cathédrales de France, 1914). Sur les 7.000 dessins qu'il a exécutés au long de sa longue carrière, 350 sont reproduits ici. Et c'est un pur enchantement, car ils nous présentent un certain nombre d'aspects difficilement discernables de cet homme et de cet artiste si complexe. La sensualité, elle est plus qu'évidente dans son oeuvre sculptée. Et elle est même parfois osée pour l'époque. Mais il ne peut traduire dans le marbre, la pierre, le bronze et le plâtre ou encore l'argile, ses pensées les plus oniriques. Ces techniques sont leurs limites alors que le dessin et l'aquarelle lui laissent une liberté absolue. Sur un fond monochromes clair, souvent jaune et en bleu, parfois blanc, ou encore sur un fond plus élaboré avec plusieurs couleurs. Il lui arrive de traiter deux fois le même sujet avec des tonalités et donc des contrastes différents. C'est presque une transcription automatique de ses pensées esthétiques et, quelques fois aussi, érotiques. La beauté de ces dessins est remarquable, autant que leur audace. Il aurait quelques points de convergences avec son cadet (de loin) Egon Schiele. Rodin a été contesté par une nouvelle génération de sculpteurs, comme Constantin Brancusi (son élève pendant quelques semaines, ou Amedeo Modigliani. Mais il n'en reste pas moins que, bien qu'étant entre deux modalités de la sculpture, il a révolutionné cet art. Et c'est esprit s'est retrouvé avec plus d'aisance et de force dans ces papiers qui sont des merveilles.

Roger-Edgar Gillet, 1924-2004 , Exercice de survie, sous la direction de Patrick Descamps, Misée du Mont-de-Piété, Bergues, Atelier galerie éditions, 84 p., 18 euro.
C'est une chance : ce n'est pas tout les jours qu'il nous est donné de voir une exposition importante de Roger-Edgar Gillet qui, de plus, était un artiste discret. Il commence sa carrière après la dernière guerre, après des études à l'Ecole Boulle. Il devient professeur à l'Académie Julian. Ses premiers travaux sont de nature abstraite, mais toujours avec des légères références à des objets figuratifs. Il est soutenu par les deux grands critiques français qui soutenaient l'abstraction de l'époque, Michel Tapié et Charles Etienne. Fautrier le considère comme le « futur prix Goncourt de la peinture ». Mais Gillet retourne à la figuration dès le début des années soixante. Mais son art n'est pas un « retour à l'ordre », loin s'en faut. Il revendique l'héritage de Goya (celui des « pitturas negras » et à James Ensor). Sa peinture est singulière et ne se rattache plus à aucun courant majeur. Il devient ainsi un solitaire, mais n'est pas pour autant un inconnu : il expose à la gallérie Blu de Milan et régulièrement à la galerie Ariel de Paris. Ses tableaux représentent souvent des foules fantomatiques et des portraits, comme la suite des Apôtres, qui sont des figures spectrales. Son univers est celui d'une vision désespérée de l'humanité, qu'il perçoit d'un registre tragique et en même temps grotesque. Il ne cherche jamais à séduire ni par la couleur, ni par la forme. Il entend frapper les imaginations et semble hanté par les désastres de la guerre et par une déchéance de l'humanité qui le rapproche à la fois de Music et de Giacometti, dans ses thématiques, pas dans le style. Il a aussi recours à des phases où des envahissements d'éclats de peinture de nature abstraite viennent rendre ses compositions encore plus sombres. Les encres de 1995 sont particulièrement remarquables dans la perspective de ces hordes humaines poursuivies par une malédiction dont on ne sait si elle est divine ou non. Ce catalogue permet la redécouverte de cet artiste qui a disparu en 2004 et qu'on a eu tendance un peu à oublier. Il faut reconnaître que cette publication devrait aider à sa juste réhabilitation.
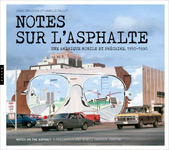
Notes sur l'asphalte, une Amérique mobile et précaire, Jordi Ballesta & Camillet Fallet, Hazan / Pavillon populaire, Montpellier, 144 p., 24,90 euro.
Ce bel album nous montre ce qu'a été l'Amérique vue le long de ses routes entre 1950 et 1990. Plusieurs photographes se sont attachés à représenter ce qu'ont été les rues principales et les grandes routes qui traversent l'immense territoire. On a souvent l'impression d'être u temps des pionniers ! Une partie des constructions paraissent temporaires, dans l'attente d'une architecture plus solide et plus élaborées : il suffit de voir les clichés de J. B. Jakson au début des années soixante-dix. Avec des voitures ultramodernes devant de petites bâtisses en briques de deux étages d'une autre époque. Ce contraste permanent entre cette urbanisme sauvage, avec ces logements en bois et la petite église au fond de la rue triste, en bois aussi, des quartiers pauvres, la vision des sites industriel du pays le plus puissant du monde est aussi la démonstration d'une absence complète de souci esthétique. Les vues en hauteur sont assez impressionnantes pour prendre la mesure de cet état d'esprit. En revanche, C. Liebs et D. Appleyard ont préféré concentré leur attention sur le bord des routes à l'approche des localités, avec les centres commerciaux, les stations services, les motels, les commerces de mobile homme et, bien sûr, l'extrême quantité des panneaux publicitaires placés dans une anarchie absolue. Même l'entrée des v petites villes est indiquée de manières des plus pittoresques et inattendue. Certaines sont de véritables créations dans le style du surréalisme à la Magritte ou du Pop Art dans ces aires commerciales. Cette réalité du voyage automobile paraît presque irréelle, et pourtant, c'était la vie quotidiennes des Américains, et l'est encore de nos jours. D. Lowenthal nous présente dans un cliché en noir et blanc une étrange composition avec une pendule, une boîte en bois dont on ne comprend pas la fonction et des pylônes électriques ainsi qu'un récipient placé sur la gauche. Jackson lui, nous montre un petit restaurant ou le mot « EAT » est répété plusieurs fois sur les panonceaux sur le toit de cet établissement. Tous ces contrastes, ces inventions plastiques singulières ont été moissonnés par des photographes de grande qualité, qui nous raconte ce que Jack Kerouac n'a que peu évoqué dans On the Road.

Gala et Dalì de l'autre côté du miroir, Dominique de Gasquet & Paquita Llorens Vergès, Robert Laffont, 272 p., 20 euro.
Salvador Dalì continue à fasciner. Avec le temps, on a fini par se rendre compte qu'il a été l'un des plus grands artistes surréalistes et l'on a mis un voile pudique sur les malversations et toutes les affaires déplorables qui ont accompagnées ses derniers années. Avec ce recul, on mesure sa valeur comme peintre mais aussi comme écrivain. Ce livre est assez étrange puisque, manifestement, elle n'a pas connu l'artiste ni son épouse Gala. Elle s'est introduite dans leur intimité à Port Lligat, à Figueras, à Cadaqués, au château de Pùbol, que le maître avait offert à son épouse et qui est devenu aujourd'hui un musée. Elle s'est appuyée pour composer cette reconstruction surtout sur les souvenirs de Paquita, mais aussi sur d'autres personnages. Cette histoire, c'est celle qu'ont pu connaître les petites mains, les personnes au service de cet étrange couple. Il y a beaucoup de citations du maître et des témoignages qui ne portent en fin de compte que sur des aspects très secondaires de leur existence. L'attitude de l'auteur n'est pas franchement choquante car bon nombre de biographes qui sont de vrais historiens finissent par s'identifier au sujet de leurs recherches ou à en fournir une image qui n'existe que dans leur imagination. Mais cette familiarité feinte est tout de même gênante. Je suis persuadé que si Dominique de Gasquet s'était focalisé sur la vie quotidienne de Dalì, cela aurait été plus pertinent, alors que là elle spécule et laisse un peu ses propres fantasmes prendre le pas sur la réalité de ces existences. Bien sûr, presque tous ceux qui les ont approchés sont désormais disparus. Gala est morte en 1982 et Dalì, sept ans plus tard. L'auteur a su restituer l'émotion des paysages, une forte relation du peintre à la culture catalane, cette singulière fidélité de ceux qui sont restés si longtemps à leur service. Mais pour le reste nous n'apprenons pas grand chose que nous ne sachions déjà. Il existe un nombre incalculable de livres sur Dalì et une grande partie ont été écrits par des amis, comme Amanda Lear. Alors que penser de cet ouvrage ? Au-delà de la déception qu'il procure et le peu d'informations qu'il nous apporte, l'envie de mieux connaître cet homme et cette femme qui ont vécu d'une manière si peu commune...

Patricia, Geneviève Damas, Gallimard, 134 p., 12 euro.
Ce petit roman par sa taille ne manque pas de poids. Il est question d'un homme, Jean Iritimbi, qui a quitté sa terre natale, le Centrafrique, pour aller travailler au Canada. Il a laissé derrière lui son épouse et ses deux petites filles. Il fait la rencontre d'une jeune femme, Patricia, une jolie Blanche, dont il tombe amoureux. Celle-ci le fait venir à Paris grâce à un faux passeport. Leurs relations sont au beau fixe, mais il ne lui a pas parlé de sa famille. Il ne cesse de penser à ses « femmes » et se fait du souci pou elles. Il parvient à joindre Christine, son épouse. Ils se parlent régulièrement. Un jour il apprend qu'elle a trouvé le moyen de rejoindre l'Europe. Quand il est certain qu'elles sont toutes les trois parties, il commence vraiment à s'inquiéter. Il sait que le voyage est dangereux. Il n'a plus de nouvelles. Il finit par apprendre qu'elles sont montées sur un bateau qui a fait naufrage et qu'il y a que peu de survivants. Il décide d'aller en Italie car c'est là que ceux qui ont pu être sauvés se trouvent. Il fait des recherches, longues, infructueuses. Il finit par retrouver l'une des gamines, Vanessa. Sa soeur et sa mer se sont noyées. Et il l'emmène à Paris, où elle découvre un monde nouveau et auquel elle doit s'adapter. En somme, l'auteur a traduit dans les termes du roman ce drame qui se déroule presque quotidiennement entre les côtes libyennes et la Sicile ou la Grèce. Mais c'est fait avec doigté, sans le moindre pathos, et aussi avec un style très épuré et une scansion rapide. Entre la triste épopée des pauvres gens qui fuient les régions africaines et leur arrivée en Europe et leur intégration dans la société où l'on finit par les accepter après pas mal d'obstacles, l'histoire de Jean Iritimbi a été pensée pour nous sensibiliser un peu plus à ce qui se passe dans le monde méditerranéen depuis des années. Cela devrait toucher le lecteur, l'émouvoir, sans jamais jouer sur la fibre de l'apitoiement. Ce qui rend cet ouvrage tout de même remarquable.

Le Vin des morts, Romain Gary, Folio, 288 p., 7,20 euro.
En réalité, quand l'auteur a écrit ces pages, il ne s'appelait pas encore Romain Gary, mais Roman Kacew, un petit Juif russe né à Vilna selon la langue (aujourd'hui Vilnius) en 1914. Son père était un négociant en fourrures. En 1918, Vilna est intégrée à la Pologne et est rebaptisée Wilno. Il vit alors en Pologne, peut-être avec sa mère. On est certain qu'il se trouvait à Varsovie à partir de 1926, où il apprend le français. Il se rend en France en 1928 à Menton d'abord, puis entre au lycée de Nice. Il obtient son baccalauréat en 1933. Il décide d'aller étudier le droit à Aix-en-Provence. Il dit avoir commencé à écrire à l'âge de neuf ans -, peut-être mais comme le montre cette brève biographie de ses jeunes années, sa vie est déjà un roman avec beaucoup de blancs et de mystères. Il écrit pour le journal Gringoire (qu'il quittera plus tard qui il affichera des idées d'extrême droite et un antisémitisme forcené). Il y fait paraître ses premières nouvelles. C'est cette même année qu'il commence le Vin des morts rédigé dans un cahier qui porte son nouveau nom : Romain Kacew. Le jeune auteur a déjà une grande culture littéraire, les Russes surtout, mais aussi par Edgar Allan Poe, qui semble lui avoir inspiré cette histoire. Il révèle d'emblée tout ce qui fera ses qualités et ses défauts dans le roman : une grande virtuosité pour le dialogue, un mode concis et moderne de forger ses phrases, un ton qui n'est pas celui du XIXe siècle, mais bien de son temps ; mais il y a aussi des facilité et beaucoup d'idées trop générales. L'idée de cette fiction est très belle ; il imagine son héros, Tulipe (un garçon de son âge) dans le royaume d'Hadès, et fait la connaissance d'un certain nombre d'êtres disparus avec lesquels il dialogue. De cette vie d'outre-tombe, il retire, comme Dante dans l'Inferno et le Purgatorio, un grand enseignement, mais qui est distillé non sans malice et humour. Il y a des scènes caricaturales, d'un humour très noir, mais irrésistible, mais aussi d'une réelle profondeur. Ce livre n'est pas accepté par les éditeurs à qui il le présente. Il restera donc dans un tiroir et ne paraitra que bien après son suicide. Mais, en 1946, il publie un livre qui s'intitule Tulipe et qui évoque les camps d'exterminations nazis. C'est l'on aime Romain Gary et qu'on veuille comprendre ses premiers pas littéraires, ce livre est incontournable.

Journal, Jules Michelet, édition de Perrine Simon-Nahum, Folio classique, 1150 p., 12,50 euro.
L'étoile prestigieuse de Jules Michelet ((1798-1874) s'est passablement ternie depuis quelques décennies. Les éditions Flammarion avaient commencé l'édition de ses oeuvres complètes et s'est arrêtée en cours de route. On n' plus guère lue que les Sorcières, ouvrage devenu bien contestable sur bien des plans historiques, mais toujours très riche d'intuitions et d'une vision de la question qui peut encore servir notre réflexion sur le sujet. Il a débuté sa carrière par une étude sur la philosophie de Vico en 1827 puis a très vite rédigé partir de 1833 l'une de ses oeuvres les plus monumentales, L'Histoire de France qu'il n'a achevée qu'en 1867. Il a écrit sur plusieurs types de sujets : La Pologne, la Russie, la Femme (1859), les Templiers (entre 1841 et 1851) et même sur la montagne et la Mer (1861). Il a aussi abordé des questions sociales et politiques, comme le Peuple (1846). Quant son Histoire de la Révolution française, elle a paru entre 1847 et 1853. Il a été plus qu'un historien, même s'il est considéré comme le créateur de l'histoire moderne en France. Ce lecteur de Locke, de Leibniz et de Montesquieu et aussi un grand amateur de Giambattista Vico dont il a aussi été le premier publier ses oeuvres dans notre pays en 1835, a été le fondateur du mythe de Jeanne d'Arc. Proche de Renan et de Taine, il est profondément pessimiste et ne croit pas dans la notion de progressisme et de positivisme. Il est hostile au socialisme, qu'il considère comme un « ultra-cléricalisme ». Mais il n'en est pas moins un progressiste dans l'âme. Républicain d'abord, il adhère à la Révolution de 1848, mais n'accepte aucune charge politique. Il est destitué de sa chaire du Collège de France par Napoléon III et refuse de prêter un serment d'allégeance l'Empire. Les extraits qui nous proposés ici par Perrine Simon-Nahum sont monumentales et elle a dû faire un choix, qui n'écarte cependant aucun sujet. La famille est omniprésente, comme ses amis et correspondants. Ce journal est une somme incroyable de réflexions sur la politique, la philosophie, sur ses amis, comme Edgar Quinet, et ses ennemis (les jésuites, qu'il a fustigé dans un ouvrage, dont Mickiewicz aussi), mais toutes sortes de sujets, dont la variété est infinie. Rien ne semble l'indifférer, à part la littérature (même s'il est souvent tenté par le roman) et les arts, qui sont eu pris en considération. Mais la géopolitique le passionne. Et il voyage beaucoup. Il a cette dimension ogresse des grands hommes du XIXe siècle, qui rêvaient tous d'accomplir des oeuvres titanesques, de Balzac à Hugo, en passant par des savants comme Elisée Reclus ou Camille Flammarion. Ce livre témoigne d'une ces vie avec une ambition qui ne serait plus imaginable de nos jours. Toute ambition s'est redimensionnée car le champ du savoir a pris une ampleur tellement considérable qu'il est impossible d'embrasser pleinement sa totalité. On découvre les aspects complexes et assez contradictoires de cet homme d'exception, apocalyptique et moral, finalement mystique d'un genre particulier, visionnaire, je le souligne et souvent d'une rare bizarrerie, car il peut tirer des conclusions aussi hasardeuses que celles d'Alexandre Dumas, qui, lui, ne cherchait qu'à imaginer des aventures historiques palpitantes au mépris de toute vérité !

Un chat sous la pluie, Ernest Hemingway, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Michel Arnaud, Marcel Duhamel, Georges Magnane, Maurice Rambaud, Henri Robillot & Philippe Sollers, Folio, 496 p., 8,20 euro.
A mon humble avis, Ernest Hemingway est meilleur nouvelliste que romancier. Et aussi un poète de qualité. Il écrit ses romans comme de longues nouvelles, avec le même style, qui fonctionne à merveille sur une courte durée, mais devient systématique quand l'histoire se prolonge. Il sait brosser une situation en quelques lignes et puis titrer le suc d'une minuscule anecdote. L'« Histoire naturelle des morts » est une merveille car il croise plusieurs points de vue pour retourner à la triste réalité individuelle à la fin. Il sait narrer avec art, mais il sait aussi tirer de chaque histoire non une morale, mais des méditations, parfois légères, mais le plus souvent d'une certaine portée. L'ensemble de ces nouvelles permet aussi de voir l'évolution de son écriture au fil des ans car elles couvrent un champ chronologique assez vaste. Ce recueil comprend également une pièce de théâtre, la Cinquième colonne.
Hemingway y raconte dans quelles circonstances elle a été écrite au début de l'année 1937. Il se trouvait alors à Madrid et l'hôtel où se déroule l'action se situait assez près du front. Les forces de Franco comptait quatre colonnes. Mais il en existait une cinquième qui comprenait des légionnaires dispersés dans la ville et qui faisait des actions de commandos ou étaient snippers. L'histoire qu'il raconte pour la scène est assez ébouriffées car entre les bombardements fréquents et les affrontements de rue, se mêlent des histoires d'amour un peu chaotiques. C'est une forme théâtrale curieuse car elle se passe en grande partie en huis-clos dans l'hôtel Florida où se trouve le héros, mais fait comprendre comment était vécue la défense héroïque de la capitale espagnole. C'est l'univers des combattants républicains et aussi de ceux de la brigade internationale. C'est plutôt une révélation émouvante.

William Gedney, Only the Lonely, Gilles Mona, Lisa McCarty & Margaret Sartor, Hazan / Pavillon populaire, Montpellier, 144 p., 24,95 euro.
Le nom de ce photographe américain (1932-1989) ne nous est guère connu. Il est vrai qu'il n'a guère été exposé, ni beaucoup soutenu par les institutions de son pays. Il a beaucoup écrit à côté de son oeuvre (mais pas mal sur cette oeuvre si particulière). Comme on découvre les prises de vues recueillies dans cet album, on se rend vite compte que c'est l'être humain qu'il tente de révéler et de comprendre, dans le Kentucky (en 1964 et en 1972), en Inde à plusieurs reprises, à Brooklyn entre 1955 et 1979. On ne sait trop bien ce que racontent les scènes qu'il rapporte, qui sont parfois celles de milieux déshérités ou de groupes homogènes (les policiers, les culturistes), les jeunes gens et leurs voitures, etc. Mais il est clair qu'il a voulu mettre en lumière des singularités ordinaires qui s échangent en singularités extraordinaires. Même les maisons qui paraissent abandonnées par leurs habitants, la nuit, dans les petites cités américaines font penser à Hopper : ils les transposent dans un univers « métaphysique », sans pourtant employer le moindre effet technique. Il tente de produire une sensation forte, sans rien forcer, dans la réalité qu'il a pu rencontrer au cours de ses campagnes photographiques. IL a possédé un grand talent, un sens rare de l'humanité dépourvu de tragique et de pathos, un intérêt pour les déshérités et les disgraciés, mais sans plaquer un discours moralisateur ou édifiant. Il n'est pas en quête de la bizarrerie ou de l'étrange mais de ce qui qui, chez ses contemporains, exprime la douleur, l'insouciance, la passion, le sérieux ou le l'égotisme, en somme toutes les modes de formuler sa place dans l'univers. C'est un bel exemple d'un homme qui sait voir et qui parvient à transmettre une perception des êtres et des indices de la vie des hommes en marge des conventions et surtout du pittoresque. William Gedney mérite vraiment d'être mieux connu et apprécié.

Montesquieu, Catherine Volpilhac-Auger, Folio biographies, 336 p., 7,20 euro.
Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu (1689-1755) a une importance capitale dans notre histoire littéraire et aussi comme le précurseur de l'Age des Lumières. Il a suivi ses études à la fin du règne de Louis XIV, et il devient président du parlement de Bordeaux au début de la Régence. C'est en 1721 qu'il publie le livre qui le rendra célèbre : les Lettres persanes. Son influence a été énorme à l'époque, même dans les colonies anglaises d'Amérique (on le considère comme le père de la Constitution). Comme le démontre très bien les Considérations sur les causes delà grandeur et de la décadences des Romains (1734), il s'est fait une conception de l'histoire qui dépasse les figures individuelles et qui considèrent qu'elle est mue par des lois morales et par une série de circonstances qui se conjuguent. C'est un bouleversement profond de l'idée que l'on pouvait se faire des événements historiques. Même s'il se recommande des Anciens comme Hérodote et Tacite, il propose une autre méthode d'investigation. L'Esprit des lois (1748) est une tentative de classifier les différentes sociétés humaines selon leurs législations et leurs moeurs. Il avance aussi des pensées tout à fait novatrices alors, comme la suppression de l'esclavage. Le grand économiste John Maynard Keynes le dépeint comme « l'équivalent français d'Adam Smith, le plus grand de nos économistes... » Sans doute ses hypothèses sur le climat peuvent paraître largement dépassées ! Sa Physio-économie reprend des propos tenus par Hérodote dans ses Histoires. C'est une lubie qui s'appuie sur des préjugés. Mais son Essai sur le goût (1757) est par contre du plus haut intérêt. Cette biographie met en évidence l'homme qui se cache derrière ces oeuvres fondamentales : l'auteur a insisté beaucoup sur son sens aigu de l'observation, sa curiosité immense pour différents arguments ou sur ce qu'il peut voir au cours de ses voyages. C'est vraiment un homme qui a été un grand précurseur, ce pour quoi il a eu des démêlées avec les tenants de la religion catholique (surtout les jésuites, mais aussi les jansénistes). Ce n'est pourtant pas un philosophe libertin. En tout cas, on ne peut que se réjouir de cet vie racontée avec sérieux, mais en mettant aussi en avant sa véritable humanité et la richesse de sa pensée.

Tigrane l'Arménien, Olivier Delorme, La Différence, 400 p., 19 euro.
Je dois dire que je ne comprends pas pourquoi l'auteur a tenu à faire s'entrecroiser deux histoires, l'une étant contemporaine, la seconde se déroulant pendant la Grande Guerre. Je crois qu'il aurait dû en faire deux livres distincts. Je ne m'attacherai qu'à celle qui concerne le sort des Arméniens dans l'Empire ottoman pendant la seconde guerre mondiale. Le récit commence en août 1914. La guerre a débuté entre les empires centraux et la coalition anglo-française. Nous faisons connaissance de la famille Arechavian, qui demeure à Istanbul, encore capitale. Le neveu du respecté avocat, Bedros, arrive dans cette grande cité et il en découvre le splendeurs. Mais il comprend bientôt que la situation est très tendue. Il ne se trompe pas, quelques semaines plus tard, la Sublime Porte déclare à guerre aux forces de l'Entente. On apprend par son entremise quelle était alors la situation des Arméniens dans ce pays en décomposition, mais encore immense. Les Russes avaient depuis 1912 favorisé le développement des composantes des patriotes arméniens qui souhaitaient fonder leur propre nation. Cette réalité, même si elle n'engageait pas tous les Arméniens et de loin, a sans doute été la cause des déportations massives et puis de l'épouvantable génocide. Cette tragédie, Olivier Delorme la raconte à travers l'histoire de cette famille dont tous les membres vont mourir l'exception de Bedros qui est parvenu à s'enfuir. Je dois dire que le récit des faits est terrible, mais sans pathos et sans exagération. L'écrivain s'en est tenu aux faits et rend d'autant plus effroyable ce massacre car il ne fait aucune surenchère romanesque. C'est donc un livre indispensable pour comprendre ce qui a pu se passer en 1915 dans ce contexte très spécifique sans avoir à se plonger dans de savants traités. Les Turcs avaient quelques raisons de se méfier des Arméniens, mais rien ne saurait justifier ces exactions indiscriminées. Ensuite, la seconde partie relate l'histoire de ces descendants qui ont pu fuir à l'étranger et qui ont décidé de pourchasser les bourreaux de leurs parents. Un peu comme les Juifs se sont mis en chasse des nazis. Cela aussi est des plus intéressants, mais, je le répète, aurait dû faire l'objet d'un second ouvrage. Avant de conclure je voulais préciser deux choses : on demande à un pays, la Turquie, de reconnaître ce génocide. Or cette République n'a vu le jour qu'en 1923. Ensuite, ayant souvent séjourné à Istanbul, j'ai vu au cours des années 1990 dans des librairies les énormes volumes concernant la question arménienne, avec une édition en turc, l'autre en anglais. Publiés par l'Etat ces volumes pouvaient être acquis à un prix relativement bas. Donc, il y a bien eu un effort de fait pour éclaircir cette phase épouvantable de la fin de l'Empire. Mais ne les ayant pas achetés, je n'ai fait que parcourir qu'un volume comprenant une masse considérable de documents de l'époque.

Lettres à Sade, sous la direction de Catriona Seth, Editions Thierry Marchaisse, 152 p., 14,90 euro.
Dans cette belle collection de « Lettres à ... » un grand écrivain du passé, a paru ces lettres adressées au divins marquis par des écrivains de notre temps. La plupart de ces missives sont non seulement intéressantes, mais aussi distrayantes. J'ai d'abord été assez intrigué par celle de Catherine Cussset, qui insiste beaucoup sur sa manière d'écrire en employant les moyens de la technologie moderne. Cela me parut agaçant car il est vrai qu'aujourd'hui peu d'auteurs utilisent la plume et l'encre. Mais cela ne sert qu'à introduire la suite : elle veut montrer que les rêves les plus insensés de l'auteur des Cent vingt jours de Sodome ont trouvé leur traductions dans des pratiques nouvelles : du piercing à l'ovulation artificielle. Sa longue lettre est frappée au coin du bon sens. Sébastien Doubovsky s'adresse à l'homme qui a défié tous les régimes, l'ancien comme le nouveau, celui de la Révolution et du Consulat. Il en fait l'expression la plus pure de la liberté de l'esprit. Quant à Pierre Jourde, il voit dans son érotisme dépassant toutes les normes une jouissance dans l'énoncé de la loi et que loin d'être l'inventeur de toutes les perversions dont on l'accuse, il n'a été que le maître suprême des libertins de son temps. Quant à Christian Prigent, il s'intéresse à la radicalité de sa philosophie : celle d'une nature débarrassée de l'homme. Il voit en lui un penseur qui lance un défi aux penseurs les plus éclairés de son temps avec une volonté de tout dire et aussi de démontrer les machineries intellectuelles sur lesquelles reposent tant bien que mal les sociétés. Un utopiste ? Pas sûr. Un individu qui va le plus loin possible dans le sens de l'impossible de l'humanité. Suit une longue lettre de François Priser qui se présente comme un peintre de cabinet et qui lui vante les mérites de l'aérostat. Il le fait après avoir évoqué son appétit d'ogre sans borde, son goût effréné du calcul infinitésimal, ses maux effrayants exigeant des soins infinis et très compliqués. Le ballon, enfin, ma montgolfière, pourrait aidé à fuit d tout cela celui qu'il surnomme « son Enormité ». Si j'en crois René de Ceccatty, il fait un portrait de lui l'homme des extrêmes, sans Dieu, sans amour, sans foi, sans morale, en un mot, l' «homme noir ». C'est un très beau portrait et qui semble sonner juste sous sa plume. Enfin, François Os se demander où adresser son courrier. Il hésite entre l'Enfer et le Purgatoire et la réponse de son correspond le rassure : il est bien dans les limbes et non dans les cercles infernaux. Je ne saurais citer tout le monde dans ce modeste article. Mais je me rends compte que quasiment personne ne prend vraiment son parti, je ne dis pas son parti dans son ensemble, mais que tous nos écrivains ont des moeurs des plus châtiées. Mêmes les sodomites ne se reconnaissent même pas en lui, un petit peu ! Quoi qu'il en soit, c'est-là un ensemble d'écrits qui nous ouvre des perspectives sur le célèbre écrivain maudit, mais aussi sur le regard qu'on a sur lui !

Une aventure à Tanger, Pascal Poiret, centre international de poésie Marseille, 16 p.
L'Hypothèse Tanger, Le refuge en Méditerranée, centre international de poésie, Marseille, s. p., 15 euro.
Ces deux livre sont en commun une chose : Tanger. Mais, assez curieusement, il n'y a ai question ni de la ville, ni de son histoire, ni des grandes écrivains qui y sont venus, comme Tennessee Williams, Truman Capote, Jane et Paul Bowles, William S. Burroughs, Brion Gysin, Samuel Beckett, Jean Genêt, ni des auteurs autochtones dont certains méritent tout notre intérêt, non, tous les deux tournent autour d'une notion abstraite qui porterait son nom. Les deux auteurs ont aussi en commun d'être issus d'un rameau assez fragile de la littérature française qui est celui de la prétendue « écriture blanche ». Le premier en fait nous délivre une conférence qu'il a faite récemment et qui est une lecture d'Emmanuel Hocquart, qui a publié Un privé à Tanger et d'une Grammaire à Tanger, que Pascal Poiret semble porter au pinacle. Les raisons de son admiration inconditionnelle ne m'apparaissent pas avec clarté dans son exposé où il est question de « miniature grammaticale », dont l'auteur s'explique lui avec la plus grande simplicité. Poiret y voit un récit. Pourquoi pas ? Le cas d'Anne Malaprade est encore plus surprenant car son propos réside sur l'inversion de la lette A (donc majuscule) dans le nom « Tanger ». Le A retourné devient un personnage. Difficile de savoir qui est ce personnage. C'est écrit avec une précision de métronome dans un hermétisme absolu. C'est du travail parfait, mais une oeuvre dont on ne saisit pas le sens. Peut-être est-ce moi qui ne comprends rien à l'affaire. Je trouve ce genre de phrase : « Si donc Tanger se trouve seule et apeurée dans un couloir, tu dois ouvrir les portes, dit Kafka. » Soit. Mais Kafka, qui n'était pas un ami de la littérature la plus transparente n'aurait pas mieux compris que moi cette allusion. Je le redit : c'est écrit avec un soin infini, fignolé, bichonné, rendu le plus cryptique possible et fait disparaître totalement Tanger et tout ce que cela suppose. Mais est-ce là la littérature de demain matin ? Quel réveil !

Leçons sur Spinoza, Ferdinand Alquié, « la petite vermillon », La Table Ronde, 464 p., 10,20 euro.
Voulez-vous vous pénétrer de la philosophie de Baruch Spinoza (1632-1677) ? Il faut alors vous procurer les Leçons de Ferdinand Alquié. Pourquoi ? D'abord pour l'incroyable clarté de ses explications : il dissèque l'ensemble de son oeuvre et l'évolution de sa pensée avec méthode et un souci d'être compris par tous, sans jamais verser dans la vulgarisation, mais ensuite parce que Spinoza a été l'un des plus puissants opposants à René Descartes. Sa philosophie du bonheur, que l'avait enseignée Robert Misrahi, présente deux aspects essentiels. L'un est religieux et là, Spinoza a tenu a faire la démonstration rationnelle de l'existence de Dieu, comme on peut le constater dans son Traité Theologico-Politicus (1670), la seule oeuvre parue de son vivant. Il s'oppose ainsi à Descartes qui lui prête des sentiments comme la haine ou l'amour. La seconde est politique : les religions du Livre reposent sur des interprétations qui n'ont rien à voir avec la substance de la Bible. Il s'oppose ainsi à Maïmonide et à Averroès : la Bible est un instrument réservé aux Hébreux d'autres formes dans les formes de pensées qui étaient les leurs. Il ne reconnaît qu'une exégèse rationnelle de l'ouvrage. Et il ne voir le divin que comme immanent (pour lui, Dieu, c'est la Nature). . Comme Hobbes, il s'insurge contre les méfaits de la religion par les pouvoirs mondains. Mais ce qui fait tout l'intérêt de ce livre d'Alquié, c'est qu'il appris soin de montrer comment le grand philosophe juif a su construire son Ethique, à partir d'une théorie de la connaissance divisée en quatre degré et de l'entendement, sans cesse corrigée, depuis son Petit traité. C'est de Rijburg qu'il lance ses attaques contre Descartes entre 1660 et 1661 (il y rédige les Principes de la philosophie de Descartes, resté alors inédit). Exclu à jamais de sa propre communauté, soupçonné par le clergé catholique, il a passé même pour un athée. Son éthique rationnelle est suspecte aux yeux de tous : elle doit mener à la liberté et aussi à la béatitude, mais elle n'accepte pas l'idée de libre-arbitre car l'être est tiraillé entre déterminisme et liberté (mais l'une n'est pas l'opposition de l'autre). En somme, c'est un esprit qui a eu tendance à frapper le camp des anciens comme celui des modernes ! Il n'a pas pu publier son Ethique en 1875 car nul ne voulait entendre ses théories sur la religion, mais aussi sur la connaissance, qui devrait faire partie pour lui de l'éthique.

L'Aleph et autres contes, Jorge Luis Borges, traduit de l'espagnol par Roger Caillois, présenté par Jean-Pierre Bernès, Folio bilingue, 160 p., 7,70 euro.
Ce choix de nouvelles de l'immense écrivain que fut Borges, avec l'une de ses nouvelles les plus connues, l'Aleph. Ce volume révèle non seulement sa maestria dans la construction et le développement d'une histoire, mais aussi la beauté de sa langue qui est extrêmement épurée. Son castillan est d'une limpidité adamantine. Bien sûr, il est à peu près certain que dans ses récits argentins, il a employé le parlé portenõ. Mais tout ce qui ne se rapporte pas à l'Argentine, est d'une nature emprunte à la fois au classicisme de l'espagnol d'autrefois et à une modernité dans l'expression et la facture des phrases. Je ne vais pas vous résumer les histoires célèbres contenues dans ce recueil. Je voudrais seulement m'arrêter sur le Deutsches Requiem qui apparaît dans ce livre qui est plutôt marqué par une transmutation imaginaire de l'histoire et de légendes antiques. Là, Borges a voulu parler d'un Allemand, héritier d'une famille ayant une grande tradition de bravoure militaire. Il aime la musique et la philosophie, comme ses semblables les plus cultivés. C'était une personne éduquée et posée. Il entre au pari nazi en 1929 et est emporté par le grand tourbillon idéologique en croyant resté le même. Mais lui, quand la dernière guerre se déroule, il est affecté dans un camp de concentration de Tarmowitz. Il s'y comporte avec violence, sans pitié, avec une sorte de régularité presque automatique. Et puis le Reich s'effondre et il prend conscience que cela devait être ainsi. Son destin était indissoluble de sa patrie. Il passe devant un tribunal et il est condamné à mort. Il ne redoute pas cette fin car elle fait partie de son destin lié à celui de la folle entreprise de tout un peuple qui a suivi son chef presque comme un seul homme. En quelques pages, il a résumé ce que pouvait être le paradoxe allemand et ce qui pouvait lui advenir dans des circonstances hors norme. Borges avait une pensée sur le monde moderne, une pensée bien affirmée, qui est passé loin derrière toutes ses sublimes affabulations.

Junky, William S. Burroughs, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Catherine Cullaz, Jean-René Major, Philippe Mikriammos, présentation d'Oliver Harris, Folio, 352 p., 7,70 euro.
Ce fut le premier livre écrit par William Seward Burroughs (si l'on fait exception de l'ouvrage qu'il a écrit avec Jack Kerouac, And the Hippos Boiled in Their Tanks, qui n'a pas été une réussite et qui n'a paru que posthume). Au contraire de ses deux plus proches amis, qui finissaient leurs études à Columbia, mais de la future Beat Generation, Burroughs, plus âgé qu'eux, n'avait pas encore d'ambition littéraire. C'est un concours de circonstances qui l'a conduit à produire ce livre en 1952, qu'il a d'abord intitulé Junk, mais Carl Solomon lui a dit que ça faisait pensé pas seulement à l'argot des drogués (la came), mais aussi à l'ordure, à l'objet de rebut. Alors il appris le titre de Junky, ce qui signifie le camé. Ginsberg s'est beaucoup démené en tant qu'agent littéraire improvisé pour le présenter à un éditeur d'un certain niveau, James Laughlin. Mais le destin a voulu qu'il finisse dans une collection de poche commerciale et à bas prix chez A. A. A. Wyn. Il s'est alors retrouvé dans une collection spéciale, qui associaient deux histoires, les « Ace Double Books » : son histoire a été donc liée avec celle d'un agent des narcotiques, Maurice Helbrant. Il s'agissait là d'affaires criminelles et non de littérature ! Dans ces pages, il tente de décrire avec la plus grande exactitude de la vie d'un homme prisonnier de son intoxication à des substances prohibées et de sa descente inexorable aux Enfers. Il y a quelque chose de clinique dans ce récit froid, presque objectif, qui pourrait être son autobiographie, mais rendue avec une telle distance qu'elle pourrait être l'existence de n'importe lequel de ces pauvres hères tombés dans la déchéance. Le préfacier énumère un certain nombre d'auteurs qui auraient pu inspirer Burroughs, surtout ceux de la Lost Generation, ce qui est franchement absurde dans ce cas. Si le livre, avec le temps, a trouvé sa dimension littéraire, il n'en reste pas moins une sorte d'examen clinique d'une intoxication fatale aux stupéfiants. Il y a toujours eu chez Burroughs un savant qui dormait. Il a donné une suite à cet ouvrage et l'a appelé Queer, qui narrait cette fois son expérience homosexuelle, dans des termes assez comparables. Mais le manuscrit ne trouva pas preneur et ne fut mis sous presse que bien plus tard. Ce n'est qu'avec The Naked Lunch, après des années de travail à Tanger puis à Paris à la fin des années cinquante, que Burroughs s'est imposé comme l'un des plus grands romanciers de la seconde moitié du XXe siècle.

Solomon Gursky, Mordecai Richler, traduit de l'anglais (Canada) par Lori Saint-Martin & Paul Gagné, Points signatures, 690 p., 12 euro.
C'est une oeuvre monstrueuse. Monstrueuse et belle, unique en son genre. De ce roman achevé et publié en 1989, l'auteur, Mordecai Richler (1931-2001) en aurait pu tirer dix ou plus ! Et ce n'est ni Guerre et Paix, ni les Misérables : c'est plusieurs histoires imbriquées les unes dans les autres, dans un tohu-bohu qui se déroule dans plusieurs dimensions de l'espace et du temps. C'est une épopée juive. C'est celle d'un adolescent qui part la recherche de ses ancêtres. Et comme dans presque toutes les familles juives, c'est un exode permanent. Mordecai Richler nous entraine dans différentes régions du globe, des Etats-Unis, mais c'est surtout au Canada. A travers cette quête, qui se traduit par un roman picaresque, cette quête de ce fameux ancêtre se change rapidement en une folle chevauchée dans les régions les plus étranges, avec en particulier une expédition en Alaska - la désastreuse expédition Franklin de 1845 - , que les Américains appellent le Farth North. Contrebande, trafics en tous genres, commerce de peaux d'animaux, opérations de guerre sur les côtes françaises, sans oublier les scènes de la vie familiale et la grande richesse de Gursky, c'est là en filigrane l'histoire des Juifs qui sont venus s'installer au Canada et qui, comme tous les émigrés, ont connu des fortunes diverses. Les frères Singer, à côté de lui, paraissent avoir écrit que des opuscules ! C'est à la fois narré de manière très posée, mais le tout est submergé par une énormités d'événements et de faits, au point qu'on l'impression d'être emportés entre ciel et terre comme le baron de Münchhausen. IL y a aussi un peu de Laurence Sterne et tous les romans épiques de la terre. Mais toujours avec ce fil d'Ariane qui est l'histoire emberlificotée de la famille, que l'écrivain nous dépeint avec une sagesse très réaliste et vivante, un peu à la Breughel, mais sans excès. La quête de Moses Berger fils d'un écrivain et pas en mal d'imagination, en tous points du globe et surtout, bien sûr dans les Cantons de l'est du Canada, à la recherche des traces laissées par le passage de Salomon Gursky, ou de ses parents et des parents de ses parents, comme cet Ephraïm, qui a grandi dans le East End de Londres, qui s'est fait très tôt une excellente réputation de pickpocket, pour ensuite user de ses dons prononcés pour les langues pour adopter différentes identités dans différents pays et même participer à la Guerre de Sécession et dans la vente illégale d'armes. Ce même Ephraïm qui a voulu allez chez les Inuits pour y instaurer une église millénariste ! Moses Berger va aller d'étonnement en étonnement et il ne peut pas être surpris que cet ancêtre qui aurait combattu dans les trachées de Vimy pendant la grande Guerre, se serait aussi lancé dans la contrefaçon et le commerce d'alcool. L'histoire du Canada à la sauce juive est passionnante de out en bout et il faut saluer ici un écrivain sans égal.

Les Tours de Barchester, traduit de l'anglais par Christian Bérubé, édition d'Alain Jumeau, Folio classique, 784 p.,
Sous le règne de la reine Victoria, à l'exception de Charles Dickens, la grande littérature romanesque est essentiellement féminine et par conséquent sérieuse. A la fin de cette période, Thomas Hardy se fait l'héritier de cet esprit et reprend les mêmes thèmes que ces dames très talentueuses, peut-être avec une pincée de social plus nourrie. Anthony Trollope (1815-1882) paraît être une comète mystérieuse, car il use et abuse de l'humour, n'hésite pas, comme Laurence Sterne, a joué sur le registre du picaresque (mais dans une toute autre perspective) et fait figure d'énergumène. Henry James lui a d'ailleurs reproché cette liberté excessive dans la construction de ses fictions, alors que lui-même éprouvait la plus grande difficulté à structurer ses histoires. Trollope se situe dans la grande tradition satirique anglaise, surtout celle du XVIIIe siècle. Après une enfance et une adolescence chaotique avec des parents qui ne réussissent pas vraiment dans leurs entreprises en Angleterre, en Belgique, comme aux Etats-Unis, des études qui ont été faites cahin-caha, et un début dans l'existence pas trop facile car il a dû prendre un emploi modeste dans l'administration des postes et est parti en Irlande en 1841 pour remplir son office. C'est dans cette île qu'il commence à écrire. Il a d'ailleurs écrit pas moins de quatre romans sur l'Irlande. De retour en Angleterre en 1851 pour accomplir une mission et il visite la cathédrale de Salisbury, ce qui est une révélation qui lui fait écrire le premier tome du cycle des romans de Barsethire (six au total), d'abord The Warden, paru en 1845, et puis The Barchester Towers deux ans plus tard, qui lui vaut un peu plus de succès. Si les questions éthiques sont au centre de son premier roman, elles se retrouvent dans le second. Mais, cette fois, il se mêle des discussions qui ont lieu au sein de l'église anglicane, entre Low Church et High Church, mais aussi avec l'avènement du Catholic Revival. Cela a des répercutions bien au-delà du milieu ecclésiastique. On voit le petit monde résidant dans cette petite ville occidentale se déchirer à qui mieux mieux, dans une atmosphère quelque peu bouffonne. C'est du Hogarth à la puissance dix et ce livre, qui parle pourtant d'une autre époque et d'autres moeurs, demeure d'une actualité assez saisissante. C'est drôle, mais aussi révélateur et c'est une satire non seulement des débats religieux, mais aussi et surtout de la vie politique et de ses mauvaises façons. C'est à sa manière un chef-d'oeuvre. Pour passer l'été, ce livre vous distraira plus que les petits romans à l'eau de rose ou à l'eau salace ourlés par ces femmes d'aujourd'hui qu'on aura déjà lu dix ou vingt fois sous une forme ou une autre.
|
