
L'Enigme de Marcel Duchamp, Philippe Sers, « Bibliothèque », Hazan, 160 p., 16 euro.
Comme Jean Clair, l'avait fait en son temps, Philippe Sers a tenu à remanier en profondeur son étude sur Duchamp. Dans sa préface, il avertit le lecteur de ne pas tomber dans le piège d'idées reçues et de généralisations abusives, comme celle provoquées par le commentaire de Breton sur le ready-made. Cela ne l'empêche pas de faire la même bourde avec le futurisme italien, qu'il associe au fascisme (c'est vrai, ce lien existe, mais encore faudrait-il en définir la nature et les complexes contradictions). Cela dit, les mises au point de l'auteur sont bien vues et importantes pour comprendre l'attitude de Duchamp, en particulier sur la question de l'art et des artistes (quoi que, Duchamp aimait jouer de mille paradoxes...) Que l'urinoir de Mutt n'aie pas été une oeuvre d'art, on doit le comprendre pour comprendre la suite. Moi, j'irais jusqu'à dire que c'était une farce méchante de potache ! « La vraie leçon de Duchamp n'est donc pas où elle est cherchée actuellement », dit-il dans sa conclusion. Et c'est là où le bât blesse. Son examen détaillé et précis de la démarche de ce curieux artiste est exemplaire : elle montre la spécificité de sa démarche et évite qu'on aille se perdre dans des considérations caduques. C'est donc un livre essentiel pour comprendre l'auteur du Grand Verre, mais aussi une époque toute tout entière.
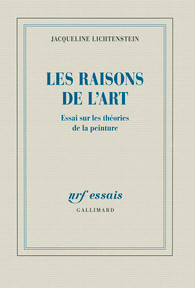
Les Raisons de l'art, Jacqueline Lichstenstein, « NRF essais », Gallimard, 220 p., 17,90 euro.
L'auteur s'insurge contre l'intrusion de la philosophie dans la sphère des arts. Elle la voit comme un déni de sa vérité au nom de grands préceptes généraux. Pour Jacqueline Lichtenstein, le fondateur de cette attitude est Emmanuel Kant. Elle reprend à son compte une remarque de Valery, qui constatait que les individus voient par l'intellect plus que par les yeux. Et il a ajouté en marge : « Utilité des artistes. Conservation des subtilités sensorielles. » Ainsi, la pratique artiste, et puis son histoire, ne peuvent être aboli d'un coup de baguette philosophique. La construction de l'ouvrage est un peu singulière car on aurait pu croire que l'auteur aurait revêtu son armure de Don Quichotte féminin pour pourfendre les ailes des moulins de la philosophie qui s'occupe d'art et d'esthétique. En réalité, elle examine de quelle faisant est née la notion d'esthétique et n'examine que deux moments clefs : la posture de Kant, qui se trompe sur les fondements de la règle pour un art qu'il ignore et puis la polémique entre Heidegger et Shapiro, reprise en ligne de compte par Derrida. (Il faut noter que l'auteur expose très bien les tenants et les aboutissants de cette polémique, qui donne finalement raison à Heidegger et tort à l'historien d'art, car les lignes du philosophe allemand sont plus éloquentes que les questions du second qui paraissent un peu puériles et rendent caduques les spéculations de l'auteur de De la grammatologie). Assez étrangement, elle ne s'en prend guère à Hegel et à son énorme monument (l'Esthétique). Elle pointe un problème qui va en empirant (elle cite Badiou, mais pas Onfray et tant d'autres qui se mêlent d'art en prennent désormais la place des critiques). En revanche, elle examine avec beaucoup de soin de quelle façon l'ébauche d'une critique d'art se formule au XVIIe siècle en France chez des amateurs é »claires, mais aussi chez les peintres. C'est un livre foisonnant et d'une richesse incroyable avec beaucoup d'intuitions. Il pourrait en sortir de deux trois volumes qui développeraient les points mis à jour et laissés sans développements !

Bissière, figure à part, musée de Lodève/Fage, 198 p., 30 euro.
Le titre de ce catalogue de la rétrospective présentée au musée de Lodève peut laisser songeur. En effet, Roger Bissière n'est pas une « figure à part », mais bien l'un des grands acteurs de la peinture abstraite de l'après-guerre. Il a commencé sa carrière comme journaliste, mais a bientôt choisi de se consacrer exclusivement à la peinture. Il enseigne à l'Académie Ranson (il a pour élève Louise bourgeois, Manessier, Vieira da Silva, Etienne-Martin). Mais il reste peu connu comme peintre. Pendant l'Occupation, il s'occupe d'agriculture dans sa région natale, le Lot. Ce n'est qu'après la guerre qu'il peut exposer chez René Drouin en 1947. On découvre ici son oeuvre figurative, assez difficile à cerner, dans le sens où il avait effectué un savant mélange entre Corot et Cézanne ! Mais c'étaient là des oeuvres d'une indéniable singularité ». Pendant les années 30, il passe à une phase vaguement picassienne, importante car cela lui permet de le libérer des préceptes de la figure. Après la Libération, il change de manière, mais n'entre pas de plain-pied dans l'abstraction. Il en vient à réduire les objets figuratifs à des symboles, qu'il place dans des cartouches (Grande composition, 1947). Ou utilise des plans superposés à la façon de Klee (mais l'analogie s'arrête là). A force de schématisation des objets représentés, il en vient à la changer en signes (Jaune et gris, 1950). C'est alors que commence son aventure dans un domaine inconnu, puisqu'il ne revient pas sur les recherches abstraites des décennies précédentes. Son expérience dans le domaine de la tapisserie lui donne une aisance dans la construction d'un espace qui ne paraît pas l'être. C'est un esprit expérimental : il ne cherche pas une formule et revient d'ailleurs à l'emploi d'éléments figuratifs quand il l'entend. Cette oeuvre s'inscrit bien dans l'esprit de ce qu'on appelle, à tort ou à raison, l'Ecole de Paris, qui fut tout, sauf une école !

Niki de Saint Phalle, Camille Morinau, « Hors série Découvertes », Gallimard/Grand Palais, s. p., 8,90 euro.
Ce ne sera pas le seul livre que l'exposition du Grand Palais de la célèbre artiste, la seule femme liée au Nouveau Réalisme. Ce genre d'ouvrage est divertissant et est réservée à un public jeune ou qui ne connaît pas grand chose de son travail. Il nous introduit à ses débuts, quand le tir à la carabine était une de ses caractéristiques en plus de l'assemblage, jusqu'à ses fameuses « Nanas » , dont certaines étaient si grande qu'on pouvait les pénétrer (en tout bien tout honneur !) Un livre donc à mettre entre toutes les mains pour découvrir un macrocosme où le jeu est la première motivation.

Tristesse de la terre, Eric Vuillard, Actes Sud, 176 p., 18 euro.
Ce petit texte est plaisamment manufacturé et ses descriptions humoristiques sont saturées d'un humour aigre. Son sujet peut paraître bien rebattu : Buffalo Bill et le Great Western Show qui a longtemps connu un succès indescriptible, même en Europe. L'auteur se plaît à raconter la fin de la conquête de l'Ouest à travers ce personnage de légende qui n'a jamais rien accompli d'héroïque en dehors d'avoir abattu une quantité énorme de bison pour laisser le champ libre à la construction de la ligne de chemin de fer en même qu'il réduisait les ressources vitales des Indiens. Dans son spectacle, il invente toutes sortes d'histoires : il raconte le massacre de Wounded Knee au cours duquel fut assassiné Sitting Bull et se porte même au secours du général Custer ! Mieux encore : il parvient à convaincre le malheureux Sitting Bull à participer à ces fantaisies équestres de grande dimension avec quelques membres survivants de sa tribu. Ce personnage extravagant, qui n'avait de laisse d'enrichir son répertoire de scènes saisissantes et toujours imaginaires a aussi éprouvé le besoin de fonder une ville qui porta son nom, Cody. Eric Vuillard a bien construit son affaire et elle est aussi plaisante que révélatrice de l'histoire d'une Nation. Dommage qu'il se soit laissez aller à des expressions ou à des tournures de phrases un peu débraillées, ce qui frappe avec l'ensemble du texte qui est d'une écriture simple, rapide et belle.

Troisièmes noces, Tom Lanoye, La Différence, 448 p., 22 euro.
Truculent, à la fois comique et ancré dans la réalité la plus crue, ce roman possède quelque chose entre la farce breughélienne et les plus effrontées satires. Les Troisièmes noces dévoilent toute la verve et l'esprit caustique de cet écrivain flamand qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il nous raconte la vie d'un homosexuel, Martin Seebregs qu'un ami, Norbert Vandessel, parvient à convaincre d'épouser une jeune femme noire, Tamara, (sa propre maîtresse), bien qu'il portât encore le deuil de son amant, Gaétan. Ce mariage ne s'est pas fait sans difficulté. Mais il s'est tout de même célébré à l'Eglise et notre héros s'est retrouvé à partager son appartement avec cette fille étrange. Mais les services de l'immigration, qui soupçonnent des épousailles de complaisance pour que Tamara obtienne la nationalité belge. D'ailleurs les deux fonctionnaires qui mènent cette enquête peuvent montrer au jeune marié, qui a cinquante ans bien sonnés, des photographies montrant Tamara en train de caresser un beau Noir. Martin est furieux et demande des explications et l'accusée d'adultère se défend en expliquant qu'il se de son frère Philip. Alors Seebregs décide de sauver ce parent impromptu et de le loger chez lui. Mais il découvre que les deux jeunes gens sont amants. L'histoire se termine par une sorte d'orgie où tout le monde en censé assouvir ses fantasmes dans un délire dévastateur. C'est un livre plein de drôlerie et où le grotesque tient sa place autant que la vérité de chacun de ses protagonistes, un vérité sans panache. Tom Lanoye a l'âme picaresque et la dérision cheville à l'âme. Il sait toucher là où le bât blesse dans notre monde où l'on permet presque tout et où finalement tout est régi par le conformiste ancestral.

Orphelins de dieu, Marc Biancarelli, Actes Sud, 240 p., 20 euro.
De nouveau l'écrivain nous entraine en Corse, mais cette fois dans la Corse d'autrefois, celle qui est devenue légendaire avec Prosper Mérimée. Une jeune femme, Vénéeande, n'a plus qu'une seule idée en tête : venger la mort de son frère, Petit Charles. Quatre brigands sans scrupule avaient tranché la langue du malheureux berger, encore un enfant. Elle finit par rencontrer l'homme qui allait accomplir son souhait le plus cher et tout le monde le surnommait L'Infernu. Ce soldat d'aventure avait participé à la guerre de libération des Grecs contre les troupes ottomanes à Missolonghi. Mais il avait surtout été l'un des membres de l'armée de malandrins sans foi ni loi de Joseph Antomarchi et de Théodore Poli. Cette troupe a semé la terreur et s'est toujours révélée d'une cruauté sans nom envers ceux qui la combattaient et ceux qu'elle dépouillait. Après de telles expériences, il était prêt à faire quasiment tout. Tout en se remémorant les chevauchées brutales de son existence tumultueuse et ses méfaits innombrables, il se met à échafauder un plan pour venir à bout des quatre frères Santa Lucia. Il finit par parvenir à ses fins, mais trouva la mort au bout de ce combat qui fait penser à un western transposé sur l'île de Beauté. C'est un roman assez beau, fantasque et captivant. Bien sûr, bien des poncifs y font surface. Mais on suit la silhouette de L'Infernu dans ses aventures avec la foi du charbonnier.
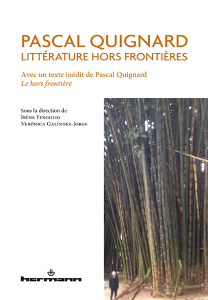
Pascal Quignard, littérature hors frontières, sous la direction d'I. Fenoglio & V. Galìndez-Jorge, Hermann, 214 p., 22 euro.
Les colloques concernant l'oeuvre de Pascal Quignard semblent se multiplier et se mondialiser ! Mais ce n'est pas moi qui m'en plaindrait, loin s'en faut. Cette fois, c'est l'université de Sao Paolo qui célèbre l'écrivain français. Ce dernier a donné un inédit pour l'occasion, un petit essai « le Hors frontière », qui est vraiment une petite perle. Est-ce que l'auteur requiert pour quelques uns de ses livres un « lecteur modèle », pour reprendre l'expression, d'Umberto Eco, comme le suggère l'un des intervenants ? C'est possible. Ce n'est pas une littérature toujours facile. Toutes ces réflexions, parfois pertinentes, parfois ennuyeuses et scolaires (c'est le jeu des colloques, qui donnent toujours à boire et à manger) permettent tout de même de nous faire une idée plus large de l'entreprise de Quignard, qui demeure (je me répète) l'un des meilleurs écrivains français, si l'on oublie ses romans, toujours ratés. Mais tout ce qui l'a écrit en dehors de ce genre mérite l'admiration et donc ces discussions passionnées et ces approfondissements.

Du sexe, Boris Le Roy, Actes Sud, 230 p., 20 euro.
Nous voici devant un livre des plus étranges, qui n'est ni un essai, ni un roman, ni quoi que ce soit de connu et de catalogué. Non, c'est une sorte de méditation sur les tendances sexuelles qui sont traduites, surtout au début, dans des termes plus ou moins scientifiques, opaque, abscons. Puis c'est la dimension technique de la question que l'auteur revendique. Le résultat est déconcertant : c'est bien curieux et par conséquent original dans sa conception comme dans ses applications. Mais ce texte ne séduit pas. Avoir une vision renouvelée de la sexualité est une ambition des plus louables, mais encore faut-il qu'elle rencontre notre propre vision et la renverse de tout son haut. Rien de tel ne se produit. On finit par s'ennuyer ferme, même si Boris Le Roy fait tout son possible pour nous épater. Par moment, c'est assez drôle ou plutôt déboussolant. Ce n'est pas assez pour nous attacher à ce projet. Il y a des chapitres médiocres, d'autres insipides et d'autres encore grotesques. Qu'il relise ses classiques depuis l'Antiquité jusqu'à Bataille et nous donne enfin une interprétation novatrice de la sexualité. A mon sens, seul William S. Burroughs est parvenu jusqu'à ce jour à le faire dans ses oeuvres. Il y a encore du chemin à faire. Cette fois, l'ironie et le cynisme satirique n'ont pas été bons conseillers.

La Guerre 14-18, Christine Joschken, « Photo-poche histoire », Actes Sud, s. p., 13 euro.
Ce petit recueil de photographies de scènes de la guerre, des paysages désolés, des ruines de villages, des hommes aussi qui l'ont combattu, sur le front, ou à l'hôpital, nous donne une idée assez puissante de ce qu'à pu être cet effroyable conflit. Le choix est fait pour qu'on obtienne une vision panoramique qui se dispense ici de commentaires. C'est une série d'images qui racontent ce qui s'est passé pendant ces quatre années du début du XXe siècle. C'est évident : ce livre ne peut pas en si peu de pages tout dire de la Grande Guerre et ce n'est pas son intention. Mais elle constitue le souvenir, comme un grand diaporama destiné à ne jamais oublier ce qui a été cette terrible page d'histoire. De plus, elle nous montre que la photographie a joué un rôle considérable : c'est désormais un instrument indispensable pour documenter et informer. Parmi les innombrables publications qui accompagnent la commémoration du début de « la der des ders », ce recueil de Christine Joschken me semble très approprié pour une première approche.

Un monde flamboyant, Siri Hustvedt, traduit de l'anglais (Etats-Unis), Actes Sud, 416 p., 23 euro.
Voici une nouvelle fois un roman qui concerne l'art contemporain. C'est une mode qui s'est installée et qui donne l'impression d'être un jeu de vases communicants : moins les écrivains s'intéressent à l'art d'aujourd'hui, plus ils ont tendance à écrire des fictions à son sujet ! Celui est le fruit d'un travail de longue haleine : l'auteur s'est mis en tête de construire une histoire complexe à partir de la disparition d'une créatrice, Hariet Burden, qui n'a pas été reconnue de son vivant bien qu'elle ait épouser un marchand de tableaux réputé, Félix Lord. Encouragé par son directeur de thèse, le jeune universitaire, I. V. Hess, se met en quête de tous les documents de la main de l'artiste, mais rencontre de nombreuses personnes l'ayant connue et enregistre la conversation qu'il a pu avoir avec elles. Peu à peu, avec patience et fougue, le chercheur parvient à reconstituer le parcours d'Hariet Burden, un parcours aussi sinueux qu'étrange. Un drame est survenu dans sa vie : la mort brutale de son mari, qui l'entraîne à considérer et son travail et le monde d'une autre manière. Cette remise en question est radicale puisqu'elle va jusqu'à nier les fondements de cet art radical dont elle avait adopté le langage. Ce roman est bien élaboré et peut se lire comme une intrigue policière. La complexité des agissements et des pensées de l'artiste est mise en scène de façon à rendre le puzzle pas trop ésotérique. Le défaut dans la cuirasse de cet ouvrage est que Siri Hustvedt attribue à cette créatrice beaucoup d'autres de livres et d'écrits. Mais l'épouse de Paul Auster s'est bien tirée de ce faux pas initial en introduisant une histoire de pseudonyme, car Hariet Burden a imaginé un double masculin, Richard Brickman, qui lui a servi de cheval de Troie. Bien sûr, elle se sert de cette reconstruction d'une existence paradoxale pour s'interroger sur ce qui fait l'essence d'une quête littéraire, qui est sous-tendue par l'invention de toutes sortes de subterfuges et de machinations pour faire admettre la réalité de ce qui est le fuit d'une création mentale.

Trop, Jean-Louis Fournier, La Différence, 192 p., 16 euro.
Il s'agit là d'une poche. L'auteur s'est interrogé sur l'excessive accumulation des choses dans la société française et à mis en parallèle les produits de consommation courante et le salon du livre, c'est-à-dire la métaphore du système éditorial. Son moto : « trop de livres ! ». C'est une idée amusante car il a construit ce petit livrer en digne émule de Raymond Queneau. Mais si l'idée est fondée, sa mise en oeuvre est un peu légère. Ce n'est pas « un livre en trop », mais un livre un peu trop léger.

Bye bye Elvis, Caroline de Mulder, Actes Sud, 286 p., 20 euro.
Le roman est en réalité l'alternance de deux histoire : la première est celle d'Elvis Presley, le King, dans toute sa splendeur, mais surtout dans sa bien triste réalité existentielle, le seconde, celle d'un vieil homme nommé John White, qui vit à Paris avenue Pierre Ier de Serbie. Longtemps on se demande si les deux histoires ne vont pas se croiser, qu'il existe un lien secret entre ces deux destins. Eh bien, non, ou je n'ai rien compris. Les vingt années que passe Yvonne, la veuve d'un militaire, qui entre dans sa demeure en qualité d'aide-soignante et qui devient peu à peu sa confidente et une sorte de majordome, sont celles de la naissance et de la cristallisation d'une relation improbable entre cette dernière et cet énigmatique personnage, qui reçoit de l'argent de manière régulière. Et puis l'argent vient à manquer, il quitte son appartement, il disparaît, vit chez un étrange personnage et disparaît de nouveau, cette fois à jamais. Ce que l'auteur raconte d'Elvis Presley, nul ne l'ignore. Quant à l'autre affaire, elle est dépeinte de manière touchante mais perd de son sens dans cette alternance de chapitres entre les dessous de la glorieuse carrière du jeune Américain de Graceland et les bizarreries de ce John White...
|
