
Bernard Pagès Colin Lemoine, Domaine de Kerguéhennec, 96 p., 20 euro
Sans l'ombre d'un doute, Bernard Pagès est l'un des plus grands sculpteurs vivants en France. Il faudrait rajouter à cette liste, une figure originale comme Vladimir Soda, et aussi des peintres qui ont aussi fait des oeuvres qui ont une dimension sculpturale, comme Daniel Dezeuze et Christian Jaccard, mais c'est une autre affaire). Dès la brève mais passionnante saison de Supports/Surfaces, il a fait montre de ses deux intentions : rompre avec la tradition (même celle du moderne) et donner une autre orientation à l'art sculptural. Les colonnes qu'il a réalisées pendant les années 80 étaient une sorte de méditation sur l'histoire de l'art, non plus avec de belles pierres taillées, mais du bois, de la rocaille, du béton coloré, et que sais-je encore. C'était une sorte de défi au bon goût et au culte du passé, mais pas une oeuvre destructrice de l'art. Cétait une démonstration que le beau pouvait apparaître avec des moyens « baroques », c'est-à-dire irréguliers. Il n'a dès lors fait qu'élargir le champ de cette exploration de créer des sculptures qui possède une forte charge esthétique (et critique en même temps) en utilisant des procédés singuliers. Je me rappelle avoir vu une magnifique exposition de ses travaux récents au Musée d'Art Moderne de Nice, avec des bottes de foin ou des meules comme socles. Il y avait toutes sortes de matériaux confiés à cette fête, où il n'avait pas renié ses convictions premières. Il n'avait fait que les enrichir. En ce qui concerne l'exposition du Domaine de Kerguéhennec, qu'on peut visiter jusqu'au 5 novembre, il présente une série d'oeuvres conçues sur le même principe. Mais une oeuvre plus imposante, « majeure », pourrait-on dire, intitulée Le Toupet (2005) donne le la de cette suite : il s'agit un tronc de peuplier scié, teint en blanc et calciné d'où s'échappent des tiges de fer oxydé et forgé qui s'enchevêtrent et finissent par confluer en leur extrémité. L'ensemble est placé à l'horizontal. Les autres pièces, baptisés Fléaux (1994) sont eux en béton, en bois et aussi en fer oxydé et forgé. Ils constituent une sorte de colonnades qui aurait été renversée et qui aurait ensuite été surmontée d'éléments en fer qui ont une forme étrange car les tiges sont tordues et supportent une barre plus large. Cela peut donner en effet l'idée d'un fléau, mais presque de façon analogique, car la ressemblance n'est pas apparente. Les tiges ne sont pas symétriques et ne sortent de la même façon du socle. Chaque socle est différent et portent des enrichissements en fer, comme on en faisait autrefois pour les instruments agricoles. Mais le tout forme un ensemble rythmique et donc harmonieux. C'est le paradoxe de Pagès. Dans une autre salle ont été disposées La Torse I et La Torse II. Il s'agit de grandes structures qui paraissent avoir été démantibulés et qui associent l'idée du bois calciné et celle de l'acier (peint avec un jaune de type industriel) : à première vue, on dirait une oeuvre minimaliste en trois dimensions soumise à des torsions violentes et puis, la partie en bois, rappelle les travaux des artistes de l'arte povera. Je ne sais si Pagès a voulu faire ces références ou non. Mais cela saute aux yeux. Il en résulte une composition spatiale qui, malgré ses convulsions multiples et sa déstructuration, constitue une totalité formelle parfaitement équilibrée. C'est sa manière à lui de retrouver l'art de la torsion du maniérisme dans un contexte actuel. Enfin, dans le grand jardin, on peut voir ce semble de prime abord un dallage -, ou plutôt sa ruine. En s'approchant, on découvre des entrelacs de fil de fer qui séparent chaque dalle. L'ensemble n'est pas de forme régulière. C'est une pièce sur laquelle on n'y déambule pas ; on doit la contourner et s'interroger sur cette curieuse relation du fer à béton soudé et de la pierre qu'il a appelé Le Profil déhanché (1991). Sans être une exposition rétrospective, on a ici l'opportunité de prendre la mesure de l'évolution de la pensée de Bernard Pagès et c'est un moment de vraie délectation tout en restant un moment de réflexion acide sur la réalité de l'art par les temps qui courent.

Calder, forgeron de géantes libellules, Benoît Decron, Antoine Charbonnier & Anne Dubus, musée Soulages, Rodez / Gallimard, 208 p., 35 euro
Calder à la Gouacherie, préface de Daniel Abadie, Fondation Zervos, Vézela y / Somogy Editions d'Art, 80 p., 20 euro
Le grand intérêt du catalogue de l'exposition du musée Soulages à Rodez est de refléter l'esprit d'une exposition qui a eu pour ambition de nous montrer les différentes facettes de l'oeuvre d'Alexander Calder (1898-1976), de ce que nous connaissons le mieux de son art (les Stabiles et les Mobiles), mais aussi des créations de ses débuts, qu'on a pu découvrir lors de sa dernière exposition au Centre Pompidou en 2009, qui était passionnante, car elle nous a révélé la gestation de son oeuvre à Paris jusqu'au jour où il crée son premier chef-d'oeuvre, Le Cirque (1926, mais qu'il a compléter pendant de nombreuses années)) et un peu au-delà de cette magnifique invention plastique avec du fil de fer qu'il transportait dans deux valises. On voit d'ailleurs certaines pièces ici qui appartiennent à cet univers, comme Red Horse and Green Sulky ou le Petit cheval et le Singe entre autres. On y découvre aussi des dessins en noir et blanc de chapiteaux de cirque avec les différents éléments servant aux numéros d'acrobatie ou encore un équilibriste, tous datés de 1925. Enfin, sont présentés de nombreux et délicieux petits dessins qui complètent ce panorama allant jusqu'en 1952 et des petites sculptures d'animaux (La vache, L'Oiseau aux roubignolles) exécutées en 1954. L'esprit du cirque n'a jamais cessé de le hanter. Et il a nourri sa quête artistique tout au long de sa vie. Déjà dans ses compositions abstraites de 1932 ou 1933, s'il ne fait pas référence au spectacle des clowns ou des écuyères, des acrobates et des dresseurs de fauves, les objets qu'il met en scène, sont placés dans des situations de poids et de contrepoids, ou d'équilibres fragiles et pourtant parfaitement agencés dans l'espace. Plus tard, comme on le voit dans le Petit panneau bleu (vers 1936), il explore un autre monde plastique, mais toujours avec une dimension ludique qu'on ne retrouve que chez Jean Arp. Pendant la même période, il continue à faire des personnages de foire foraine, comme L'Haltérophile (1930). Il développe en parallèle une représentation du cosmos, qui est purement imaginaire. Ce sont des formes très colorées, oniriques, très contrastées dans leurs couleurs, qui flottent dans une dimension inconnue, un peu surréaliste. Son oeuvre graphique a beaucoup mis l'accent sur ce point comme on peut parfaitement le constater dans les oeuvres graphiques exposés à la Fondation Zervos à Vézelay, qui sont placés à l'enseigne des astres, métamorphosés avec fantaisie sous sa main, souvent proches d'un style digne des humoristes. Ce processus est une sorte de fil rouge de son operare : il ne se prend pas au sérieux et ne veux pas qu'on contemple ce qu'il fait avec sérieux. Et pourtant, il s'est engagé dans une recherche très complexe, ses mobiles sont des petits bijoux non seulement sur le plan esthétique, mais aussi sur le plan de la construction : sans un plan, il est quasiment impossible de remonter une sculpture de ce type ! Il peut se montrer moqueur avec sa Jupe noire de 1965, une sculpture à la fois amusante et grave, et, plus il avançait et plus il a tenu à souligner cette note facétieuse. Ces deux catalogue, l'un avec ampleur, l'autre d'une manière plus spécifique en se concentrant sur les oeuvres sur papier, montre que l'art de Calder est devenu un tour de force technique surprenant tout en demeure d'une fraicheur d'inspiration et d'une jeunesse spirituelle assez peu communes.

Dalì, Eureka, sous la direction de Nathalie Gallissot & Jean-Michel Bouhours, musée d'art moderne de Céret / Somogy Editions d'Art, 208 p., 29 euro
Le plus grand attrait de cette publication et de l'exposition qu'il accompagne est d'avoir mis l'accent sur la relation de Salvador Dalì (1904-1989) avec les sciences. Ce n'est donc pas seulement une sorte de commémoration de la manifestation que l'artiste avait préparé pour ce musée de son vivant en 1965. Au fond, on ne retient de lui que les aspects bouffons de sa personnalité, la mise en scène très calculée d'une folie un peu roublarde, sa capacité de s'introduire dans la sphère de la mode ou dans celle de la publicité, et son goût excessif de l'argent, dénoncé par ses anciens amis surréalistes, à commencer par André Breton. Plusieurs essais dans cet ouvrage montre à quel point il s'est passionné pour les sciences, pour les savants de la Renaissance, mais aussi pour les scientifiques de son temps. Aucun domaine n'était délaissé. Il s'est intéressé à la psychiatrie avec Jacques Lacan et il est allé rendre visite à Sigmund Freud à Londres la dernière année de l'existence de ce dernier, il a suivi les travaux sur l'ADN du biochimiste américain James Dewey Watson, qui a reçu le prix Nobel en 1962, il a fréquenté le physicien britannique d'origine hongroise Dennis Gabor, qui a découvert le principe de l'hologramme, dont Dalì va faire usage dans les années soixante-dix. Il a aussi collaboré avec Marcel pages, qui avait avancé le concept d'anti-gravitation dès 1916. A la fin de son existence, il a organisé en 1985 un colloque scientifique intitulé « Procès au hasard » au sein de son musée à Figueras. Bien sûr, toutes les connaissances dont il s'est nourri n'ont pas fait de lui un homme de science qui en appliquerait les principes à son art, mais on doit savoir qu'elles lui ont énormément servi pour le développement de sa célèbre méthode de la paranoïa-critique. Il avait affirmé que l'artiste moderne se situait à mi-chemin entre l'art et de la science dans un texte baptisé La Conquête de l'irrationnel. Visage caché est un pur joyau), comme il pouvait s'intéresser à la médecine. Le pourrissement, qui le hante tant (d'où le texte intitulé L'Ane pourri, 1930), les métamorphoses anatomiques, les productions du rêve, cela prend dès lors un autre sens quand on sait à quel point il a recherché dans le monde savant des sources d'inspiration, mais aussi des fondements à son oeuvre. La plus grand écart de l'exposition tourne sur ces confrontations entre ses tableaux ou ses dessins et une discipline scientifique ou une autre et c'est vraiment très éclairant. L'article de Michèle Harroch approfondit la question du plaisir sans frein, de la jouissance, du franchissement des bornes interdites par cet homme complexe et déchiré. Il aimait l'érotisme et n'avait la pruderie un peu enfantine de la majorité des surréalistes français. On fait un détour par L'Angélus de Millet, autre obsession tenace et passionnante de l'artiste et Pilar Parcerisas étudie avec brio ses relations avec les proses et la poésie de Lautréamont. Sans passer tous les essais en revue, je ne peux que conseiller la lecture de ce catalogue qui fait voir Dalì dans une perspective vraiment différente.

Questions de méthode en histoire de l'art, Otto Pächt, traduit de l'allemand par Jean Lacoste, préface de Delphine Galloy, éditions Macula, 208 p., 25 euro
Ne lisant pas l'allemand (un manque à mon éducation rédhibitoire), je n'ai pas connu l'oeuvre d'Otto Pächt (1902-1988). C'est bien regrettable, car cet historien d'art viennois, élève d'Alois Reigl et de Julius Schlosser, ami de Robert Musil et d'Oskar Kokoschka, a dû s'exiler peu avant L'Anschluss : il est devenu alors direction de la National Gallery of Ireland. Puis il a travaillé au Warburg Institute et a été lecteur à l'Oriel College. Il est revenu à Vienne en 1963 et y a poursuivi son enseignement. Considéré comme faisant partie de l'Ecole viennoise, il a surtout été l'adversaire des thèses d'Erwin Panofky, sa bête noire jusqu'à la fin des jours, qu'il a fustigées dès 1956. Comme l'explique très bien Delphine Galloy dans sa préface, il a tenu à faire comprendre comment aborder une oeuvre d'art, l'observer et la commenter, sans recourir aux méthodes généralement utilisées et en évitant tout esprit de système, même aussi subtil que celui de Panofsky. En fait, il s'est très tôt interrogé sur l'histoire de l'art elle-même (depuis 1925 semble-t-il) et peut être regarder comme l'avant-courrier de cette nouvelle discipline qu'est l'histoire de l'histoire de l'art. Ses principes repose sur deux bases essentielles : la définition de la structure de l'objet considéré et son contexte. Toute sa pensée part du fait que nous déformons l'oeuvre d'art quand on la regarde : nous la plaçons dans une optique esthétique, sociale et culturelle qui est celle de notre temps. Il faut don tenter de corriger ce défaut. Pour ce faire, il en revient aux vertus de l'ekphrasis des Anciens et il salue Rilke pour avoir souligné la difficulté de restituer une oeuvre par le langage. Sa méthodologie a été saluée par Meyer Shapiro en 1936. Dans ce livre, où il s'efforce de faire comprendre à ses étudiants la nécessité d'une méthode plus scientifique et partant d'une connaissance très exercée de l'apparence même de l'ouvrage considéré, avant toute analyse, et ensuite d'une exploration des diverses facteurs qui lui ont permis de voir le jour et d'être reconnue comme étant de valeur. Cela semble tomber sur le bon sens, mais demeure une opération assez complexe et qui, paradoxalement, est assez proche de l'iconologie proposée par Panofsky, dont la première étape est l'étude iconographique. Peut-être que la grande différence est la volonté de faire une science de l'histoire de l'art, ce qui reste, à mon sens, une gageure. On lira avec profit ses commentaires sur l'évolutionnisme de Reigl, qu'il conteste, et puis ses vues sur la constitution du style selon des exigences de plusieurs natures, qui ne sont pas uniquement formelles. C'est un ouvrage passionnant, très accessible, même si ses a priori et si ses développements ne sont pas toujours faciles à suivre, car il tente de trouver un cheminement spéculatifs entre d'autres théories assez voisines, mais qui ne lui donnent pas entièrement satisfaction. Toute personne désireuse de pénétrer une phase de l'histoire de l'art ou de s'attacher à un artiste ou à un style, doit lire absolument ces Questions.

Venet, sculpture, Thierry Davila & Erik Verhagen, Editions du Regard, 256 p., 49 euro
Bernard Venet est le seul sculpteur français qui soit parvenu à instaurer une solide réputation aux Etats-Unis. Il s'est établi depuis longtemps outre-Atlantique et a développé une oeuvre qui prolonge les spéculations du minimalisme. Il a commencé par être peintre. Il a choisi alors d'adopter un langage abstrait jusqu'à parvenir à un travail de la monochromie. Puis il a choisi d'utiliser le goudron pour obtenir un noir profond, s'inspirant sans doute des recherches d'Alberto Burri. C'est alors qu'il fait une oeuvre en volume en utilisant du charbon entre 1961 et 1963. En 1966, il décide de s'installer à New York. Son univers plastique repose sur des bases mathématiques. Il s'oriente alors vers une posture conceptuelle. Mais son exil volontaire ne le fait pas oublier en Europe, bien au contraire. Dans ce magnifique ouvrage, il est peu question de ses débuts dans une suite chronologique : des références nombreuses à ses créations plus anciennes traversent tout le livre. Il commence par des travaux récents comme ses Effondrements de 2012 et ses Arcs de la fin des années 90. L'arc est depuis longtemps son matériau de prédilection et sa sculpture est souvent monumentale. Venet joue sur d'infimes modulations de son système de base, qui voit surtout des volumes arrondis, avec un ,nombre plus ou moins grand d'éléments de longueurs différentes. Le caractère très économe de son langage qui se résume à peu de formes n'en est pas moins riche et divers par l'ajustement de ces pièces tendant au cercle ; ce sont des arcs dans le sens géométrique et sans allusion au figuré. Il utilise aussi des lignes brisées qui associent des fragments de triangles, comme dans Angles inégaux aigus en 2016. Il peut aussi se limiter à une seule pièce, telle la grande réalisation faite pour le jardin Albert Ier de Nice (1988). Il peut aussi à l'inverse composer des séries de sculptures comme les 84 Arcs penchés présentés lors d'une exposition à Marseille. Parfois il peut faire des oeuvres gigantesques qui interviennent sur le paysage ou sur un monument, comme la Ligne droite à Antibes (2009). En définitive Venet fait partie de ces artistes contemporains qui ont entrepris de faire une oeuvre homogènes, avec le moins possibles de tropes, mais en multipliant les variations de sa problématique. C'est efficace et conçu avec une réflexion poussée qui l'empêche de tomber dans l'ornière de la répétition stérile. Mais c'est aussi sa limite. En effet, en insistant ainsi sur sa marque de fabrique, il s'est sans doute pas mal brimé et n'a pas laissé son imaginaire imprimer à ses créations plus de liberté dans les formes et dans leurs possibles expansions dans la troisième dimension. Mais on ne change pas une formule gagnante, n'est-ce pas ?

Gavrinis, Illès Sarkantyu, Domaine de Kerguéhennec, s. p., 19 euro
Il existe une île dans le golfe du Morbihan qui s'appelle Gavrinis. Elle recèle le plus important monument de l'âge néolithique (on estime qu'il aurait été construit vers 3.500 avant notre ère). A l'époque, cette île qui se trouve dans le golfe du Morbihan. Ce n'est que bien tard qu'elle fut rattachée à la terre de Bretagne. C'est le plus grand cairn connu. Il a été découvert en 1825 et dans ses Notes de voyage dans l'Ouest de la France, Prosper Mérimée, venu superviser les travaux de restauration, a noté en 1835 : « Ce qui distingue le monument de Gavrinis de tous les dolmens que j'ai vus, c'est que presque toutes les pierres composant ses parois sont sculptées et couvertes de dessins bizarres. Ce sont des courbes, des lignes droites, brisées, tracées et combinées de cent manières différentes. » Les archéologues se sont passionnés pour cette architecture aux sculptures pour le moins surprenantes. Toutes ces pierres sont couvertes de formes courbes et souvent concentriques, avec des réserves avec un autre motif. C'est très impressionnant et aussi d'une grande puissance visuelle. Cette construction renferme en son sein un dolmen. Il serait bien aventureux d'en expliquer la fonction rituelle et Janos Ber, dans sa présentation, s'en garde bien. Les photographies d'Illès Sarkantyu nous présente un grand nombre de ces pierres sculptées, qui fond pensées à ce que les archéologues ont pu retrouver dans d'autres sites en des continents lointains. Mais ce qu'elle nous fait découvrir est unique en son genre. Créé vraisemblablement avant la fondation de la civilisation égyptienne, le site de Gavrinis est aussi mystérieux que magnifique, son mystère ajoutant bien sûr un peu plus d'attrait pour ces sculptures tout en rondeurs et aussi à l'ensemble de ce vaste monument.

Arroyo dans le respect des traditions, Fondation Marguerite & Aimé Maeght / Flammarion, 240 p., 35 euro.
Deux balles de tennis, Eduardo Arroyo, Flammarion, 240 p., 14 euro
A la fin du franquisme et pendant la période de l'instauration de la monarchie constitutionnelle, Eduardo Arroyo est devenu, dans le monde artistique, le symbole de cette transformation politique et culturelle. Son oeuvre s'apparenta très vite au courant réaliste (la figuration narrative) qui s'était fait jour surtout en France. Il avait commencé par faire des caricatures de Bonaparte au pont d'Arcole, de la reine d'Angleterre ou de Winston Churchill. Plus tard, il a exécuté une Ronde de nuit aux gourdins. En somme, son penchant était celui de la dérision et du détournement des grandes peintures historiques. Il a fait aussi un travail très curieux sur caoutchouc représentant des tapis, plus ou moins roulés (en 1976), puis le chien et le chat de Kreuzberg (toujours sous cette même forme). Il ne va jamais cesser de réaliser ces détournements d'oeuvres célèbres. Ce n'est qu'à la fin des années soixante-dix qu'il a opté pour certains éléments : le visage noir, la chemise blanche de smoking, le chapeau, et puis toute une scénographie mystérieuse, qui est devenu au début des années quatre-vingts sa marque de fabrique. Il y a toujours cette nuance de dérision, parfois même de féroce humour noir (il n'est que de penser à L'Agneau mystique de 2008), mais l'histoire (incompréhensible par définition) devient plus importante comme on le voit dans le cycle Toute la ville en parle (1982). L'univers pictural d'Arroyo n'a jamais cessé d'évoluer tout en conservant un certain nombre de constantes. Ce qui est le plus passionnant dans ce catalogue, c'est la présence notable de sa sculpture (un art qu'il a cultivé de plus en plus depuis les dernières années du siècle précédent) et de ses oeuvres en céramique. Cette exposition n'est pas une rétrospective, mais un parcours, tel que l'artiste a voulu le construire dans le cadre delà fondation Maeght. Il ne faut pas négliger une autre facette de la personnalité d'Eduardo Arroyo, qui est celle de l'écriture. Il aime écrire et révèle dans ce domaine un certain talent. Ses Deux balles de tennis le prouvent une fois de plus. Il ne s'agit pas ici d'une autobiographie, mais de rêves relatées et ces rêves puisent beaucoup dans l'histoire de son existence, mais aussi dans celle de son oeuvre picturale. Il voit au début l'éléphant d'Alfred Kubin lui apporté ses livres pour qu'ils soient enterrés près de lui. Et il passe d'une vision à une autre, d'une histoire incongrue à une autre, à des figures amicales à d'autres dans des situations improbables et souvent cocasses. On retrouve dans ces songeries sans queue ni tête des figures connues du monde de l'art contemporain. Chaque chapitre trait d'une question, allant de la femme à barbe et du chevalier d'Eon aux tailleurs de prêt-à-porter jusqu'aux clown. Ces points ne font pas l'objet d'une étude, mais de digressions, passant sans cesse d'une association à une autre, avec l'idée au fond de donner la clef d'une aventure esthétique. Cette clef ne nous est pas révélée, mais des éléments de ces pérégrinations intérieures de l'artiste sont mises à jour par ces contes à dormir debout. C'est plein d'esprit et c'est aussi un divertissement qui donne à réfléchir. Il y a là un lointain écho du surréalisme et de ses campagnes de rêves et de sa vision onirique de l'univers. Mais dans une autre optique et qui n'appartient qu'à Arroyo.
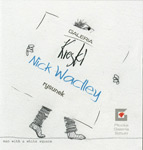
An A to Z in pictures, Nick Wadley, 32 p., 20 euro.nick.wadley@btinternet.com.
Nick Wadley est sans aucun doute le meilleur « humoriste » (pour reprendre le terme qu'on utilisait en France au XIXe siècle) que compte la Grande-Bretagne aujourd'hui. C'est un vrai artiste, mais qui est descendu dans l'arène du dessin -, mais sans se consacrer à la politique. Il observe le monde et s'en joue. Dans ce dernier recueil, il ne traite pas un thème comme dans ses précédents volumes, a fait un abécédaire très personnel. Ce qui est amusant dans son livre, c'est que bon nombre de sujets sont facilement identifiables par rapport à la lettre donnée, mais pas toujours. On doit réfléchir un certain temps avant de trouver la clef du problème. Son humour est délicat et subtile. Toutes ces images coloriées rassemblées dans une page forment une composition anarchiste qui propose un jeu nous obligeant à passer d'une figure à l'autre avec facilité jusqu'à temps qu'une énigme se propose tout d'un coup. Il me faut préciser que la page se présente comme un collage, car l'auteur a parfois placé des photographies et que les disposition des dessins est différent pour chaque lettre. En somme, c'est un plaisir chaque fois renouvelé à remonter le cours de l'alphabet latin et de jouer avec les mots dans ce micro labyrinthe des suggestions visuelles. Le style de Nick Wadley est un délice car il sait très bien naviguer entre un style ancien et un style moderne, en imaginant une écriture très personnelle. A se procurer sans faute si l'on est angliciste !

Le Cahier des ombres, Jocelyne Alloucherie, Domaine de Kerguéhennec, 126 p., 20 euro
Ce beau catalogue n'est pas que la simple mémoire de l'exposition des photographies de Jocelyne Alloucherie, qui tourne essentiellement sur la capture de l'image des ombres faites par les arbres (sujet très à la mode ces derniers temps dans le microcosme de la photographie !). Toutefois, le dispositif qu'elle propose au visiteur est assez original, puisque ses clichés sont d'une grande dimension et elle a rendu souvent abstraites les formes saisies. L'arbre demeure présent, mais ce que l'artiste a retenu prend des allures fantomatiques ou parfois étranges. On comprend rapidement que l'arbre n'est qu'un support à sa réflexion, qui est plus subtile qu'il ne paraît. En outre, certaines de ses compositions sont réalisées avec l'adjonction de sable. Tout le processus de ce travail précis, l'artiste l'a narré dans plusieurs textes qui figurent dans le catalogue et qui sont assez beaux, fruits d'une pensée sensible et patiente, qui ne cesse de rechercher le sens le plus intime de sa démarche. C'est écrit avec délicatesse et une grande finesse d'esprit, et surtout avec le désir non d'explique ces oeuvres, mais plutôt de s'expliquer à soi-même de quelle façon elle en est venue à les élaborer comme elle l'a fait. Voici une recherche qui part d'un point somme toute sans beaucoup d'originalité et qui parvient à transporter cette vision dans un espace qui lui donne bien d'autres résonances. Ce journal (D'ombre en ombre, L'Enclos, etc.) est précieux pour suivre la « fabrication » de toutes ces propositions plastiques qui, au fil des années (l'auteur nous fait remonter au début des années 90). C'est un merveilleux voyage exemplaire et la manifestation d'une authentique poésie.

Mon âme pourpre, Ricciotto Canudo, texte établi et présenté par Giovanni Dotoli, Hermann, 162 p., 15 euro
Drôle de personnage que ce Ricciotto Canudo (1877—1923) ! Il demeure dans notre mémoire comme l'inventeur de l'expression « septième art » (qu'il a d'ailleurs commencé par appeler « sixième art » en 1911. Il s'est aussi illustré en publiant la revue Montjoie ! en 1913 qui est un périodique nationaliste, où il a néanmoins publié Apollinaire, Cendrars, Fargue, etc. Il se lie d'amitié avec des musiciens, des artistes et des écrivains qui ont compté en cette période. En 1914, il rédige avec Cendrars un « Appel aux amis de la France » qui paraît dans Le Figaro et il s'enrôle dans la Légion étrangère. Il participe à de nombreux combats en France et en Macédoine, est plusieurs fois blessés et a reçu plusieurs médailles. Mais on a oublié son oeuvre romanesque et poétique et encore plus ses livres relatant son expérience de la guerre. La réédition de son Âme pourpre, est une véritable révélation car il ne s'agit pas à proprement parler de souvenirs de guerre ou d'un fresque romanesque reconstituant les faits et gestes de ces millions d'hommes jetés dans la tourmente belliqueuse. Cela ne ressemble ni à Barbusse, ni à Jünger. Il s'efforce de traduire ce qu'il a éprouvé en son fort intérieur, de donner une vision poétique (mais en rien édulcorée ou rendue mythique des combats, de la vie à l'arrière, des hôpitaux et des drames infinis dont il a pu être témoin. Ce livre est superbe parce qu'il ne repose pas sur le pathos ou l'horreur, mais sur la terrible vérité des événements. C'est à la fois très réaliste et très symboliste. On ne peut pas ressortir de la lecture de ces pages sans être ébranlé. Mais il ne fait aucun commentaire moral sur ces années de combat contre les Allemands ou les Turcs. Ce qui compte à ses yeux, c'est que le lecteur comprenne la dimension irréelle du destin du combattant sans jamais perdre de vue la vérité épouvantable de ce conflit dont personne n'avait pu imaginer l'horreur.

Vera, Karl Geary, traduit de l'anglais (Irlande) par Céline Leroy, Rivages, 256 p., 21,50 euro
Les premières pages de ce roman nous font aussitôt penser à un énième roman néoréaliste à la sauce postmoderne. En plus, la traduction fait forcément perdre la saveur du langage parlé des bas quartiers de Dublin. Le choix stylistique de l'auteur est bien dans l'air du temps qui se caractérise par une nostalgie des derniers recoins citadins pouvant faire songer de plus ou moins loin aux mauvais lieux dépeints par Charles Dickens ! Mais, peu à peu, le récit prend un rythme et si les péripéties du jeune Sonny ne nous passionnent guère (ses fréquentations, son milieu familial, son renvoi de l'école pour avoir volé des morceaux de vélos, etc.), on est peu à peu saisi par la curieuse relation qu'il va établir avec une femme des beaux quartiers de la capitale, qui lui demande de faire des travaux chez elle. Le jeune garçon va être subjugué par cette femme énigmatique, qui n'est pas toute jeune, mais dont il admire l'élégance, lui qui vient d'un monde où l'idée d'élégance n'existe pas. Il est même fasciné par la beauté des étoffes qu'elle porte et surtout par cette aura mystérieuse qu'il y autour d'elle qui la rend encore plus belle à ses yeux. Ils finissent par devenir amants. Peu à peu il découvre que ce fameux mystère est lié à son état de santé et il tombe sur de bien inquiétants médicaments dans sa pharmacie. Il devine qu'elle ne va pas bien du tout et les rares paroles qu'elle lui adresse renforcent cette sensation. Il l'aime, c'est évident et s'inquiète beaucoup pour elle jusqu'au jour où il la retrouve dans un hôpital. Tout cela est assez peu crédible, mais je l'avoue, je me suis laissé prendre au jeu dans la seconde partie de l'ouvrage, qui est prenante et émouvante. Le roman, ennuyeux au début, trouve un rythme et une tension dans sa seconde partie et cette liaison improbable ne laisse pas indifférent, même si tous ces ingrédients sont improbables. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un fabuleux roman, mais c'est néanmoins un récit peu ordinaire qui a sa force et un pouvoir d'attraction indéniable.

Hérésies glorieuses, Lisa McInerney, traduit de l'anglais (Irlande) par Catherine Richard-Mas, Joëlle Losfeld Editions, 462 p., 23,50 euro
Cet imposant roman irlandais est un curieux mélange d'ancienne littérature et de littérature contemporaine. C'est un mélange explosif ! On éprouve le sentiment que le roman irlandais moderne a tout oublié de Yeats, de Joyce, de George Moore et même de Flann O'Brien. Ces auteurs se veulent modernes, désireux de représenter la vie d'aujourd'hui, et pour ces écrivains relativement jeunes, cela signifie employer la langue vernaculaire et se concentrer sur les quartiers pauvres des villes moyennes de l'île. Ils ne sont pas naturalistes, bien sûr, mais ils abusent d'un réalisme assez bizarre car ils mêlent des intrigues tout à fait improbables à des descriptions des lieux les plus glauques de l'urbanité à quelques exceptions près (il y a une héroïne qui vient des beaux quartiers, mais qui finit par rejoindre ce bal des maudits). Lisa McInerney ne manque ni de talent, ni de savoir faire bien qu'il s'agisse de son premier roman. C'est curieux mélange de mélodrame et d'ethnologie du temps présent, de romance et de sociologie. Une foule de personnages y circulent, dans un univers marqué par le chômage, la drogue, la prostitution, la petite criminalité. En somme, nous sommes plongés dans le récit de divers destins qui se croisent et interfèrent les uns sur les autres, souvent pour accentuer leur malaise et leur difficulté extrême à exister dans ce monde qui semble les rejeter. Lisa McInerney n'hésite pas un instant à utiliser tous les artifices du genre et même en rajoute. Le début de l'ouvrage est d'ailleurs caractéristique avec ce meurtre effroyable commis par cette mère après une absence de quelques vingt années : c'est difficile à comprendre et à admettre. Mais peu importe, elle continue dans cette veine, avec des passages heureux. En somme, c'est une littérature résolument héritière des grands feuilletons du temps de Dumas, mais sans leur poésie propre. L'échec des personnages à échapper à leur condition, l'absence totale d'éthique qui marque ce fort volume, correspond bien à certains traits typiques de la société occidentale et, sans doute, de la société irlandaise, qui reste très marquée par la religion. Et puis il y a cette manière d'écrire qui force le trait avec toutes sortes d'expressions vulgaires ou de phrases volontairement mal tournées pour faire « plus vrai ». Mais il n'y a pas de vérité dans la littérature de fiction. Il peut y avoir la révélation d'une vérité, sa mise en scène, et donc sa transposition. L'auteur est doué, il faut le reconnaître, car elle sait manier sa plume et bâtir des situations, même si elles ne sont guère crédibles. Mais ce don ne suffit pas à produire un bon roman et encore moins, évidemment, un excellent roman. C'est un produit astucieusement fabriqué. Et, s'il n'avait pas été si long et si confus, plaisant à lire.

Brandebourg, Juli Zeh, traduit de l'allemand par Rose Labourie, Actes Sud, 528 p., 23,80 euro
Nous voici confronté à un roman d'un genre très spécial. Nous avons affaire ici à une romancière aguerrie (elle a déjà publié plusieurs livres) et qui sais écrire avec une rare méticulosité. Elle a du style et une sorte de persévérance dans ses architectures narratives qui sont remarquables. Mais ce qui trouble dans ce nouveau roman, c'est cette étrange façon d'examiner à la loupe une petite localité du Brandebourg (länder qui se trouvait avant 1989 en R.D.A.), Unterleuden, qui voit son existence bouleversée par la nouvelle d'un prochain aménagement de son territoire : des éoliennes doivent y être installées. Cette réalisation d'une certaine importance économique, joue aussitôt un rôle dans la bourgade. On a l'impression que cette boule de billard vient frapper toutes les autres en provocant des réactions en chaine. D'aucuns sont intéressés (dans le sens le moins noble du terme) par cette intervention écologique, les autres sont placé devant des questions pratiques, comme celle de la nécessité d'acquérir des parcelles de terrain en vue de cette grande installation technologique qui a besoin de beaucoup de place. Des conflits, des rivalités se font jour. De vieilles querelles refont jour. En somme, tout ce petit monde qui vivait dans une relative intelligence, se voit métamorphosé par la nouvelle richesse qui va bénir leur commune. Juli Zeh relate tous ces événements. Et elle le fait avec une application maniaque. Elle passe chaque domicile et chaque habitant sous une loupe grossissante et relate les moindres détails avec une précision passez rare. Ce jeu d'échecs en plein air peut être regardé comme une vision et une interprétation de l'Allemagne (orientale, donc ex communiste) des derniers temps. Les appétits dévorants des uns, le désir de vengeance des autres, la lâcheté ou la perfidie des derniers, tout est ici dépeint avec un soin jaloux. C'est une sorte de radioscopie des Allemands qui ont changé de régime et aussi de mentalité, mais qui ont gardé quelque chose de l'époque d'Erich Honecker, surtout de mauvaises pensées. D'un certain point de vue c'est remarquable, car l'auteur a un style brillant et un sens accompli du récit. Mais d'un autre, c'est pesant et finalement plutôt ennuyeux car trop de détails détruit la vue d'ensemble que nous pourrions en dégager.

Helen Keller ou Arakawa, Madeline Gins, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marie-Dominique Garnier, préface de Jean-Michel Rabaté, Hermann, 304 p., 25 euro
Beaucoup d'entre vous connaissent le grand artiste japonais devenu américain Shûsaku Arakawa (1936-2010), adepte du néo-dadaïsme, qui s'est fait connaître pour ses peintures mêlant l'écriture et la géométrie pure. Quelque soit le dispositif adopté, il a toujours confronté ces deux espaces, les mettant en abysse. Il a aussi travaillé dans le domaine de l'architecture, en privilégiant des formes géométriques colorées. Le nom d'Helen Keller (1880-1968), à la fois sourde et aveugle, qui a pu néanmoins suivre à apprendre le langage des signes et le braille grâce à sa maîtresse privée, Anne Sullivan, des études universitaires et écrire douze livres. Elle a mené un combat politique courageux en faveur des personnes handicapées. Le rapprochement entre les deux personnalités ne me paraît pas tout à fait évident. Mais pourquoi pas ? Mais je ne suis pas parvenu à comprendre le sens de l'ouvrage de Madeline Gins (1941-2014), qui a été écrivain, artiste et architecte aux Etats-Unis. Ces chapitres qui sont des dérives analogiques et linguistiques dont on perd vite le sens et la nécessité, m'ont paru totalement ésotériques. Dès les premières pages j'ai été pris de vertige. Je ne parvenais pas à suivre la ligne logique de ses propos. Peut-être ne suis-je pas, par ignorance, par manque de jugement, capable de comprendre cet ouvrage. C'est fort possible. Je vous laisse donc le soin de vous aventurer dans ce texte labyrinthique et de voir si vous êtes capables d'en ressortir mieux instruits et vainqueurs de ce puzzle !

Les fantômes du vieux pays, Nathan Hill, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Nathan Hill, Gallimard, 718 p., 25 euro
L'histoire est simple : le professeur et écrivain Samuel Anderson ne parvient pas à remettre le manuscrit qu'il avait promis à son éditeur. Ce dernier le menace de lui demander la restitution de l'avance et l'annulation du contrat. L'auteur apprend que sa mère a commis un attentat (raté) contre la personne du gouverneur réactionnaire du Wyoming, Shelton Packer, le blessant sérieusement aux yeux. Il a alors l'idée de proposer à son éditeur irascible de raconter l'histoire de cette femme qui l'avait abandonné quand il n'avait que onze ans. Cela le conduit nécessairement à revisiter toutes les années passées et de reconstruire les moindres détails de son existence. C'est dans cette optique que le bât blesse : l'auteur accumule trop d'informations inutiles sur son enfance et son adolescence, sur ses amis de l'époque et sur celle qu'il chérissait alors Bethany et qu'il croyait que son grand-père s'était changé en plusieurs genres de fantômes. L'auteur a choisi deux dates clefs : 1968 (l'année où il est à l'université dans l'Iowa e à Chicago) et 1988. C'est autour de ces deux années que tout se joue. Le texte devient épuisant à cause de sa longueur, de ses bavardages inutiles, de ses dialogues sans ressort, de toutes ces anecdotes qui, en fin de compte, nous font perdre de vue cette femme étrange et très anticonformiste. Nathan Hill a été acclamé par la presse anglo-saxonne. John Irving le compare à Charles Dickens ! Notre journaliste doit savoir que la majorité de ses lecteurs n'ont jamais lu Dickens. C'est un méchant livre du genre best-sellers américain, avec beaucoup de pages, beaucoup de mots et peu de substance. Difficile de comprendre pourquoi Gallimard a choisi ce titre plutôt que tant d'autres qui paraissent outre-Atlantique. Il y a quelque chose de déroutant dans le vieux sanctuaire de la littérature...

Le Cénotaphe de Newton, Dominique Pagnier, Gallimard, 600 p., 23,90 euro
Le titre de ce roman peut faire rêver : qui n'a pas en mémoire le célèbre projet de monument à la gloire d'Isaac Newton dessiné par l'architecte Louis-Etienne Boullée ? Si ces pages (nombreuses, trop nombreuses) sont pleines de références de ce genre, surtout à ce qui concerne l'ère des Lumières, on se rend compte qu'il s'agit d'une affaire de famille assez embrouillée qui tourne autour de la figure de Manfred Arius. On se perd assez vite dans ces renvois généalogiques, dans toutes ces descendances qui ramènent curieusement toute à ce mystérieux personnages qui semble l'épicentre de tout. Le narrateur vit à Vienne, mais cette évidente inclination de l'auteur pour le monde germanique ne nous comble pas vraiment. On ne parvient pas à comprendre si nous sommes face à un livre d'histoire, à un livre de la géographie de cultures du passé ou tout simplement d'un Familienroman, inspiré de loin par Sigmund Freud qui a exercé justement dans la capitale autrichienne. Cette prose est trop touffue, trop abondante, même trop pléthorique et surtout ne nous propose jamais un véritable sujet. Où se situe l'erreur ? Difficile à dire : il y a d'abord le fait que le narrateur n'a guère de consistance (pas seulement dans ses apparences, mais dans son esprit et dans sa recherche), mais ce n'est peut-être pas l'essentiel. Où est-ce ce périple du règne de Marie-Thérèse à la RDA, en passant parfois par le IIIe Reich et les grandes heures de l'Empire des Habsbourg. En fait, si tout cela peut intéressant, intriguant, pertinent parfois, c'est toujours par un détour qu'on y accède. Le roman échappe, il fuit à toute tentative d'en comprendre le cheminement. On le compare à l'Homme sans qualité de Robert Musil : si Musil lui aussi a échoué dans sa folle et gigantesque entreprise, il l'a fait avec panache et une science de l'écriture que ne possède pas Dominique Pagnier. Ce dernier a bien des qualités et fait partie de cette élite littéraire de la France actuelle, douée, savante, mais pas vraiment créatrice. Bien sûr, ce livre vaut bien d'autres car il ne dévoile ni médiocrité, ni facilité. Mais il semble être victime d'une sorte de déformation congénitale.

Une histoire contrariée. Le musée de photographie en France (1839-1945), Eléonore Challine, Editions Macula, 536 p., 33 euro
Ce livre est une somme, et qui devrait intéresser tous ceux qui s'intéressent de près au « sixième art », à son histoire et aussi à ses relations assez compliquées avec les institutions. On peut s'étonner qu'il existe des musées du cinéma, dont la célèbre cinémathèque de Paris, mais aussi le récent musée du cinéma de Turin installé dans la Mole Antoneliana, mais pas de musées de la photographie. Il y a bien des lieux d'exposition qui lui sont réservées, comme le Jeu de Paume et la Maison Européenne de la Photographie, mais de musées, point. Roger Pic avait eu l'intention, à la fin de sa vie, de transformer son atelier en musée, à partir de ses propres archives, pour constituer un premier et riche fond d'archives. Ce projet fit long feu avec son décès. Bien sûr, l'utilisation de plus en plus grande des techniques photographiques par les artistes a fait que les musées d'art moderne sont toujours combles d'oeuvres photographiques. Mais on ne peut les séparer de nos jours des autres méthodes artistiques. Il y a bien des galeries spécialisées et même des foires sur l'argument. En somme, l'affaire devient de plus en plus complexe. Ce que nous apprend Eléonore Challine, c'est que l'idée d'un musée de ce genre a vu le jour dès le milieu du XIXe siècle. Des ateliers réputés organisent des expositions et l'idée d'un véritable voit déjà le jour, du moins sur le papier et pour des raisons très diverses : les unes pour développer une documentation ethnographique, les autres pour conserver des images d'événements historiques. Le peintre Raffaëlli songe lui à un musée de copies d'oeuvres d'art. Mais quel doit être la nature d'un musée de la photographie ? nous demande l'auteur. Celle de ses techniques et de leur évolution ou celle de ses productions ? La question n'a jamais été tranchée ! Il est intéressant de constater que son invention a provoqué quinze plus tard cette incroyable prolifération de réalisations privées et de grands projets à l'échelle d'une ville ou d'une Nation. J'ai bien du mal à imaginer avec quelle patience l'auteur s'est mis à décortiquer les livres, les journaux, les rapports concernant ces idées qui sont restées lettre morte. La partie consacrée à la préhistoire de cette affaire est absolument fascinante, car on ne parle que de ça ! Les lieux se multiplient et les publications abondent. Cela a semblé alors dans la logique des choses. C'est au cours du siècle suivant que les choses se compliquent beaucoup. Les progrès techniques ne tardent pas à engendrer le photographe amateur et la reproduction de clichés dans les journaux, remplaçant les gravures au zinc. On édite aussi des cartes postales et des reproductions de toutes sortes. On s'en sert pour la réclame et pour les affiches. Cet art se banalise, devient réclame ou portrait de classe ou de famille. Ce faisant, il a clivé cet univers en deux : celui des chercheurs, des savants et des esthètes, et celui de la vie commune. Mais plus son succès est grand, et plus la résistance à son encontre augmente : le cabinet des estampes n'accepte pas volontiers ce genre de documents. Je laisse le soin au lecteur de découvrir les innombrables tribulations de cette idée au cours du siècle dernier, jusqu'à la Libération. C'est une histoire incroyable et tous les efforts déployés pour parvenir à la création d'un musée qui ne se fait jamais. C'est aussi passionnant qu'un roman policier, croyez-moi. Et c'est un livre qui, au-delà de sa spécificité, nous force à méditer sur le rôle et la finalité d'une institution muséographique.

Les rêveuses, Frédéric Verger, Gallimard, 446 p., 21,50 euro
Je vous le demande : l'art romanesque est-il en train de sombrer corps et bien dans notre beau pays. Ces Rêveuses nous laissent de marbre. La première chose qui est choquante est que le héros de cette histoire tirée par les cheveux est un jeune soldat d'origine allemande, Peter Siderman, mais combattant dans l'armée française. Il est fait prisonnier et utilise une fausse identité et sa véritable nationalité est découverte. Mais que fait-on ? On le renvoie dans ses foyers ! Ce qui est franchement assez peu crédible.... Et là, il se retrouve dans une affaire familiale, que sous-tend la présence d'Alexandre, qui a quitté ce monde, et dont l'existence est devenue comme la raison des faits et des gestes de tous ces personnages. Soit. Mais on se noie dans ces cheminements tortueux qui mènent aux deux cousines qu'il faut protéger à tout prix, et ces autres figurants, Emmanuel ou Hélène. Tout cela se déroule au bord de la Moselle, en pleine Occupation, quand une grande partie de la Lorraine, la Moselle, est rattachée au IIIe Reich ! De temps à autre, dans un très fort volume, le mot Gestapo fait son apparition, puis disparaît pour longtemps. L'histoire ? Souvent assez peu compréhensible. Cette quête du passé, du nôtre et celui du monde en proie aux vertiges des totalitarismes, n'est pas absurde. Mais noyée dans toutes ces phrases qui défilent comme une armée de l'ombre de la pensée, on reste perplexe. L'auteur se paie de mots (il a pourtant un beau brin de plume, du style aussi, et en abuse, il est intelligent et cultivé, mais ne possède pas le moindre sens de la composition) et on a l'impression de ne pas avancer ni dans la connaissance des personnages, ni dans l'action. C'est interminable et épuisant. A la fin, notre héros meurt, à notre grand soulagement. La lecture de ce livre est une épreuve qu'on n'a pas le droit d'infliger aux lecteurs. La NRF est née d'une conception assez rigide, pour ne pas dire protestante, de la langue française. Cette disposition fait opter ses créateurs pour une littéraire clairement exprimée. Bien sûr, cela a forcément eu des conséquences nuisibles, comme le refus par Gide du chef-d'oeuvre de Marcel Proust, qui finit par y être publié. Puis est venu Céline ou encore Breton. La plupart des grands auteurs, dans l'entre-deux-guerres, se sont pliés à cette discipline, de Cocteau à Aragon, en passant par Malraux, Morand, Larbaud. Et même Queneau et Vailland. Interrogeons-nous sans attendre sur les critères actuel du comité de lecture qui a proposé cette fiction pour la rentrée littéraire.
|
