
Margherita Sarfatti, il Novecento italiano nel mondo, Electa, 212 p., 49 euros
Il est rare qu'un tel hommage aussi vibrant soit rendu à un critique d'art, qui, plus est, s'avère être une femme. Margherita Sarfatti (188o-1961) est issue d'une famille juive très aisée de Venise, les Grassini, qui possède la Società dei Bagni du Lido et s'est installé dans le palais Bembo. En 1898, elle épouse l'avocat socialiste Cesare Sarfatti originaire de Padoue. Le couple s'installe à Milan quatre ans plus tard. Ayant reçu une éduction très soignée, elle s'est intéressée très tôt aux arts plastiques : en 1895, la première Biennale de Venise la passionne au plus haut point. A partir de cette date, elle s'est intéressée de près à cette grande manifestation artistique internationale. Parallèlement, elle lit les grands textes théoriques du socialisme révolutionnaire, de Marx à Kropotkine. Elle commence à écrire des articles, en particulier dans L'Unione Feminile à partir de 19o1. Elle publie aussi plusieurs articles sur la Biennale dans Il Secolo Nuovo. A partir de 19o8, elle collabore régulièrement au nouvel organe du parti socialiste, L'Avanti !. En 19o9, la famille Sarfatti s'installe Corso di Porta Venezia où elle reçoit chaque semaine artistes et intellectuels. Dans la maison de campagne de Cavallasca, elle reçoit aussi des créateurs tels qu'Umberto Boccioni, Giuseppe Terragni, Medardo Rosso, Mario Sironi, Antonio Sant'Elia, Arturo Marini, Enrico Prampolini, et aussi des écrivains, comme Gabriele D'Annunzio, Ada Negri et Aldo Palazzeschi. En 191o, elle entreprend un voyage à Paris où elle connaît, entre autres, Dufy, Utrillo et Matisse et achète les litholographies de Toulouse-Lautrec. Elle écrit son retour son premier article pour La Voce. Elle apporte aussi sa contribution en 1912 à la nouvelle revue La Difesa delle Lavoratrici. Deux ans plus tard, elle se rend à Londres et aussi à Paris, où elle rencontre Charles Péguy et Amedeo Modigliani. A l'automne, elle se rend à Vienne, à Amsterdam et à Munich. En 1914, elle écrit un article élogieux sur le groupe Nuove tendanze (Funi, Dudreville, etc.). En 1915, elle milite pour l'engagement féminin dans le conflit. Elle collabore avec F. T. Marinetti pour organiser une grande rétrospective en honneur de Boccioni, mort le 17 août. En 1917, elle écrit son premier article pour Il Popolo d'Italia, créé par Benito Mussolini, avec lequel elle entretient une relation sentimentale depuis plusieurs années. Elle participe la fondation du mensuel Ardita en 1919, Le 11 janvier 192o, plusieurs artistes (Sironi, Funi, Russolo, Dudreville) publient un manifeste : Contro tutti i ritorni in arte. En mars, elle présente une exposition collective avec ces artistes avec, en plus, Marussig et De Chirico et l'année suivante, elle publie un livre de poésie avec une couverture de Sironi. Elle fonde le mensuel fasciste Gherachia avec Mussolini. Le 26 mars, elle inaugure la première exposition des membres du groupe Novecento et Mussolini y fait un discours pour l'inauguration qui est publié dans Il Popolo d'Italia. 1924 est marqué par la mort de son mari. Elle présente une exposition d'artistes italiens à Paris. Le 14 février, est présentée La « Première exposition du Novecento au palazzo de la Permanente à Milan où Mussolini prend la parole. Elle publie en Italie sa biographie de Mussolini. Elle prépare une série d'expositions d'art italien contemporain, qui seront présentées à l'étranger. La première a lieu au printemps 1926 à Paris, pour être ensuite installée à Genève, Zurich, Stockholm et Amsterdam, puis au musée de Leipzig. A Rome, elle continue recevoir les grandes personnalités du monde des arts et des lettres. Ayant toujours plus de responsabilités dans les revues et les organisations du régime fasciste, elle n'assume de moins en moins le commissariat de plusieurs expositions. Mais elle préside néanmoins le « Seconde exposition du Novecento « au palazzo della Permanente à Milan. Quant son exposition de l'art italien, elle continue circuler en Europe (Oslo, Munich, etc.). Malgré son rapport privilégie avec le Duce et la place éminente qu'elle occupe, elle doit s'exiler cause des lois raciales en 1938. Elles s'installe d'abord à Paris, puis va à Montevideo. Elle poursuit son oeuvre de critique et de journaliste, publiant plusieurs livres. Elle rentre en Italie en 1947 et meurt en 1961 dans sa villa de Cavallasca. La grande exposition, qui est présentée cet automne à la fois au Museo del Novecento de Milan et au MART de Rovereto est une splendeur. On y découvre de nombreuses oeuvres des artistes qu'elle a défendus pendant l'entre-deux-guerres. Chacun d'entre eux est représenté par un nombre non négligeable de tableaux et de dessins, mais on peut y découvrir aussi des manuscrits, des lettres, des catalogues, des livres, en somme une imposante documentation qui permettent de comprendre ce qu'a pu être la vie de ce groupe qui n'a pas été soutenu par le régime (contrairement ce qu'on a pu souvent affirmer sans la moindre preuve). Tous ces créateurs font songer ce qui a pu se passer en France, par exemple, avec l'Ecole de Paris, même si ils ont travaillé dans une optique qui est celle de la culture italienne. C'est vraiment une réussite et je ne saurais trop conseiller aux amateurs d'art de se rendre en Italie pour les visiter, ou tout du moins de se procurer le catalogue, qui est très bien fait. Je signale ceux qui ne misent pas l'italien qu'il existe une excellent biographie de Sarfatti en français : Margheirta Sarfatti, l 'égérie du Duce, Françoise Liffran, Seuil (2oo9).
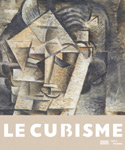
Le Cubisme, sous la direction e Brigitte Léal, Christian Briend & Ariane Coulondre, Centre Pompidou, 52o p., 49,9o euros
C'est une somme. Et il faut reconnaître qu'elle vient point nommé car cela faisait un moment qu'il n'y avait pas eu une grande exposition sur la question en France, ni un ouvrage d'ensemble aussi complet. L'exposition et l'ouvrage qui l'accompagnent sont remarquables. Je vais rapidement énumérer les défauts que j'y ai trouvés pour ne plus parler ensuite que des choses positives. La première critique que je ferai - c'est toujours la même - est que la question est trop franco-française. Il n'y a rien sur le cubisme tchèque, sur le vorticisme anglais, sur le cubo-futurisme russe ou portugais, rien en somme sur les développements importants du mouvement dans l'Europe d'avant la guerre. C'est fort dommage car il y aurait bien des choses importantes à voir. Autre chose : la documentation est assez maigre, en dehors de belles éditions, des écrits de Guillaume Apollinaire, qui ne sauraient manquer. Et les autres ? Tous les écrivains qui ont été témoins de cette aventure artistique (il y a bien un portait d'André Salmon, et c'est tout). Mais, comme l'a fait observer l'ami Jean-Paul Morel, en accord avec moi, il aurait fallu des documents de la presse de l'époque, quelques unes des nombreuses caricatures qui ont salué la venue de ce courant. Enfin il aurait fallu des documents sur Montmartre et Montparnasse, sur les cafés, les ateliers, la vie de ces peintres et de ceux et celles qui les entouraient. Mais restent encore deux choses qui pour moi sont graves. La première est l'absence d'André Derain qui pourtant passait bien du temps expliquait ce qu'était le cubisme avec des métaphores divertissantes aux personnes qui l'interrogeaient autour d'un guéridon Saint-Germain-des-Prés. Les Baigneuses - celles du MoMA de New York (19o7) et celles de la Narodni de Prague (19o8) sont bel et bien de grandes compositions cubistes, bien différentes de ses toiles fauvistes. Il y a six oeuvres en tout, mineures, dont les baigneuses du centre Pompidou ; cela me semble un manquement coupable. Enfin, présence urticante, les deux ready-mades de Marcel Duchamp à la fin du parcours, comme pour rassurer les derniers acharnés de la « tradition du moderne » - quelle inutilité et quelle faute ! Mais, tout cela étant posé, l'exposition est tout de même fort belle. Elle permet de reconstruire le cheminement du cubisme, qui n'a pas été linéaire, des paysages et des maisons dans les bois avec des dominantes vertes et brunes jusqu'aux déconstructions linéaires de Braque et de Picasso, avec une volonté d'achromie avec ces gris et ces teinte brunâtres sans éclats comme dans Le Poète ou dans L'aficionado de Picasso (1912) ou La Vision de Braque (1911). Et puis il y a ces merveilleux collages qui marquent l'année 1914 qui introduisent la lettres des journaux, des livres, des réclames, les chiffres des cartes à jouer et toutes sortes de petites choses empruntées à la vie quotidienne. Après quoi, entre 1913 et 1914, les toiles deviennent plus grandes et complexes et allient les deux éléments, la construction géométrique et les collages ; mais rien n'est si systématique et si simple ; la tendance est celle-là, mais d'autres facteurs sont introduits, comme par exemple des objets figuratifs ; ce qui est merveilleux c'est qu'on peut relire une aventure esthétique dans toute son ampleur, ses chemins de traverses, ses intuitions et l'absence d'une doctrine absolutiste, même pendant la période la plus radicale. Et l'on peut aussi découvrir un certain nombre de sculptures de Picasso, soit des assemblages, soit des pièces en tôle ou en fer blanc. Il y a une sculpture noire de ce dernier qui est un pur chef-d'oeuvre. Lorsqu'on parcourt le catalogue, on peut aussi voir l'influence immédiate de cette nouvelle manière d'envisager la peinture chez d'autres artistes comme Juan Gris, qui l'adopte pleinement selon son goût, Henri Laurens, Duchamp-Villon, Jacques Lipchitz, Fernand léger, Jacques Villon, Archipenko, Gino Severini, Robert Delaunay qui en tirent profit et même des cas isolés comme Marc Chagall qui a fait un fond cubiste dans un tableau. Et ensuite l'on découvre ceux qui en ont fait une école, comme Albert Gleizes, Léopold Survage, Jean Metzinger. C'est une source de documentation remarquable, et une bonne occasion de réviser son histoire de cet art qui a été comme une comète dans le ciel de l'art parisien et qui en a changé le cours jamais même s'il a été de si courte durée. Alors, si l'on a en tête ce qui a été occulté, on a auprès de soi un outil de travail puissant et irremplaçable.

William Bouguereau, Fredrick C. & Kara Lysandra Ross, La Bibliothèque des Arts, 24o p., 49 euros
William Bougereau, (1825-19o5) a sans nul doute été l'artiste académique par excellence et donc le plus célèbre des « pompiers ». La rétrospective qui avait été organisé au Grand Palais à Paris en 1984 n'avait pas réussi tout fait à redorer son blason ; peut-être que le musée d'Orsay a un peu mieux fait, involontairement, en présentant des ouvrages des maîtres de l'Académie des Beaux-arts de Paris dans les premières salles que découvrent les visiteurs cause de l'étrange dispositif architectural de Gae Aulenti. Mais à l'époque de la rétrospective la « tradition du moderne « à son crépuscule, avait encore le pouvoir conservait encore assez de force et d'influence pour empêcher toute réhabilitation. Cette monographie paraît en un moment bien différent où le kitsch (pour ne parler que de cela) est désormais l'une des marques significative de ce que l'on qualifie d'art contemporain. Elève de picot, il parvient remporter le prix de Rome ex æquo avec Gustave Boulanger. Il réussit deux ans plus tard obtenir le premier prix de Rome. Il se forge très vite une solide réputation et le marchand Paul Durand-Ruel le fait entrer dans sa galerie. Les amateurs américains en raffolent (ce n'est pas un hasard si les auteurs sont anglo-saxons). En 1878, on décide de présenter une rétrospective de ses oeuvres, mais il en reste si peu dans notre pays, on ne peut en réunir que douze. Peu après, il est passé un contrat avec la galerie Goupil, qui s'occupe de la reproduction de ses compositions. Il devient professeur à l'académie à partir de 1888, mais enseigne aussi à l'Académie Julian. Il était déjà membre de l'Institut (depuis 1876) et a du succès au Salon (où il a reçu une médaille d'honneur). Les commandes sont abondantes. Bien sûr il y est vilipendé par les critiques les plus progressistes et par les peintres qui ont une autre vision de l'art (Degas invente le terme « bouguereauter » et Cézanne parle du « Salon de Bouguereau « ). Toutefois, il n'a fait pas autant de « grandes machines » que Puvis de Chavannes, loin s'en faut. L'une de ses plus grandes réalisations est le plafond du théâtre de Bordeaux. En revanche, il a exécuté de nombreux portraits des personnages riches et puissants de son temps. Tout un chapitre du livre y est consacré. Il avait un savoir faire remarquable, mais n'est jamais parvenu à atteindre la bravoure et la subtilité d'Ingres. Il avait aussi usé de certaines ficelles pour flatter sa clientèle, en mettant trop l'accent sur des expressions trop soulignées dans le regard ou le sourire de ses modèles féminins. Il a beaucoup aimé trait les sujets mythologiques, avec un certain manque de finesse et une relative rudesse. Sur le tard, en 1896, il a voulu égaler Cabanel en peignant une Vague, avec un tout sourire au premier plan, qui avait pour vision de dépasser son illustre prédécesseur. Ses tableaux mythologiques sont franchement kitsch, et n'on même pas le charme et la sensualité de Hans Makart, son homologue autrichien. Les Remords d'Oreste (1862) n'arrive pas cheville du plus humble des néoclassiques. Et ce qu'il y a de plus frappant, c'est son goût immodéré pour les putti et pour les anges. Il y en a partout, ce qui donne ses tableaux une tonalité mièvre et empreinte d'un sentimentalisme béat. Dans La Douleur d'amour (1899), la figure de Psyché pourrait être belle, mais le petit Amour qui pleurniche assis au pied de la colonne rend la scène assez ridicule. Et quand il s'est employé faire tes compositions religieuses, il fait encore pire en singeant les maîtres anciens (il n'est que de voir La Madone assise de 1888). Je ne crois pas qu'on puisse restaurer l'image de ce peintre ; mais étudier sa carrière et l'univers qui l'a adulé est des plus intéressants, d'autant plus que ce livre est très bien fait et permet de comprendre ce qu'a été dans la seconde moitié du XIXe siècle la carrière d'un artiste de cet acabit ; tout historien de l'art digne de ce nom se doit de s'y plonger et ne pas se contenter des noms d'oiseaux qu'on a pu donner Bougereau et ses acolytes.

Pour la paix, Paul Eluard / Pablo Picasso, Michel Murat, Hazan, 22o p., + fascicule, sous emboîtage, 29,95 euros
On ne sait plus trop comment exploiter le nom et l'oeuvre de Pablo Picasso. Ce livre en est la démonstration. Les dessins de l'artiste n'ont pas été exécutés pour illustrer les poèmes de Paul Eluard. Sans doute quelques uns lui sont dédiés et, à la fin du volume, un petit texte d'Eluard fait son éloge. Mais les choses en reste là. Sans doute le livre est-il très bien fait et on a un certain plaisir à cohabitation qui témoigne de leur amitié (surtout après la Libération). Si vous aimez les textes d'Eluard et les dessins de Picasso, vous serez comblés. Il n'en reste pas moins vrai que c'est un montage complètement fallacieux. Bien sûr, on pourra m'accuser d'être trop à cheval sur les principes et de mettre trop haut la barre de la critique d'art. L'éditeur ne sera pas content et ceux qui travaillent pour lui aussi. J'ajouterai donc que ce livre peut et doit constituer un merveilleux cadeau pour ceux qui aime l'art et la littérature ; l'accouplement de ces deux figures célèbres n'est pas artificiel, je tiens à le répéter. C'est une façon de s'immerger dans une époque qui était tout de même plus passionnante que la nôtre pour la culture. Et je l'affirme sans nostalgie, car ne n'est pas mon époque. C'est une réussite sur le plan de la présentation, de la mise en page et de la typographie. Le coffret est beau, je dois le reconnaître. Que demande de plus le peuple ?

Cités millénaires, voyage virtuel de Palmyre à Mossoul, sous la direction d'Aurélie Clemente-Ruyz, Hazan / Institut du Monde Arabe, 12o p., 2o euros
Ce livre est important et est fait pour marquer les esprits durablement. Il nous montre les grandes cités antiques, déjà usées par le temps et les événements historiques, qui ont été frappé pour la plupart par les conflits armés dans l'Afrique du Nord et le Proche-Orient. Le cas de Palmyre est sans doute le plus connu de tous. Plusieurs civilisations y ont laissé leurs traces. Ce fabuleux ensemble archéologique a fasciné des générations de voyageurs. Aujourd'hui, hélas, une partie de ce prestigieux témoignage du passé a été dynamité par les islamistes les plus obscurantistes. Des villes entières ont été bombardées à outrance, comme Mossoul et Alep avec sa magnifique mosquée des Omeyyades, désormais très endommagée, sa ruelle aux épices et ses vieux cafés qui étaient les derniers authentiques cafés arabes de la région. L'Orient et l'occident y ont côtoyé pendant de longs siècles, bien après encore l'islamisation de la région. L'ouvrage se veut pédagogique. Il s'adresse à tout un chacun et non aux seuls connaisseurs d'architecture ancienne. Il veut nous sensibiliser à ce drame qui s'ajoute à l'épouvantable drame humain. Les faits sont là : ces destruction sont un crime contre l'humanité toute entière. Cela fait partie d'une stratégie de la tabula rasa. Et les premiers perdants dans cette affaire sont les habitants de la Syrie, de l'Irak et de Lybie. Bien sûr, c'est un important capital touristique perdu ; mais c'est avant tout un sublime capital historique et artistique qui a subi des dommages considérables, peut-être irréparable, et personne dans ce vaste monde ne saurait rester indifférent à ce saccage. La seule relative exception est Leptis Magna en Lybie. Mais cette grande ville romaine qui se voulait l'égale de Rome est qui est unique par le nombre et la qualité de ses édifices est elle menacée par le manque de soin apporté à sa conservation à cause des dissensions qui subsiste dans ce pays désormais coupé en deux. Tout ce que le passé nous a généreusement légué est désormais en grande partie détruits dans cette vaste région. Ce livre ne fait pas qu'alerter l'opinion publique sur cette situation, mais s'interroge aussi sur les solutions futures qui pourraient ou non être apportées.

Cent énigmes de la peinture, Gérard-Julien Salvy, Hazan, 36o p., 39 euros
Voici un livre qui possède une grande vertu pédagogique, en plus des joies qu'il peut apporter. L'auteur a choisi des tableaux dont certains sont très connus et d'autres moins, pour que les lecteurs puissent en découvrir le sens et les rouages secrets. Prenons, au hasard, L'Origine de la Voie lactée du Tintoret, peint vers 158o, qui se trouve aujourd'hui la National Gallery de Londres. C'est un sujet rarement traité et que l'artiste a rendu de manière curieuse : c'est Jupiter qui tient son fils Hercule qui boit au sein de Junon. On peut en effet s'interroger sur ses intentions ! On pourrait aussi se demander pourquoi ces paons et autres oiseaux figurent sur cette grande toile. Ce qui prouve que le décryptage iconographique ne suffit pas à interpréter la scène. Dans le même musée, on peut contempler une toile bien connue de Bronzino, intitulée Allégorie avec Vénus et Cupidon (circa 1545). Il semble que le tableau a été commandité par Côme Ier de Médicis qui l'aurait offert François Ier. Déchiffrer ce thème déjà complexe dans la mythologie antique devient ici le prétexte pour reconstruire un véritable puzzle car plusieurs éléments iconographiques demeurent assez difficiles à justifier et à expliquer. Bronzino a beaucoup aimé y introduire des allégories, comme celle du plaisir ou celle de la jalousie. Il y a aussi la fourberie. A l'époque Castiglione, dans son célèbre ouvrage, Le Courtisan, et L'Arétin y ont décelé une forme de raillerie, mais dont on ignore le dessein caché. Pour Gérard-Julien Salvy, ce serait la raison pour laquelle on aurait longtemps remisé ce tableau dans une réserve. En ce qui concerne La Vierge du chardonneret, de Raphaël, il nous explique que des travaux récents de restaurations ont montré que le tableau avait été retouché et l'on croit que Ghirlandaio a été l'auteur de cette collaboration a posteriori. En somme, c'est une invitation d'abord mieux regarder les compositions qui peuvent receler des éléments étranges ou mystérieux, mais aussi approfondir leur histoire dans un contexte précis. Le livre ne s'adresse pas seulement aux personnes ignares de la peinture ancienne, mais aussi bien à ceux qui savent déjà l'apprécier et qui sauront que le chemin de la connaissance est long et hérissé d'obstacles. C'est très bien fait, très riche et apporte énormément à chacun de nous, quelque soit le niveau de notre culture.

Eloge du livre, Pascal Dethurens, Hazan, 24o p., 29,95 euros
C'est un sujet qui a été maintes fois traité et plusieurs expositions ont orienté toute notre attention sur la présence des livres dans les représentations graphiques ou picturales. Ce qui peut différencier cet ouvrage des précédents, c'est qu'il approfondit la question de manière significative. Il commence par exposer l'image du livre et du lecteur, ce que peut signifier cette relation de l'individu avec le texte contenu dans l'ouvrage qu'il tient entre les mains. Je me serais attendu à une histoire de ce qu'a été le livre dans l'histoire de l'humanité et des formes qu'il a fini par adopter dans l'antiquité ; Et j'aurais insister sur le passage fondamental du volumen au livre moderne, dont la forme a été dicté par la forme de la croix chrétienne. Et puis j'aurai imaginé qu'il consacre Gutenberg comme l'apôtre d'un lectorat qui ne va plus cesser de s'accroître : les clercs ne sont plus après lui les seuls ayant accès aux textes. Mais peu importe, l'auteur a choisi un autre cheminement. Il s'est orienté vers l'évolution de la représentation de ce rapport intime qui fait que les personnages qu'on découvre sur les panneaux des retables ou sur la toile ; autrefois, c'est le Livre qui était primordial : la Bible était le livre par excellence. Au Moyen Age, c'était également le support de la peinture. Tous les autres livres étaient dérivés de ce Livre qui représentait, sans restriction possible, la source incontestée de tous les autres. C'est d'ailleurs la poursuite de ce qu'a pu représenter la Torah dans la culture juive. Il consacre un chapitre entier sur la façon de représenter ces lecteurs : nous les voyons concentrés, solitaires par définition, comme abstraits du monde qui les entoure, emportés dans d'autres sphères qui sont celles de la pensée ou du rêve, de la connaissance ou des sentiments. Dans un autre chapitre, il montre comment l'univers livresque peut devenir l'objet d'une recréation, qui est celle delà fiction. Il prend le personnage de Don Quichotte comme l'archétype du lecteur qui va jusqu'au bout d'une sorte de folie, et cite Jean-Jacques Rousseau, qui en fait l'objet d'une pure « passion ». Il analyse tous les modes de la lecture, ses excès, ses errements, mais aussi ses bienfaits. Marc Aurelle, nous rappelle-t-il, avait conseillé l'abandon de la lecture. La prolifération des oeuvres imprimés a aussi correspondu à une prolifération de livres inutiles. La bibliothèque vertigineuse que l'homme s'est inventé au fil des siècles est devenue pléthorique. Elle est devenue ce dont nous parle Jorge Luis Borges -, une gigantesque métaphore du savoir, mais aussi des philosophies les plus inacceptables et des turpitudes les plus sombres. J'ai beaucoup apprécié le chapitre dédié au savant mélancolique. On y découvre alors Faust, mais aussi le portrait de Charles Baudelaire par Gustave Courbet : la lecture est source d'impressions et de méditations de toutes sortes, parfois moroses et même noires. Plus qu'un livre d'histoire, il s'agit d'un livre de réflexion sur ce que peut-être notre rapport l'imprimé et ses contenus, les émotions et les songeries que procure cette activité qui rend si seul et pourtant beaucoup plus proche des autres et de l'univers. Pascal Dethurens consacre aussi une partie de son travail l'étude de l'écrivain et là encore, il nous procure des surprises car il dépasse de loin les poncifs du genre. Je ne saurais trop vous conseiller de vous procurer ce fort volume, si passionnant, si bien illustré et qui vous conduira à nous pencher d'une autre façon que cette question qu'il a su rendre avec une grande largeur d'esprit et perspicacité.

Lettres de la vie littéraire, Arthur Rimbaud, « L'Imaginaire», Gallimard, 128 p., 7,oo euros
Du collégien, au voyageur parti cherché fortune dans les terres les plus ingrates de l'Afrique, ce choix de lettres allant de 187o 1887 montre à quel point sa vie d'écrivain a été brève et fulgurante. Il a commencé écrire des poèmes dès 1865, alors qu'il n'était encore qu'un potache au lycée de Charleville, amoureux du latin (en 1869, il remporte le concours de vers latins). En 187o, il est en classe de rhétorique et devient lié avec son jeune professeur Georges Izambard. Il publie ses premiers poèmes cette année-là et il continue à entretenir des relations épistolaires avec cet enseignant, qui tente de le conseiller. Mais en vain ! (C'est tout de même lui qui le tire d'embarras quand il fugue à Paris et qu'il est arrêté gare du Nord car sans billet ! Et ensuite, c'est encore lui qui vient à son secours quand il se rend à Bruxelles sans le sou ! Toujours en 187o, il écrit à Théodore de Banville, poète très considéré l'époque et grand maître du Parnasse. Celle-ci n'est pas reproduite dans cette petite anthologie, mais on trouve ici une -missive envoyée un an plus tard. Il rencontre lez poète Paul Demeny, à qui il envoie La Lettre du voyant. En août 1871, il rencontre Paul Verlaine. Il correspond avec lui et il y a dans ce volume quelques exemples de ses plis assez courts ; enfin, le tout s'achève par une longue et belle lettre que Rimbaud envoie en 1887 au directeur du Bosphore égyptien qui la publie en deux fois dans son journal. Il n'a donc pas renoncé tout fait la littérature comme le conte la légende ; mais c'est un autre auteur qui naît alors, que la mort emporté avant qu'on ne sache s'il aurait continué ou non d'écrire.

Alléluia pour une femme-jardin, René Depestre, « L'Imaginaire », Gallimard, 192 p., 7, 9o euros
Ces six novelles sont charmantes, plus que cela encore : ce sont de petites perles narratives. D'origine haïtienne, René Depère est un formidable virtuose de la langue. Il réussit allier une forme somme toute assez classique à la sensualité et à ma saveur piquante du parler créole, mais sans trop en faire, sans jouer sur la fibre exotique. Ses récits ne sont ni épiques, ni mélodramatiques. Il raconte des vies qui sont somme toute assez ordinaires, mais avec un charme incomparable. L'histoire de la tante Zaza et de son neveu est une étrange histoire d'amour, mais c'est aussi une apologie de l'amour le plus libre et le plus tendre. La seconde est le revers de cette médaille ; l'amour qui naît entre deux adolescents va contrarier la vocation du jeune garçon, qui a souhaité se dédier la sainteté. Pour ce faire, il a remis sa formation entre les mains d'un prêtre irlandais qui veut l'initier à ce qu'est la dimension diabolique du péché ; plus il lui explique la chose, et plus notre héros est attiré par la belle Roséna, qui ne connaît pas le mal et dont il s'éprend avec joie et sans remords. Il connaît la jouissance, dans sa plénitude, mais pas la perversité. C'est une forme de culture que chante l'auteur, une culture qui est finalement bien éloignée de la nôtre et qui se vit au-delà ce qu'on appelle le bien et le mal chrétien. René Depestre a la poésie chevillée dans son art narratif et il sait tirer toutes les ressources d'un fragment d'existence pour faire en sorte qu'il devienne une sorte de fable emblématique d'une réalité qui sait parfaitement se conjuguer avec le rêve. Ce fut pour moi une jolie révélation et j'espère que ce le sera aussi pour vous, car lire ces pages est un plaisir jamais démenti.
|
