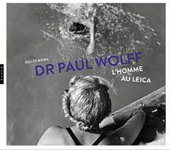
Paul Wolff, l'homme au Leica, Gilles Morna, Editions Hazan / Pavillon populaire de Montpellier, 44 p., 24, 95 euro.
Paul Wolff (1887-1951) ne fait pas partie des photographes qu'on retrouve souvent dans des expositions personnelles en France. Cette belle exposition présentée à Montpellier nous offre l'occasion de le découvrir. Né à Mulhouse, il a suivi ses études à Strasbourg. Mais sa famille a dû quitter la France en 1919, quand l'Alsace et la Lorraine sont revenues dans le giron de la France. La famille s'est installée à Francfort. Paul Wolff est parvenu à d'imposer assez vite dans le monde de la photographie. Il a traversé toute la période de la République de Weimar et même celle du pouvoir nazi avec un véritable succès. S'il a publié un ouvrage sur les jeux olympiques de Berlin de 1936, il n'a pas collaboré directement avec le régime. L'auteur nous dit qu'il était très ami avec le grand écrivain Ernst Jungder, qui aurait été nazi. Or rien n'est plus faux : la publication de ses Falaises de marbre lui a valu de gros soucis avec la Gestapo - c'est Adolf Hitler en personne qui l'a protégé car il admirait beaucoup ses livres sur la Grande Guerre (en premier lieu, Orage d'acier). Wolff, en tout cas, ne s'est jamais compromis avec des travaux de propagande. C'est qui est saisissant dans son cas, c'est l'incroyable arc de ses facultés, allant du réalisme à la recherche d'avant-garde. ? Au fond, il n'y a aucun domaine de la photographie qu'il n'ait pas abordé.
Il est parvenu à s'imposer comme un des créateurs les plus doués de sa génération et cela en toute indépendance. Ce que démontrent et cette exposition et ce catalogue, c'est qu'il a pu exceller dans tous les modes de ce jeune art qui avait d'ores et déjà envahi la vie quotidienne. On a le sentiment qu'il était animé par le souci de traiter tous les sujets imaginables, sans jamais avoir le besoin d'emphase ou de virtuosité. Son langage demeure simple et la construction formelle de ses clichés dénote une certaine retenue. Il était surtout guidé par leur juste mise en scène. De la botanique aux édifices industriels, il a traité des voyages à l'étranger, d sport, de toutes les formes de loisir comme si son appareil lui servait à composer une encyclopédie visuelle de son temps. Le spectateur ne peut qu'être admiratif devant sa quête insatiable (on a retrouvé quelques dizaines de milliers de documents). C'est là une découverte à faire dès possible en visitant son exposition et en consultant le catalogue qui révèle tout son talent.

Fantômes du Louvre - Les musées disparus du XIXe siècle, Pierre Singaravélou, Louvre éditions / Editions Hazan, 192 p., 29 euro.
Depuis sa création par Vivant Denon, le musée du Louvre (qui se nommait alors musée Napoléon) a changé plusieurs fois d'aspect. Quand je m'y rendais avec ma mère le dimanche, il était presque désert et semblait sorti d'une ère lointaine. Mais il était plein de poésie. Depuis, avec l'adjonction de la pyramide et puis l'ameublement de Jean-Michel Vilmotte où les vitrines paraissent appartenir à une industrie pharmaceutique. Et je ne parle pas de l'immense hall qui fait songer à l'entrée d'un stade ! Dans cette étude remarquable, l'auteur a souhaité livrer cette vieille institution réservée aux amateurs d'art et aux artistes à des foules qui ne regardent que La Joconde. Celui-ci nous fait pénétrer dans ces lieux chargés d'histoire en évoquant le pavillon des cessions où a été accueilli un tableau d'Alexandre Véron-Bellecourt, l'Allégorie à la gloire de Napoléon, exposé au Salon de 1806. Ce don de la veuve du peintre a fini dans les réserves. ,à ma connaissance, n'en est plus ressorti. Il est vrai que la composition est assez médiocre. Mais cela nous donne une idée de ce qui est en jeu dans ce lieu : des oeuvres, en grand nombre, finissent dans les « caves » et parfois n'en ressortent plus ! Pour mener son enquête, l'auteur s'est inspiré d'un projet de Charles Baudelaire, formulé en 1858, mais jamais réalisé : « musées disparus, musées à créer » : son but serait de prendre le Louvre comme un palimpseste et en tout vas comme le paradigme de la muséographie française des deux derniers siècles. Il commence par montrer que ce lieu a été le premier véritable musée d'ethnographie avant que ce genre de collection ne soit remise au musée du Quai Branly, qui est inauguré en 2006 (il est amusant de se rappeler qu'on a parlé d'art primitif » et d »art premier », dans une sorte de précipitation compulsive !
Le musée du Louvre s'était doté d'un musée ethnographique depuis le milieu du XIXe siècle. Cette décision n'a plus cessé d'entraîner des discussions sans fin. De nombreuses conséquences s'en sont suivies, d'autant plus que l'art ethnographique passionne des artistes d'avant-garde et que des marchands avisés se sont chargés de le commercialiser.
L'« art nègre » en même temps que le jazz envahi le monde du spectacle. En somme, on a commencé à regarder ces objets venus des quatre points de la Terre sont devenus d'une valeur égale à celle d'un Rembrandt ou d'un Rubens. Cette histoire chaotique qui nous conduit au jour d'aujourd'hui. Entre les deux guerres, la négritude s'est bel et bien imposée en France (comme dans toute l'Europe) et a été suivie d'un racisme poussé jusqu'à l'extrême par le nazisme. Dans le contexte de la colonisation triomphante, on y installe des choses ayant trait à la géographie, des plans-reliefs et puis une ample documentation sur la marine qui a eu pour conséquence la création d'un musée qui lui est dédié. Des souvenirs de l'Empire y sont également engrangés ! L'auteur a ensuite examiné l'entrée des statues et objets venant de l'empire khmer ou des ruines romanes en Lybie. Il fallait élargir la notion d'antiquité. Avec l'Indochine et à l'Amérique (il y eut même au Louvre un musée mexicain !), tout cela dan des débats houleux et des critiques sans nombre. Peu à peu se dévoilent toutes sortes d'affections plus ou moins longue de ce grand musée qui a fini par revenir à son point de départ récemment.
A mes yeux, le chapitre le plus passionnant est sans nul doute celui consacré au musée espagnol, avec ses hauts et sers bas et pur lequel Louis-Philippe a joué un rôle déterminant. C'est une histoire compliquée, plein de rebondissement, avec un risque de disparition complète. C'est aussi passionnant qu'un roman d'aventure ! On se rend encore mieux compte que le musée n'est pas une entité morte ou tout du moins statique, mais un corps vivant et en métamorphose constante. Ce que Pierre Singaravélou nous apprend est tout à fait extraordinaire. La notion de musée est vue à la loupe et son installation dans le temps passé s'est traduite par une série de velléités audacieuses, et aussi des reculs spectaculaires. Et cela continue. Cet ouvrage fait partie des lectures incontournables si l'art nous intéresse au premier chef.

Roberto Barni, OEuvres, 1978-1990, Openart Gallery, Prato, 122 p., 30 euro.
A la fin des années soixante, les artistes ont commencer des formes les plus radicales de l'abstraction (Hard-Edge, minimalisme, etc.) La plupart ont choisi par introduire une critique sociale et politique de la société. C'est le cas en France de la Figuration narrative, qui a fait tache d'huile. Une page se tourne alors, mais dans une optique essentiellement politique. Puis est apparue une génération de peintres et de sculpteurs qui ont eu l'audace de suivre un cheminement qui est d'abord l'invention d'une forme de figuration inédite. C'est le cas de Gérard Garouste, de Jean-Michel Alberola, de Julian Schnabel, de Markus Lüpertz, de Sandro Chia, d'Enzo Cucchi, Mario Schifano, pour ne citer que quelques-uns des plus connus. Roberto Barni fait partie de ces créateurs qui tiennent avant tout à leur indépendance d'esprit. Ils n'ont en commun que l'idée de trouver de nouveaux fondements à la figuration, sans prendre en considération le retour au néoclassicisme, qui trouve aussi quelques adeptes. Donc rien ne les relie les uns aux autres en dehors du fait qu'ils ont pris la décision de rompre avec une certaine orientation de la « tradition du nouveau ».
Il est né à Pistoia en 1939. Une cité étrusque romaine (Pistorium quand elle a été conquise par les Romains.). Il est le fruit de son histoire, mais aussi de la grande culture de la Toscane. Il a débuté sa vie d'artiste en 1960. En 1963, il a obtenu une bourse de la municipalité de Florence. Il a expérimenté différentes techniques. En 1965, il a participé à une grande exposition collective, Revort I, à la Galleria d'Arte Moderna de Palerme. Il a rédigé sa nécrologie en 1972, à une époque où il a réalisé de grands calendriers. Il s'est de plus en plus passionné pour l'histoire du pays qui l'a vu naître, mais éprouve une attraction spéciale pour l'art de la Renaissance. C'est lui qui va l'inspirer tout au long de sa carrière. L'inspirer, mais pas le limiter dans le cadre étroit de la peinture ou de la sculpture de cette période si intense. Au lieu de le faire revivre, comme ont tenté de le faire certains peintres académiques.
Le seul artiste auquel on pourrait le rapprocher est Giorgio De Chirico, mais il n'a rien partagé avec lui sinon cet amour pour l'art de ses illustres prédécesseurs. Son ambition a été de recréer des scènes qui possèdent le même genre de pouvoir évocateur, mais en introduisant des formes fantasques qui n'appartiennent qu'à son imaginaire. Ce n'est pas un être mélancolique et hostile à toute modernité. Il a eu l'intention de créer une Renaissance rêvée, qui n'existe que dans son oeuvre et qui n'est jamais tout à fait dépourvue d'un certain humour ou même d'onirisme. Tout est irréel et produit par des associations souvent ludiques. Ce qui est indéniable, c'est que l'humain est au centre de ses préoccupations : il le place dans des postures de différents ordres et dans un décor hautement fantasmé, mais qui lui octroie une dimension supérieure, bien que parfois liée à des facéties visuelles. Il voit l'être avec amour mais aussi avec une pointe de dérision. Il serait par conséquent inutile de parler d'une sublimation au sein de l'univers. Il se trouve toujours légèrement excentré. Même quand il les représente revêtus d'armures pesantes, ils n'ont jamais l'air de guerriers redoutables, mais plutôt d'acteurs qui plagient ces guerriers du temps des guerres entre les communes ou contre les royaumes étrangers. Ils sont plus proches des pupi des petits théâtres de marionnettes siciliennes d'autrefois qui relataient les faits et gestes des paladins de Charlemagne. Ils ne sont pas là pour évoquer des guerres sanguinaires ou des sièges terribles, mais plutôt pour montrer qu'il a chez l'homme digne de ce nom un guerrier audacieux. Celui-ci n'est pas une manifestation de l'esprit de la bataille, qui est le sort de chacun d'entre nous : nous devons mener ce combat pour inventer le monde.
D'aucuns pourraient rappeler des anges ou des archanges qui sont résolus à combattre le mal l'épée ou la lance à la main. La spiritualité est aussi une forme de bataille, qui peut prendre des formes diverses. Ces impressionnants personnages ne nous menacent pas ni n'évoquent ces célèbres condottieri qui ont marqué l'histoire de cette Renaissance qui était bien loin de promulguer la paix sur terre. Leurs aventures ne sont pas des victoires au terme d'affrontement violents, mais des divertissements qui peuvent prendre des aspects graves et sévères. Après tout, il s'agit toujours de mener une campagne qui peut être intellectuelle ou artistique.
Le sujet véritable de toutes ces scènes demeure une énigme. La définition de la figure, du décor, de la nature, de l'architecture ne nous fournit pas la signification de cette mise en scène. Elle a là pour nous impressionner, cela ne fait aucun doute, pour fasciner, mais jamais pour nous confronter à une histoire précise. Pas de fable, pas d'évocation, pas de narration cachée, mais une présence qui nous fait sortir de nos idées sur ce qui nous a précédé. L'amour de l'histoire se traduit ici d'une façon qui est à la fois profonde et drolatique. La vérité qui en émane est l'apparition de formes emblématiques mais toujours impénétrables.
Il a aussi éprouvé le désir de composer des événements mythologiques, comme c'est le cas avec Centauri temerari (1984) : Ii a pensé à un affrontement entre deux centaures de couleur verte. Le premier, qui a un visage féminin, se dresse au-dessus de son adversaire qui est à terre dans un champ de ruines et surplombe un centaure masculin au crâne rasé : Ils manipulent de grandes flammes qui jaillissent de leurs mains. L'univers qui les entoure est bleu. Nul ne connaît leur nom et de quel récit ils sont jaillis. D'autres tableaux montrent des villages à moitiés ruinés ou encore la figure de Sisyphe, qui supporte le poids d'une ville rouge (une autre toile dévoile une caryatide qui, elle aussi, tient sur son dos une cité rouge) . Et puis il y a ces étranges compositions où tous les personnages sont surmontés par des figures géométriques.
Le dieu Dionysos surgit dans une toile dans une sorte de tourbillon où gravitent mille objets. En somme, il a eu à coeur de métamorphoser les figures de la mythologie antique et de leur attribuer une apparence jusque-là inconnue. C'est sa mythologie intime qu'il a résolu de nous révéler. En somme, Roberto Barni nous entraîne dans son microcosme secret et nous y égare, sans intention maligne, mais avec le souci de nous faire découvrir d'autres espaces et d'autres temps. Son antiquité est un rêve qui étonne et demeure des plus intrigants. Il ne nous place pas dans une situation embarrassante, mais nous oblige à rejeter des concepts sur l'art de la peinture qui nous ont suivi jusqu'alors. Il engendre une beauté inconnue et nous fait nous approcher d'horizons nouveau qui porte en eux des réminiscences lointaines - celle de la grande peinture ancienne, mais dans une perspective neuve. Ce bizarre mélange d'ancien et de moderne est sa marque de fabrique et s'avère une invitation à s'embarquer vers des plaisirs nouveaux, l'oeil et l'esprit devant s'habituer à ses aspirations qui ne sont pas conçues dans l'optique du grand style, mais qui nous en rappelle le souvenir. Un voyage à Cythère, en fin de compte, pour savourer les délices déconcertants de sa peinture, qui procure toujours du plaisir alors qu'elle se déploie sur un fond pas toujours réjouissant : nous avons perdu le sens de cette volonté de jouissance qui a tant habité nos précurseurs.
Mais qu'on n'aille pas croire que les recherches de Barni se soient limitées à la reconquête du grand art italien de la Renaissance. Il a aussi voulu aborder les temps modernes. Mais, à la différence Mario Sironi, ces temps sont dépourvus de ses signes extérieurs, de tout ce qui est mécanique ou qui en sont les signes extérieurs les plus manifestes. Il a surtout voulu donner naissance à un archétype de l'homme de son propre siècle, un homme stéréotypé et pourtant qui exprime son identité et sa liberté. Il s'agit donc d'un individu assez paradoxal, qui paraît se répéter à l'infini sous un aspect plutôt stéréotypé. On pourrait penser à L'Homme qui marche d'Alberto Giacometti. Mais l'homme de Barni se répète à l'infini. C'est à la fois une figure unique et stéréotypée. Tous ensemble, ils me rappellent l'homme en costume noir, au chapeau melon, portant un parapluie, que René Magritte a aligné dans certaines de ses oeuvres. Mais ils ne sont pas alignés et chacun d'entre eux paraît agir en aveugle. Ils sont donc loin de ressembler à ces individus qui se ressemblent tous. D'oeuvre en oeuvre, dans un paysage chaque fois autres, au sein d'un monde coloré et changeant qui est celui des rêves. Ils forment parfois des groupes dont on ignore complètement la connivence. En réalité, on devine qu'ils font partie d'une petite pièce qui nous est mystérieuse, mais qui est à coup sûr une sorte de fable.
Ces fables sont la pure manifestation de ce que l'artiste est l'auteur : elles ne peuvent être comprises autrement que comme la quête de cette poésie qu'il a traduite en des termes plastiques. Il n'y a pas d'histoire à proprement parler, tout du moins dans les termes qui nous sont familiers. Et pourtant, on ne peut pas s'empêcher de les contempler avec plaisir et curiosité, comme si nous pouvions les interpréter sans difficulté. La virtuosité du peintre nous ouvre en grand sa Commedia. Il nous fait le don du regard qu'il porte sur ce monde qui est devenu métaphorique et qui est celui ù nous existons. Ce qu'il nous conte ne saurait faire sens en dehors de cette sensation permanente d'avoir pénétré dans une sphère idiosyncrasique qui n'est pas véritablement utopique, mais qui n'appartient plus à notre expérience quotidienne. L'irréalité où il nous entraîne est la transposition de la réalité à travers son regard qui se porte sur la beauté qui parvient à subsister sur une terre qui n'est pas très agréable à voir et à vivre. Il est sans nul doute un humaniste convaincu, mais il a dû transposer ce qui nous relie les uns aux autres pour laisser place à une philosophie personnelle grâce à laquelle il met en place sa conception de ce qu'il peut observer de notre devenir. Ce qui a entête, c'est de nous obliger, sans violence, sans chausse-trappe, à nous mettre à sa place pour éprouver ces sentiments et ces sensations qui ne cessent de l'habiter et de le conduire dans cet atelier qui est un laboratoire où, en secret, il développe ses intuitions et ses intuitions les plus prégnantes.
Il s'est ingénié à forger des tropes spéculaires qui jettent les fondements d'une vérité qui n'a de poids et de valeur qu'au coeur d'un espace fictif. S'il s'agit toujours d'une fiction, celle-ci est une caisse de résonance de ce que ses contemporains peuvent vivre et éprouver. Et si ces tableaux portent en eux un jugement sur cette réalité actuelle, ils ne supposent pas une morale. Ce sont bien des fables, mais sans morale. Il n'a par conséquent aucun lien direct avec Esope, Phèdre ou Jean de La Fontaine. Mais il n'a possède pas moins l'état d'esprit - il appartient à leur cénacle dans un objectif divergent : il ne dénonce rien et ne fustige rien - il ne tire aucune leçon de ses fabulae. Ses peintures, ses dessins, ses sculptures sont sous-tendues par un désir impératif de faire l'éloge d'un nouvel humanisme, sans en révéler les clefs. Là encore, il se divertit à prendre le spectateur dans les mailles de son filet d'illusions chromatiques. Il fait apparaître des situations tout d'un coup qui le plonge dans l'expectative tout en laissant entendre que derrière ses pièces de théâtre il y aurait plus à comprendre. Mais en coulisse, il n'y a que le mouvement de ses méditations, de ses émotions et de ses créations qui semblent sortir d'un trouble remugle de ce qui l'anime jour et nuit, en pleine conscience ou, à l'inverse, dans l'obscurité des songes les plus extravagants. Roberto Barni n'est pas un guide spirituel ni un maître de bonne conduite.
Il est là pour nous instruire qu'il existe bel et bien une autre manière de vivre et de mener son existence. Dans le plaisir sans exclusion et sans préjugés. Il nous incite à partir à la découverte de ce que nous sommes véritablement. Ses oeuvres servent de filtres pour parvenir à cette fin. Pas de morale ai-je dit, mais pas non plus de grands principes philosophiques ou encore idéologiques. Il nous ouvre des horizons dont la liberté est absolue, alors qu'il demeure le maître mot même si, dans ce cas précis, il reste le maître du jeu.
L'important n'est pas de reformuler une histoire, mais de se délecter d'une histoire qu'on ne peut pas reconstruire. Sa présence plastique est néanmoins suffisante pour nous procurer l'impression que les éléments appartenant à cette construction scénique intraduisible assez de force à nous donner satisfaction. Le peintre parvient à réussir le pari du double jeu ; le sens est l'intensité que cette image est capable de produire en nous, la rendant audible bien qu'elle soit muette. Son expression picturale est la clef de ce bonheur fondé sur ce dispositif indéchiffrable. Indéchiffrable peut-être, mais toutefois si attirant et si proche à la fois. De toutes ces cités en ruine ne se dégage rien de tragique sinon la conscience de prendre la mesure de ce qui a rendu les siècles passés si riches à nos yeux. Qu'on songe à un tableau intitulé Nella mia direzione sconosciuta de 1983 où l'on découvre une figure imposante traitée en bleu, qui avance en jouant de la flûte double, qui marche en se retournant pour regarder une ville dont les bâtiments géométriques, tous violets, sont sur le point de s'effondrer. Le ciel est entièrement rouge. L'écriture est caractéristique du style de Roberto Barni, qui est si libre et si féérique, et on n'est pas certains qu'il existe une relation entre la musique et l'état catastrophique de cette agglomération en perdition.
Dans un contexte plus moderne, on retrouve l'un de ces hommes aux yeux bandés, vêtu d'un costume bleu clair dans Meriggio (1985), assailli par une meute de loups ou de chiens sauvages qui tente avec fureur de les éloigner de lui. Cela se déroule sur un chemin désert en pleine campagne et l'on distingue au fond une petite masure blanche qui se découpe sur un ciel très sombre. Le plus singulier est qu'il a les yeux bandés. Il lui arrive parfois de revisiter des thèmes présents dans la peinture d'autrefois, comme le lion qui met à terre un cheval et plante ses crocs dans son cou (c'est le cas dans Lo sdegno). Cela rend l'événement improbable et mystérieux. Une autre spécificité de la peinture de Roberto Barni est le recours à la monochromie. On peut en voir la manifestation dans des toiles comme Cavaliere nel vortice (1983) où c'est le vert qui domine sans partage, dans Lo sdegno, où ce sont des bleus plus ou moins foncés qui s'imposent, dans Fuga dal paradiso terrestre de 1986. Les exemples de ce genre ne sont pas rares dans son histoire. Il n'y a pas chez lui de règles strictes en la matière, mais c'est néanmoins un penchant auquel il cède volontiers.
A cela s'ajoutent ses figures qui marchent, qui ne sont pas peintes d'une seule teinte, mais qui porte des costumes qui sont fabriqués dans un tissu d'une seule couleur. N'ayant pas de ligne de conduite définie, sa façon de traiter ses plans chromatiques diffère d'une oeuvre à l'autre. Ce qui va s'imposer de plus en plus, ce sont les façons de rendre ses figures modernes (et pourtant un peu intemporelles), avec une tendance à les restituer toujours plus anonymes et stéréotypés. Bien sûr, ils servent à montrer des scènes, comme celle où deux hommes assis face à face se lancent le contenu de leurs tasses de café (ils ont été créés pour une exposition de groupe sur le thème des cafés littéraires). Mais, en général, ils marchent droit devant eux, seuls ou en compagnie. Ils sont de plus de plus en plus présents dans les sculptures, agencés selon mille possibilités iconographiques, allant l'un vers l'autre, tête-bêche, en cercles, en farandoles. Et ils ont tendance à n'être le plus fréquemment présentés en rouge. La raison de ce choix nous est inconnue. Ils incarnent ce que nous sommes et sont la représentation d'une civilisation qui tend à réduire chaque individu à devenir la doublure de ceux qu'ils croisent ou qu'ils fréquentent. Dans sa récente exposition à la Fondazione Mudima (2022) et dans le beau livre que ladite fondation a publié en 2015 avec ses textes manuscrits et de nombreux dessins qui sont des séries de ses personnages fétiches vus sous toutes les couleurs : des têtes de faces et de profil, des corps qui parcourent des distances inclassables.
Ils sont presque tous rendus en rouge en sinon laissés en blanc, mais cernés d'une ligne rouge. Les plus récents ont fini, renversés, dans des poubelles. Si l'art de Barni est plutôt placé, en apparence, sous le signe du divertissement et même de la comédie, avec des contrastes de couleurs souvent joyeux, il n'en reste pas moins vrai qu'il jette un oeil désabusé et attristé sur ce qu'est devenue la communauté moderne, celle où il est immergé à son corps défendant. Cette plongée dans le réel de notre dernière fin de siècle et de la naissance de ce nouveau siècle est ce qui attribue à ses travaux profondeur et prégnance.
En effet, si ce qu'il dépose sur ses toiles procure le sentiment de mettre à jour des vérités qui ne sont pas bonnes à dire, mais qui sont irréfutables. Le plaisir qu'il procure aux spectateurs se double d'une insistance à s'enfoncer dans les obscures galeries d'un Enfer qui est notre demeure. Il n'a pas l'intention de brosser un panorama pessimiste des conditions qui nous sont faites, mais il tient à rappeler que notre bref séjour terrestre n'est pas à proprement parler paradisiaque. La peinture reste pour lui un instrument du bonheur, même si, de temps à autre, il s'est focalisé sur des aspects peu agréables ou dramatiques de notre époque. Mais il n'a pas souhaité trahir ses humeurs les plus noires, au contraire. Il les a insinués au sein de ces extrapolations tellement jubilantes quand il s'adonne à sa passion de peindre ou de sculpter. Ainsi, s'il considère l'art comme un objet de contemplation et de jouissance sans partage, il ne manque jamais d'y insérer, parfois presque en palimpseste, un rejet appuyé de notre gouvernement et de notre action dans le monde. Cependant, il le fait sans porter de jugement sur ceux qui nous gouvernent. Sa critique est implicite et n'a pas de cible visible. Et puis, il s'agit pour lui de mettre à nu notre manière de considérer la vie sociale et la vie privée, qui sont toutes deux dépourvue de profondeur et d'une certaine saveur. Comment Robert Barni parvient-il à nous intéresser et à nous toucher en élaborant des tableaux sans sujet et sans jamais offrir un indice pour déchiffrer ses oeuvres sans mettre à notre disposition le plus petit indice pour nous guider dans notre investigation ? La pure logique veut que nous n'avons pas à tenter de traduire ce qui n'existe pas. Il a eu l'ambition de créer un genre de peinture qui se dispense de sujet.
En cela, il est en rupture totale avec ses grands modèles du Quattrocento ou du Cinquecento qui, tous, avait affaire avec la religion ou le pouvoir. Même la nature morte, à commencer par la Hollande et les Flandres, était devenu un sujet en soi. Pour lui, le véritable sujet est sa réalisation, même si elle laisser penser qu'elle contient un récit. Enfin, dans une certaine mesure, il y a bien un récit, qu'il a scellé dans son coeur et dans son cerveau, et qui, le plus souvent, s'est imposé à lui sans qu'il sache trop pourquoi. Il pastiche l'art ancien, mais il a tenu vertement à ne pas l'actualiser. C'est la facture de sa peinture qui est la clef de tout, pas ses figures et tout ce qui compose (paysage, objets, animaux, etc.) son iconographie. C'est l'effet que produit l'ensemble qui fait sens et pas ce qui représenté. Mais son homme qui marche ne délivre pas de message précis, sinon qu'il est en général aveugle et qu'il a perdu le sens de sa pérégrination. D'où leur ambiguïté : ils peuvent contribuer à édifier un ensemble agréable à regarder ou esthétiquement remarquable, mais sans pour autant nous dire qui leur mouvement a un but ou non - ou encore s'ils ont conscience de leur destinée. Ils sont pourtant nos doubles rendus de façon schématique et par-dessus tout anonyme et ils ne sont qu'un reflet déroutant de notre égarement. C'est notre inconscient qu'il explore et qu'il restitue sous son pinceau avec ce perpétuel dédoublement (l'oeil perd aussitôt ses repaires les plus indispensables) qui fait perdre le nord à ceux qui viennent les observer et admirer sans réserve leur mise en place sur la toile. Nous admirons en quelque sorte le désarroi qui nous habite car il est l'aboutissement d'une culture immense qui aboutit à une pauvreté de l'essence des êtres humains. Oui, ils sont beaux, mais ils sont aussi pitoyables.
Tout ce qu'il nous présente est en règle générale féérique ou en tout cas merveilleux. Il est très rare qu'il se tourne vers des spectacles angoissants et dangereux. Son premier sujet (le seul et unique sujet qui puisse nous être compréhensible) est sans aucun doute le triomphe de la peinture qui précède, malgré tout, sa splendeur. Il ne prétend pas réinstituer le « grande genre » tel qu'on l'a pratiqué pendant le Siècle d'Or, mais il a recherché un équivalent moderne qui n'a plus aucune de ses particularités, sinon celle d'être virtuose et éblouissante. Mais bien des détails troublent cette tentation. Il est vrai que l'artiste a toujours su déployer un impressionnant imaginaire, qui est la source d'une sensation étrange de retrouver des émotions voisines de celles que nous procurent Léonard de Vinci, Paolo Uccello ou encore Titien. Il détient aussi le pouvoir de surprendre comme l'ont fait Edouard Manet, Edgar Degas ou Claude Monet. IL a aussi cette bizarre poétique digne de Gustav Klimt, Franz Mark ou encore Amedeo Modigliani. Celui-ci est intemporel, mais pas n'importe lequel : celui d'une écriture plastique qui n'appartient qu'à lui et qu'on ne saurait rapprocher de personne. Je le souligne une fois encore : son art même l'ancien et le moderne sans que l'un l'emporte sur l'autre. Il se situe dans un continent qui n'est ni un retour en arrière, ni un bond en avant, mais au creux de notre contemporanéité avec un stratagème vraiment inattendu.
Il a réussi à inventer un jeu d'échecs pictural dont nous sommes les récipiendaires Je ne vois pas d'autres possibilité de porter un jugement sur ce périple de plusieurs décennies en faisant évoluer son style, mais jamais un mode d'expression. Il nous étonne et nous fascine. Et c'est tout ce qui lui importe. Et nous, nous apprenons à jouir sans restriction de la peinture sans vouloir lui imposer des devoirs et des desseins secrets. Oui, tout ce qu'il fait donne le sentiment d'être hermétique, et peut-être a-t-il eu l'intuition d'un spectacle qui pourrait être finalement découvert. Mais cette sensation a été passagère et il n'en est resté qu'une trame sans mots. A ce point, il convient de se rappeler que Roberto Barni a aimé accompagner ses croquis de textes, des poèmes ou des nouvelles, ou encore de textes très libres, qui ne commentent pas, mais les accompagnent. Il se révèle ses vaticinations avec beaucoup de finesse. Ces écrits complètent ses oeuvres graphiques ou picturales, mais ils n'ont pas pour objet de les expliquer. C'est le cours de la pensée de l'auteur qui nous est dévoilé avec subtilité, mais aussi un rien d'humour et d'ironie. Ils sont précieux pour nous imprégner de ce libre cours de sa curieuse circonvolution mentale, qui est le propre de son ressenti sur tout ce qui l'entoure ou qui le touche au fond de l'âme. Ce ne sont cependant pas des bribes de journaux intimes, mais des réflexions qui finissent par constituer une flastroca. Il a tendance à écrire à main levée, sans avoir préparé un brouillon ou même des notes. Il écrit comme il peint, avec spontanéité et inspiration. La raison pure ne fait pas partie de ses instruments de travail. La plupart de ces pages sont dispensés dans de beaux livres à tirage limité. L'aventure de Roberto Barni subsiste encore et toujours comme l'une des plus passionnantes depuis les années soixante-dix. Il figure parmi les grands maîtres qui ont pu être une magnifique résurrection de la peinture dans des termes qui n'appartiennent qu'à lui. Et à lui seul.
|
