La bibliothèque de l'amateur d'art
par Gérard-Georges Lemaire

Une nuit sur le mont Chauve, Michel Butor/Miquel Barcelò, Editions de la Différence, 160 p.
Michel Butor écrit des poèmes et Miquel Barcelò dessine. Il y a une certaine cohérence entre la suite de poème de l’écrivain et les dessins spectraux du peintre. Le projet part de la fameuse pièce musicale de Modeste Moussorgski, Une nuit sur le mont Chauve, qu’a inspiré Nicolas Gogol avec sa « Nuit de saint Jean sur le mont Chauve ». Butor a choisi de composer son texte avec des strophes de quatre vers. Barcelò, pour sa part, a opter pour des figures dorées (eau de Javel et Gesso) sur fond noir. Ce qui engendre une sorte de résonance entre l’écrit et la peinture. L’ouvrage, dans son format allongé à l’italienne, est remarquablement réalisé. Même les mots imprimés en jaune sur fond noir, style que je n’apprécie guère en général, sont du meilleur effet et font corps avec les créations de l’artiste majorquin. Les poèmes ne sont pas toujours du meilleur Butor, mais le projet dans son ensemble est assez convaincant. Il est indéniable que Barcelò lui donne une dimension d’une force pleine d’angoisse et de mort qui transcende la poésie. En conclusion, c’est un livre pour amateur d’art plus que pour amateur de littérature, mais c’est un beau livre quoi qu’il en soit !
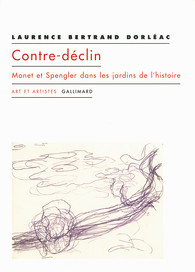
Contre-déclin, Laurence Bertrand Dorléac, « Art et artistes », Gallimard, 320 p., 24 €.
Cette étude, telle qu’elle nous est présentée, semble une de ces galipettes théoriques dont les théoriciens de l’art d’aujourd’hui nous ont bien trop habitué. Rapprocher les noms d’Oswald Spengler (1860-1936) et de Claude Monet paraît un peu forcée. Mais en lisant l’ouvrage, on se rend compte que sa thèse repose sur des bases sans doute singulières, mais solides. En effet, il faut se replacer dans le contexte précis d’une époque. Le grand livre de Spengler, qui l’a rendu célèbre dans le monde, le Déclin de l’Occident, paraît en 1918, à une époque où Monet est un vieux monsieur déjà célèbre, qui a révolutionné l’art de la peinture. La guerre qui va s’étendre dans une grande partie du monde, est un tournant décisif dans notre histoire : des empires y sombrent, des révolutions en résultent, un univers disparaît corps et bien (celui que Proust décrit dans A la recherche du temps perdu). Pour comprendre ce que Laurence Bertrand Dorléac a en tête, il faut introduire un troisième homme : Georges Clémenceau. Son nom va rester dans l’histoire pour avoir été l »le père la Victoire », l’homme qui n’a pas faibli alors que dans l’ombre beaucoup s’étaient mis à douter. Mais cet homme inflexible ne s’est pas contenté de ce destin. Il a voulu aussi que l’Histoire se souvienne de lui comme un grand patron des arts, ce que l’Etat n’était plus franchement en mesure d’assumer depuis l’abandon du Salon en 1881 et son aveuglement devant la grande création moderne. Clémenceau a été l’ami des peintres les plus audacieux, et il a été d’abord l’ami d’Edouard Manet, qui a fait son portrait. D’autres le suivront.
Clémenceau tenait beaucoup à que son image soit véhiculée par ces artistes qui était assez mal vus des critiques bien pensants et des salons mondains. C’est alors qu’il a l’idée de commander au peintre presque aveugle une œuvre considérable qui devrait être installée dans une salle spécialement aménagée à cet effet. Ces Nymphéas représentent sans nul doute une expérience unique en son genre dans l’art du début du XXe siècle. Sans doute Monet avait été depuis longtemps regardé comme un précurseur par ceux qui sont à l’origine du cubisme et le fauvisme. Mais il incarne cet esprit français qui a le courage de renverser les valeurs établies. C’est déjà un mythe et un exemple de courage et de persévérance. De son côté Spengler, s’appuie sur la philosophie de Nietzsche, mais ne l’adopte pas. Il considère que le monde occidental a connu deux moments : celui qui est qualifié d’apollinien avec l’Antiquité classique et celui qu’il considère comme faustien et qui est le propre de la modernité. Et il est patent qu’il opte pour cette modernité et se révèle en phase avec le vitalisme iconoclaste d’un Marinetti quand il fonde le futurisme. L’auteur pense à ce propos que Dada et le surréalisme sont animé par un esprit vitaliste parallèle au sien.
En somme, à partir de ces prémisses, l’auteur nous conduit à penser sous un éclairage neuf la création artistique dans le monde moderne, loin, très loin, de tous les clichés dont nous sommes accablés.
précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 suite
- Entretien avec Benjamin -
le 8 novembre 2012
par Daphné Brottet - Quand Benjamin fait du Fifre d'Édouard Manet le point de fuite de sa pensée sur le sujet de la peinture.
par Gérard-Georges Lemaire - Voyage en peinture
ou
Voyage au bout de la nuit
(mais c’est déjà pris)
par Odile Dorkel - Benjamin
par Sapho - La théophanie
Un homme et une femme regardent un tableau de Benjamin
par Max Guedj - L'art de l'effeuillage
ou L'étoffe des libertins
par Jean-Claude Hauc - L'œil écrivain
par Christophe Averty - Deux clins d'œil :
Gérard de Lairesse par Jean-Michel Charbonnier
et Le costume byzantin par Eudes Panel.
- Sensus communis. À propos des photographies de Philippe Monsel
par Luc Ferry - Banditi dell’Arte, une ontologie
de l’« hors normes » ?
par Marie-Noëlle Doutreix - Les tableaux Tounes Boules (turn cut)
d'Arthur Aeschbacher
par Gérard-Georges Lemaire - Une biennale pour l'architecture
partagée : une promenade dans l'arsenal
par Giancarlo Pagliasso - Tatline / art et monde nouveau
par Giancarlo Pagliasso - L'art et le cyclisme
par Leonardo Arrighi - Éloge de Simon Hantaï
par Gérard-Georges Lemaire - Philippe Richard
par Vianney Lacombe
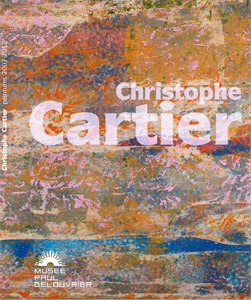 Christophe Cartier
Christophe Cartier


